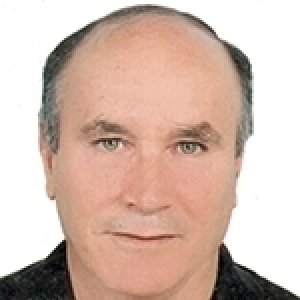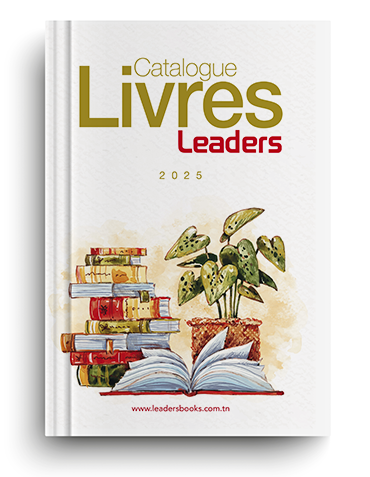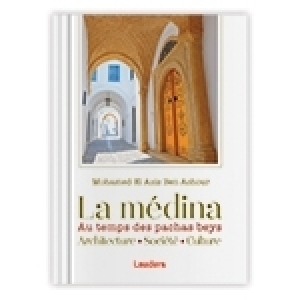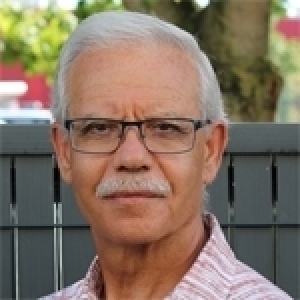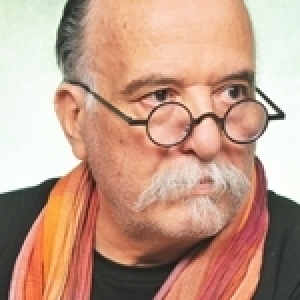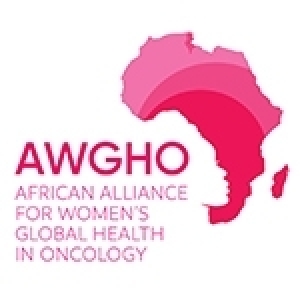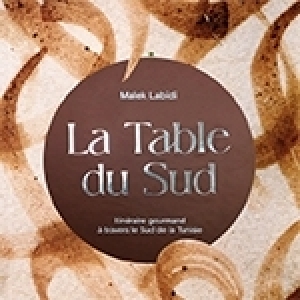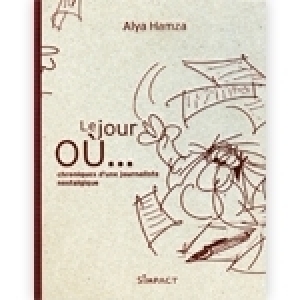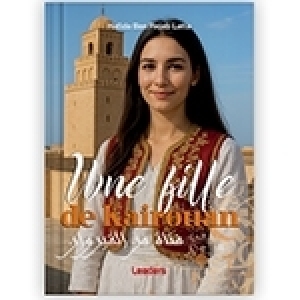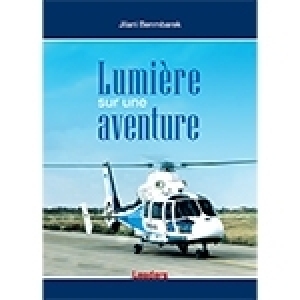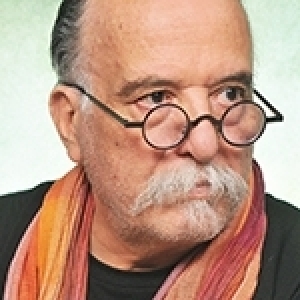Hafedh Abdelmelek - Un quart de siècle de révolution invisible des nanosciences: dynamiques globales et émergence Tunisienne

Introduction
Les nanosciences (un milliardième de mètre : nm) font depuis plus de vingt ans l’objet de travaux scientifiques et techniques dans le monde et en Tunisie, au sein et à l’interface de disciplines scientifiques multiples, comme la physique, la chimie, la biologie, la médecine Humaine et la médecine vétérinaire, les sciences de l’ingénieur (sciences dures), et les sciences humaines et sociales (sciences molles). Les recherches sur les nanotechnologies suscitent des espoirs importants en raison des propriétés particulières de la matière à l’échelle nanométrique qui permettent d’envisager de nouvelles fonctions à l’échelle de l’infiniment petit (nanosciences : 1-100nm).
Le présent article dresse un bilan, en mettant en lumière les principales évolutions scientifiques et techniques en Tunisie et la mise en place d’un nouveau paradigme. En effet, l’histoire économique de nos sociétés industrielles a été marquée par de grandes vagues successives. La première vague fut celle du charbon et de l’acier, la deuxième vague celle de l’électricité et du pétrole, la troisième vague celle des télécommunications. La quatrième vague est celle des technologies de l’information et de la communication, des nanotechnologies, des biotechnologies et des écotechnologies. Longtemps perçues comme une science de pointe réservée aux grandes puissances, les nanosciences s’imposent désormais comme un champ stratégique pour le monde Arabe et l’Afrique. En Tunisie, une génération de chercheurs façonne depuis deux décennies un écosystème ambitieux, reliant les laboratoires locaux aux réseaux internationaux. Des partenariats avec les entreprises sont également soutenus, via les projets du Ministère de l’Enseignement Supérieur et les pôles de compétitivité (CRMN Technopôle Sousse)...etc.
La présente analyse contribuera à éclairer les lecteurs sur la diversité et la qualité des travaux menés par les enseignant-chercheurs et leurs partenaires pour développer la compréhension et l’utilisation sociétale des nanotechnologies en Tunisie.
Le sublime de l’invisible : une lecture scientifique de l’infiniment petit
Lorsque l’on s’intéresse aux nanotechnologies on distingue l’approche top-down et l’approche bottom-up. L’approche top-down (ou descendante) est basée sur la miniaturisation. On part de blocs de matière que l’on divise autant de fois que nécessaire pour arriver à un objet de taille nanométrique. Pour cela, on utilise des techniques de fabrication dérivées des techniques dites de lithographie qui ont été développées pour l’industrie de la microélectronique. La lithographie permet de fabriquer les circuits électroniques intégrés ainsi que des microsystèmes électromécaniques. Les technologies utilisées pour la réalisation de circuits ou systèmes miniaturisés s’appuient sur des équipements permettant de gérer des dimensions de quelques nanomètres, et est effectuée dans des salles blanches. L’approche bottom-up (ou ascendante) est basée sur l’assemblage d’atomes ou de molécules. Cette fabrication ascendante, similaire à la voie suivie par la nature pour l’auto-assemblage (Biomimétisme), permet de travailler atome par atome, molécule par molécule. Elle peut être réalisée en utilisant des équipements capables de manipuler des molécules avec une précision atomique et d’utiliser des liaisons entre atomes ou molécules. Les microscopes à effet tunnel et à force atomique permettent ainsi d’assembler des édifices nanométriques.
Le sublime de l’invisible: une lecture philosophique, littéraire et artistique de l’infiniment petit
Les nanosciences explorent un univers imperceptible à l’œil Humain : celui de l’infiniment petit. Au-delà de leurs applications technologiques, elles ouvrent un champ inédit pour la réflexion philosophique, la création artistique et l’imaginaire littéraire. Cet essai propose une traversée de ces territoires invisibles, où science et art dialoguent, révélant dans le minuscule l’écho de l’infini à l’image de l’art du verre, où les nanostructures étaient déjà à l’œuvre dans les vitraux d’églises antiques.
L’infiniment petit ne se réduit pas à un objet d’étude scientifique : il devient source d’inspiration et moteur de rêverie. En littérature, il se manifeste à travers le goût du détail, du fragment, ou encore par la valorisation de l’invisible comme signe porteur de sens.
Déjà chez Pascal, l’infiniment petit suscitait un vertige métaphysique: « Le silence éternel de ces espaces infinis m’effraie. » À cette angoisse devant l’immensité et l’imperceptible s’ajoute aujourd’hui un vertige d’un autre ordre, un vertige créatif: celui où le minuscule devient la métaphore d’une tension entre l’insignifiance apparente et la puissance contenue dans le détail.
La poésie moderne, quant à elle, puise dans la microstructure de la matière des images nouvelles, célébrant la beauté fragile (harmonie et nombre d’or) et la complexité cachée du monde. À l’instar des nanosciences, la littérature s’efforce de «rendre visible l’invisible», d’explorer les profondeurs du réel et d’en révéler les dimensions imperceptibles à la perception ordinaire de notre cerveau.
1. L’art et la poétique du nano
Les artistes contemporains entretiennent désormais un dialogue direct avec le monde du nanoscopique. Certains se servent du microscope électronique comme d’un véritable pinceau, réalisant des sculptures à partir des motifs gravés à l’échelle atomique ou encore des installations inspirées de la structure des nanoparticules.
La rencontre entre science et art transforme aussi notre perception sensible. L’infiniment petit devient une source d’émerveillement, de méditation et de contemplation. Les nanoparticules, les nanostructures cristallines ou les flux moléculaires révèlent des motifs insoupçonnés, des harmonies cachées du vivant et de la matière.
L’Homme moderne, en découvrant ces nanomondes, se confronte à son propre rôle dans le monde : capable de créer, de détruire, mais aussi d’admirer. La nano devient ainsi un langage commun (effondrement des barrières) entre sciences, arts et philosophie : un pont entre rigueur et imagination, entre rationalité et émotion (Abdelmelek, 2019).
Ainsi, l’art et la science se rejoignent dans une esthétique de la complexité: le visible devient la trace de l’invisible, et la matière, un langage à part entière.
2. La philosophie du minuscule: réseaux, complexité et responsabilité
Le passage à l’échelle nanométrique bouleverse notre conception du réel. Ce dernier n’apparaît plus comme une surface homogène et continue mais comme une matrice d’interactions. Edgar Morin (la pensée complexe) offre des cadres conceptuels pour appréhender cette nouvelle complexité du monde. Les nanosciences dépassent ainsi la simple dimension technique; elles invitent à penser le monde comme un tissage de relations invisibles (canevas, interactions ondes électromagnétiques & cerveau), où chaque élément, aussi infime soit-il, peut influencer l’ensemble.
Évolution mondiale des nanosciences et nanotechnologies
Les nanosciences ont ouvert une ère où l’on ne se contente plus d’observer la matière : on la conçoit, atome par atome. Dans un monde où les atomes dessinent l’avenir, cette maîtrise du minuscule devient un levier de souveraineté scientifique.
1. Genèse et expansion (2000–2025)
Le début des années 2000 marque une période décisive : la création du National Nanotechnology Initiative aux États-Unis (2000) a servi de catalyseur à l’investissement mondial dans ce domaine. Aujourd’hui, les nanotechnologies sont considérées comme une technologie clé générique au même titre que la biotechnologie ou l’intelligence artificielle.
2. Domaines d’application majeurs
• Médecine et santé: développement de nanomédicaments, nanodrug, vectorisation des médicaments, traitement du cancer par hyperthermie, nanoparticules pour l’imagerie cellulaire, l’imagerie par résonnance magnétique nucléaire (IRM) et la thérapie photo dynamique, nano diagnostics,…etc.
• Énergie: nanomatériaux pour batteries, cellules solaires, catalyse et stockage d’hydrogène.
• Électronique: transistors à effet de champ, mémoires à base de graphène, circuits flexibles.
• Environnement: nanocapteurs et nanofiltration pour la dépollution de l’eau et de l’air (rivières, barrages, lacs, lagunes,…etc.).
• Matériaux avancés: revêtements intelligents, nano composites, textiles multifonctionnels (anti-microbien,…etc.).
3. Enjeux économiques et éthiques
L’économie mondiale des nanotechnologies est estimée à plus de 1000 milliards de dollars en 2025. Cependant, ces progrès s’accompagnent de défis : gestion des risques sanitaires, encadrement réglementaire, acceptabilité sociétale et durabilité environnementale. De nombreux pays ont intégré ces dimensions dans leurs politiques de recherche et d’innovation responsable.
Les nanosciences et nanotechnologies en Tunisie : un développement progressif
1. L’émergence d’une scène tunisienne
En Tunisie, l’aventure nano a commencé discrètement au tournant des années 2000. Les premiers laboratoires universitaires s’y intéressaient essentiellement pour des raisons académiques. Mais à partir de 2010, le mouvement s’accélère par la création de plateformes technologiques, les pôles de compétitivité (CRMN Technopôle Sousse,…etc.) et la montée en puissance des laboratoires spécialisés et l’accès croissant aux réseaux de recherche internationaux changent la donne.
Depuis 2000 à la Faculté des Sciences de Bizerte - Université de Carthage, les enseignants-chercheurs ont organisé plusieurs séances de réflexion sur la stratégie des départements et des laboratoires dans le domaine des nanosciences et nanotechnologies. Par ailleurs, entre 2005 et 2015, l’Agence Arabe à l’Énergie Atomique (AAEA), basée à Tunis (Tunisie), a intégré dans ses programmes de formation destinés aux experts et chercheurs issus de divers centres nucléaires du monde arabe deux thématiques majeures: les applications des rayonnements non ionisants et les nanosciences dans différents domaines tels que la santé, l’environnement, l’eau, l’énergie et l’industrie, entre autres.
2. Domaines de recherche et applications prioritaires
Les efforts tunisiens se concentrent sur:
• Les nanomatériaux pour l’énergie (photovoltaïque, stockage, catalyse);
• Les nanoparticules métalliques et polymériques à usage biomédical;
• Les nanocomposites pour les industries mécaniques et textiles;
• Les applications environnementales, notamment le traitement de l’eau et la valorisation des déchets.
3. Formation, innovation et défis
Des cours spécialisés en nanosciences ont vu le jour depuis 2003-2005. Cependant, la valorisation industrielle reste encore limitée, en raison de la faiblesse du transfert technologique et du manque d’infrastructures de production à l’échelle pilote.
Les principaux défis concernent:
• La structuration du lien entre recherche et industrie au niveau des technopoles (COSS Conseil d’Orientation Scientifique et Stratégique);
• Le financement de l’innovation;
• La normalisation et la réglementation des produits à base de nanomatériaux.
4. La diplomatie scientifique du nano
La montée en puissance tunisienne s’inscrit dans une dynamique mondiale où les collaborations Sud-Nord se multiplient. Des partenariats ont permis le transfert de savoir-faire et la formation de jeunes chercheurs tunisiens à la pointe des techniques de microscopie et de nanofabrication.
Ces coopérations ont permis à la recherche locale de publier dans des revues de référence et d’intégrer les grands consortiums internationaux.
Les prochaines années devraient voir:
• Une intégration croissante des nanotechnologies avec l’intelligence artificielle.
• Une orientation vers la durabilité: nanomatériaux verts.
• En Tunisie, une nécessité de renforcer les écosystèmes d’innovation (technopoles, incubateurs, start-ups, spin-offs, partenariats public-privé).
5. Les applications faisant appel aux nanosciences et aux nanotechnologies: quelles questions éthiques dans les champs couverts par les technopoles en Tunisie?
Les sciences et technologies à l’échelle nanométrique suscitent des débats de nature scientifique, éthique et sociale, que ce soit dans le domaine des matériaux, des technologies de l’information, de la santé, de l’énergie, etc. En ce qui concerne plus particulièrement les domaines de recherche orientées agroalimentaire, alicaments, nutraceutique, emballage,…etc. Le COSS (Comité d’éthique) dans le domaine des alicaments, des phytomédicaments, et de l’agroalimentaire doit dresser un panorama des applications avérées et potentielles des nanotechnologies dans le domaine de l’agriculture et de l’alimentation Humaine et Animale avec une vision One Health (une seule santé). L’originalité des objets des nanotechnologies provient moins de leur taille que des effets associés à la dimension nanométrique (effondrement des barrières biologiques), effets développant des fonctionnalités particulières que l’on va recruter aux fins de nouvelles applications. Á cette échelle, l’imbrication entre savoirs et savoir-faire est telle que la distinction entre nanosciences et nanotechnologies devient artificielle. Les nanotechnologies faisant émerger des propriétés inconnues et imprévisibles, la question des risques doit être abordée avec soin. Cependant, la démarche éthique ne se réduit pas à l’appréciation des risques et de leurs conséquences pour l’action. Les Comités d’éthiques doivent assurer un accompagnement réflexif du travail des chercheurs qui les invite à développer une nouvelle culture de l’objet et des applications avec des partenariats avec les industriels.
Conclusion
En l’espace de vingt-cinq ans, les nanosciences et les nanotechnologies ont redéfini les frontières du savoir et ouvert de nouvelles perspectives pour la société tunisienne. Tandis que les pays développés ont déjà intégré ces technologies à leurs économies, la Tunisie dispose d’un potentiel scientifique reconnu qu’il s’agit désormais de convertir en une valeur économique et sociale durable. L’avenir dépendra de notre capacité à allier innovation, responsabilité et coopération internationale.
Les nanosciences ne se réduisent pas à leurs applications techniques : elles invitent aussi à une réflexion philosophique, poétique et artistique. Elles nous plongent dans un univers où le minuscule questionne le grand, où l’invisible devient source de création et de pensée. L’infiniment petit nous rappelle que la beauté, la complexité et la responsabilité se nichent dans les détails. Dans ce dialogue entre science, art et philosophie, chaque atome devient symbole celui de notre aptitude à comprendre, transformer et contempler l’univers dans toutes ses dimensions, même les plus infimes.
Ces transformations suscitent également des inquiétudes, qu’il s’agisse des risques potentiels liés à la nanotoxicité ou de leurs répercussions sur nos modes de vie. Dans ce contexte, l’Académie Tunisienne des Sciences, des Lettres et des Arts à travers son Département des Sciences Mathématiques et Naturelles a pour mission d’accompagner la société et de promouvoir les meilleures recherches dans l’ensemble des disciplines concernées, afin de distinguer ce qui relèvera du réalisable de ce qui restera du domaine de la fiction.
Hafedh Abdelmelek
- Ecrire un commentaire
- Commenter