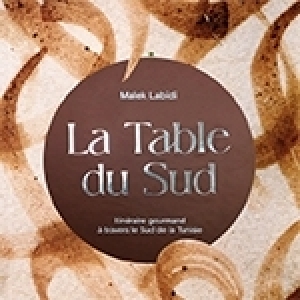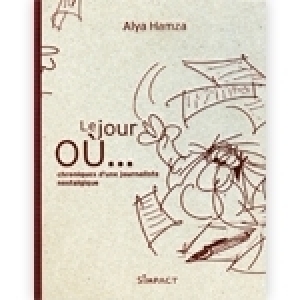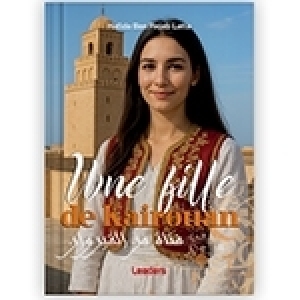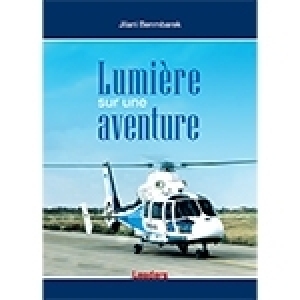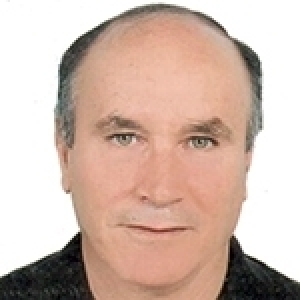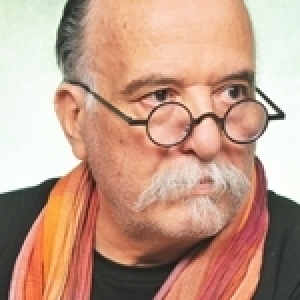Riadh Zghal: L’indice de développement régional et la persistance des inégalités

L'Itceq vient de publier son rapport relatif à l’indice de développement (IDR) par gouvernorat et par délégation. Les variables utilisées pour calculer cet indice sont au nombre de sept : infrastructure et équipement de base (taux de routes classées, accès aux services aéroportuaires et portuaires, taux de raccordement aux réseaux d’assainissement et d’eau potable), accès aux services de santé (nombre de pharmacies, de lits et de médecins généralistes pour 1 000 habitants dans les établissements publics), accès aux services de loisir (disponibilité et diversité des services de loisir pour 1 000 habitants : nombre de stades gazonnés, salles de sport, maisons des jeunes, clubs d'enfants, complexes pour enfants et bibliothèques), dimension sociale (nombre de familles nécessiteuses pour 1 000 habitants, taux de dépendance démographique: la part des individus pris en charge par leurs familles), capital humain (nombre d’élèves par classe et par enseignant, part de la population instruite: nombre d’individus ayant un niveau d’instruction secondaire et supérieur rapporté à la population totale), capacité d’absorption et étendue du marché d’emploi (offre d’emploi pour 1 000 habitants, taux de placement: pourcentage de demandeurs d'emploi ayant trouvé un emploi par rapport au nombre total de demandeurs, nombre d’entreprises pour 1 000 habitants, taux de chômage), tension et profil du marché du travail (degré de spécialisation ou de diversification potentielle de la main-d’œuvre dans les différentes délégations ).
Je ne discuterai pas le choix de ces variables car la liste pourrait être allongée par beaucoup d’autres qu’on jugerait aussi pertinents tels le taux de croissance démographique, le nombre d’institutions universitaires et de recherche, les secteurs d’activité dominants par genre et le nombre d’entreprises couvrant la chaîne d’approvisionnement et de commercialisation, le taux d’activité entrepreneuriale dont les start-up et le ruissellement des activités créatrices de richesse des gouvernorats les mieux nantis vers ceux voisins et moins avantagés…
En revanche, je soulignerai des résultats qui reflètent une stagnation des inégalités entre les gouvernorats et une décroissance de l’IDR comme si, au lieu d’être un pays dit « en développement», des signaux suggéraient que la pays s’est placé sur une pente de sous-développement. En effet, les calculs effectués par l’Itceq de 2015 à 2024 révèlent une décroissance de l’IDR aussi bien au niveau de la moyenne nationale que celui des indices maximums et minimums : la moyenne nationale est passée de 0,502 à 0,461, le maximum atteint par les gouvernorats est passé de 0,628 à 0,565, et le minimum de 0,402 à 0,365. Les sept variables qui ont fondé le calcul de l’IDR connaissent une baisse, excepté une légère croissance de la variable «Infrastructure et équipement de base» et celle du «capital humain» que les auteurs expliquent par le renforcement du nombre d’enseignants.
Il est remarquable que tous les gouvernorats qui présentent les meilleurs IDR se trouvent sur la côte et les deux gouvernorats qui renferment le plus de délégations classées dans la catégorie 1 sont Tunis et Monastir. Serait-ce du fait qu’il ont constitué les centres du pouvoir depuis l’indépendance, ou bien de leur taux élevé d’urbanisation, de l’esprit entrepreneurial de leur population, de leur attractivité pour les entrepreneurs des autres gouvernorats ou bien tout cela à la fois?
L’Itceq a classé les gouvernorats en quatre catégories. Les gouvernorats de la catégorie 4 à l’indice le plus faible sont restés les mêmes dans les classements de 2015 et 2024: Jendouba, Béja, Siliana, Kairouan, Kasserine, Sidi Bouzid.
Dans leur analyse de la répartition de l’IDR par délégation, les auteurs distinguent entre les gouvernorats côtiers et les gouvernorats de développement. Les premiers abritent près de 93% de l’ensemble des délégations classées dans la catégorie 1 des meilleurs indices IDR. Seulement Tunis, Mahdia et Sfax comptent des délégations classées dans la catégorie 4 des plus faibles IDR. D’autres détails concernent la régression de l’IDR de certains gouvernorats et la progression de celui d’autres.
Que faut-il conclure de ce précieux rapport ? La pensée de Gramsci qui disait qu’il faut que tout change pour que rien ne change, revient à l’esprit. En effet, la répartition de l’IDR par gouvernorat reflète une stagnation des orientations des politiques de développement adoptées depuis le règne de Bourguiba jusqu’à nos jours malgré les différences d’appellation. Ce sont des politiques conduites selon une gouvernance demeurée inchangée par un pouvoir toujours centralisé quel que soit le président au sommet de l’Etat. C’est ce pouvoir qui distribue les ressources et décide des investissements. L’administration publique en tant qu’instrument de la gouvernance à l’échelle nationale et dans les régions est demeurée fidèle aux paradigmes bureaucratiques du pouvoir centralisé. Outre l’iniquité dans la répartition des ressources, les mêmes schémas de gouvernance sont appliqués aux régions nonobstant les problématiques, les potentiels et les insuffisances particulières de chaque région.
Deux risques sont inhérents à la centralisation: celui de la distribution inéquitable de l’investissement public qui dépend des pouvoirs parmi les décideurs d’une part et, d’autre part, celui de l’ignorance/la négligence des ressorts de développement particuliers présents dans chaque gouvernorat qui pourraient servir de leviers pour le développement. Lorsque la gouvernance suit le seul chemin de la verticalité, autrement dit que tout se décide au sommet de la pyramide des autorités, on réduit les chances de développement de régions qui demeurent marginalisées de décennie en décennie. Le pouvoir centralisé n’implique pas les populations locales et ses acteurs sociaux dans le choix des orientations politiques qui seraient davantage en harmonie avec le contexte, ses manques et ses atouts. En fait, les gouvernements procèdent à des consultations à l’occasion de la préparation d’un plan de développement qui peut inclure des propositions émanant des représentants des régions mais la réalisation des vœux de ces derniers est souvent ignorée par les décideurs au moment de la répartition des investissements. A ce propos, l’IDR devrait intégrer dans ses calculs cette variable du taux de réalisation et celui d’abandon des projets figurant dans les plans de développement successifs. On a entendu l’actuel Président de la République reprocher à plusieurs reprises que des projets programmés par le gouvernement ne voient pas le jour.
Il faudrait se rendre à l’évidence aujourd’hui que le modèle de la gouvernance centralisée qui a prévalu en Tunisie depuis l’indépendance a failli à la réalisation d’un développement général et équitable malgré les progrès réalisés en matière de développement humain grâce à l’éducation, la santé et l’émancipation des femmes. Pour sortir les délégations et les gouvernorats de la marginalisation, il y a besoin de changer le paradigme qui a commandé la gouvernance nationale et passer de la verticalité à l’horizontalité des processus de décision à travers une réelle décentralisation. Une réelle décentralisation sera bien différente des expériences de déconcentration de l’administration publique qui n’ont nullement été suivies par la participation des acteurs locaux à la prise des décisions stratégiques soutenant un développement inclusif et durable.
La décentralisation véritable s’appuie sur le principe de l’horizontalité au sens de contribution de la base à la gouvernance dans ses différentes dimensions: participation aux décisions, transparence et redevabilité. Une telle contribution favorise la contextualisation des choix politiques au sens où sont pris en compte les variables incontournables qui en conditionnent le succès, à savoir les ressources disponibles et valorisables, les activités économiques dominantes et leur chaîne de valeur, les structures sociales, les organisations actives de la société civile, les cultures locales… Certes, la verticalité de la gouvernance est plus aisée que la gouvernance horizontale plus complexe mais plus performante si l’on vise un développement inclusif, équitable et durable. Avec une gouvernance nationale qui cède une part du pouvoir à la base, le développement sera plus équitable parce qu’il aidera à éradiquer la marginalisation et la pauvreté, durable parce qu’il mobilisera la population locale et l’intelligence collective pour la conception et la réalisation des objectifs stratégiques visés.
Riadh Zghal
- Ecrire un commentaire
- Commenter