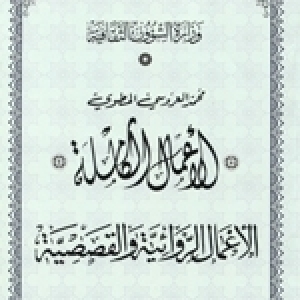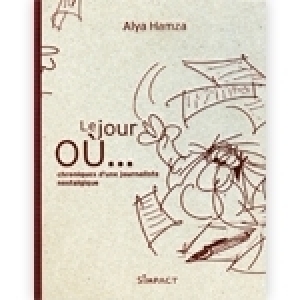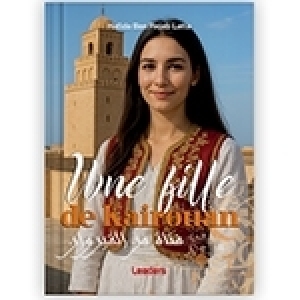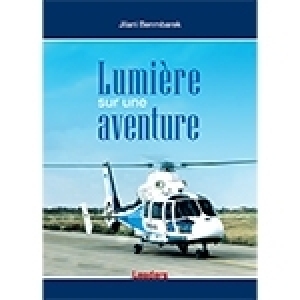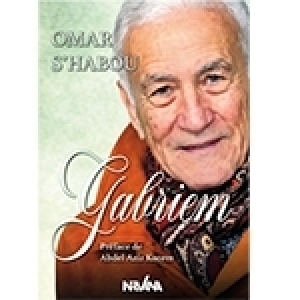Il y a mille ans, disparaissait Sidi Mehrez (953-1022): Un «sutlan» sanctifié

(8).jpg) Par Aissa Baccouche - Mille ans nous séparent d’un homme dont les gestes et faits ont marqué non point une époque mais l’histoire de la Tunisie. Pourtant, Mohrez Ibn Khalef, que je veux nommer, est d’une actualité criante. Le Sultan de la Médina, puisque ainsi l’appelèrent ses «ouailles» gît dans un mausolée que lui bâtirent «ses sujets révérencieux».
Par Aissa Baccouche - Mille ans nous séparent d’un homme dont les gestes et faits ont marqué non point une époque mais l’histoire de la Tunisie. Pourtant, Mohrez Ibn Khalef, que je veux nommer, est d’une actualité criante. Le Sultan de la Médina, puisque ainsi l’appelèrent ses «ouailles» gît dans un mausolée que lui bâtirent «ses sujets révérencieux».
Sidi Mohrez est actuel dans la mesure où, dix siècles après sa disparition, et alors que l’humanité traverse depuis un certain 11 septembre une zone de turbulences d’essence religieuse – Malraux n’avait-il pas prédit que le vingt-et-unième siècle serait religieux – la tolérance, dont il fut l’apôtre, est universellement sollicitée comme mode de coexistence voire d’existence.
L’homme qui naquit en 953 à l’Ariana où il ne trouva guère d’échos à son enseignement, lui, le méddeb – l’instit – n’étant pas prophète en son bled – se rendit à Tunis où il reçut ses titres de sainteté. Il les devait à cette entreprise hardie de rapprochement des deux communautés musulmane et juive dans l’enceinte de la ville dont il était devenu le patron.
En faisant sortir les juifs du ghetto du faubourg d’El Mallassine et en leur proposant de peupler une hara contiguë à sa demeure, Mohrez a tressé pour mille ans les mailles de la texture urbaine de la future capitale du pays. La hara, selon la définition d’Ibn Mandhour dans son dictionnaire Lissan El Arab, est un groupement d’unités de voisinage.
La légende lui attribue cette image fort significative du pouvoir magique que lui confèrent ses protégés.
En effet, pour délimiter l’espace ainsi réservé aux nouveaux habitants il aurait lancé haut et loin sa canne. Autre époque, autres instruments de mesure!
Si l’histoire est, comme on le claironne ici et là, un éternel recommencement, est-ce que cela nous autorise pour autant à regarder le passé à travers le prisme du présent? Pourquoi j’avance cela. Et bien tout simplement parce que certains de nos contemporains jugent l’action de Mohrez Ibn Khalef à l’aune de ce qui caractérise aujourd’hui notre temps.
Ils lui imputent en effet la volonté d’attirer, comme le font ceux qui gouvernent les Etats en temps de crise, l’investissement par moult mesures y compris les encouragements à la délocalisation. Ils lui dénient toute arrière-pensée morale ou religieuse. Il aurait agi plutôt par calcul ou pour employer un langage politiquement correct par souci de bonne gouvernance. Ce jugement a posteriori plait intellectuellement. Il ne résiste pas cependant à l’analyse de la pensée et des écrits du personnage.
Car, était-il mû par un quelconque opportunisme lorsqu’il demanda à l’Emir de l’époque d’accorder aux femmes la liberté d’aller faire elles-mêmes leur marché. Pourquoi avait-il déclaré la guerre à tous les agitateurs d’obédience chiite s’il n’était intimement convaincu que le sunnisme était le rempart contre tous les excès et que seule la tolérance constituait le salut pour tous?
Etait-il un être placide, lui qui allait à Carthage méditer sur le sort d’une civilisation jadis florissante?
Relisons ce qu’en a rapporté Ezzedine Bach Chaouch dans son livre intitulé La légende de Carthage: «Dans le haut moyen âge, à l’orée du XIe siècle, un pédagogue de Tunis, Sidi Mohrez, aimait se rendre à Carthage et s’asseoir sur les vestiges de la cité martyrisée. Il lui consacra un remarquable chant funèbre, une sorte de thrène à la manière des poètes grecs, où il passe en revue les grandes époques historiques, met en exergue les plus beaux monuments – l’amphithéâtre et l’aqueduc – verse des larmes devant l’ampleur de la ruine.
«Pourquoi ce vide après la joie?
Ce dénuement après la gloire?
Ce néant qui fut une ville
Qui répondra? Rien que le vent
Qui remplace le chant des poètes?
Et disperse les âmes jadis rassemblées.»
Une telle sensibilité nous fait plutôt incliner en faveur de cette figure emblématique de l’amour du prochain, de la rencontre avec l’autre, bref de la tolérance que nous lègue Mohrez Ibn Khalef. Celui-ci cultivait le sens de l’humain. Ce faisant, il creusa un sillon dans celui de l’histoire.
L’Ariana, son village natal, deviendra plus tard et durant un siècle un village œcuménique. J’y suis né. Mon enfance fut nourrie par ce melting-pot que représentait le rassemblement des trois communautés musulmane, juive et chrétienne. Mon cheminement était jalonné par les repères des trois cultes des descendants d’Ibrahim: la mosquée, la Ghriba dans le centre historique et l’église dans le quartier dit européen.
En rejoignant le collège Sadiki à Tunis tous les jours qu’offrait le bon Dieu, j’étais émerveillé par les volumes impressionnants et les marques de majesté de la Synagogue de l’avenue de Paris, de la Cathédrale Saint-Vincent de Paul de l’Avenue Bourguiba et de la Mosquée Ezzitouna près de la Casbah.
Ces repères perdurent. Ils illuminent aujourd’hui encore notre chemin vers le bonheur. Le bonheur de vivre ensemble non pas en dépit mais grâce à notre diversité culturelle. Le bonheur de donner et de recevoir. Albert Memmi écrivit un jour cette admirable sentence: «Ne demandez rien! Donnez! Il vous sera suffisamment rendu».
A l’Ariana, une rue porte désormais le nom d’un médecin juif qui avait autant servi que soigné, durant quarante ans, les trois communautés Arianaises. Dr Sauveur Soria rejoint ainsi Mohrez Ibn Khalef et Saint Augustin, l’apôtre du Christianisme des lumières qui avait écrit «Tolère, tu es né pour cela, tolère, car toi aussi tu auras un jour besoin d’indulgence» dans le panthéon des grandes hommes auxquels l’humanité tout entière est reconnaissante.
Aissa Baccouche
- Ecrire un commentaire
- Commenter