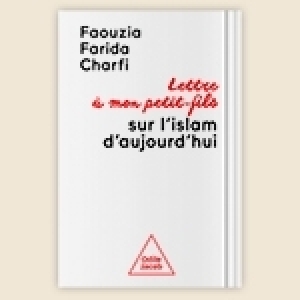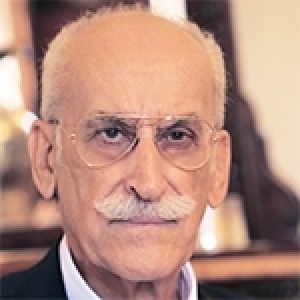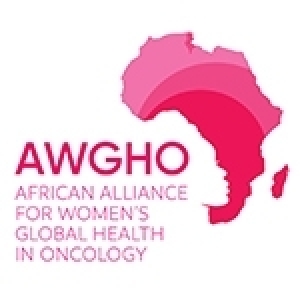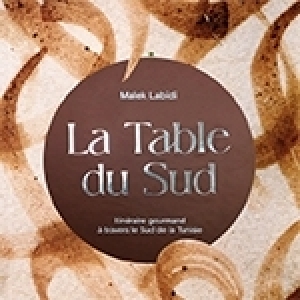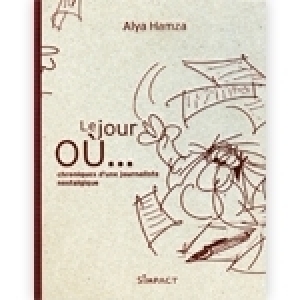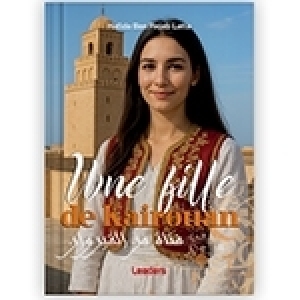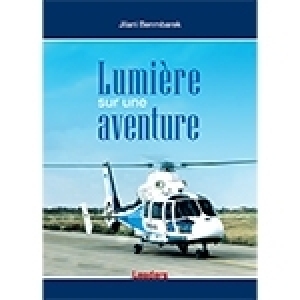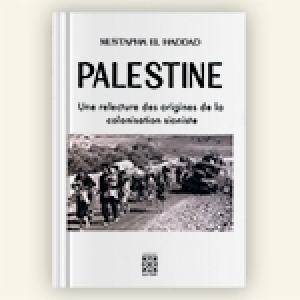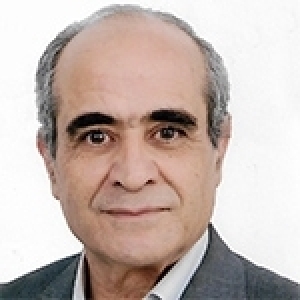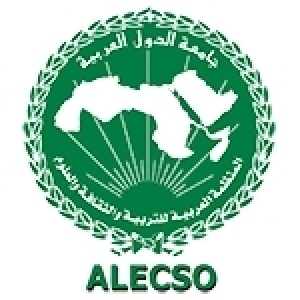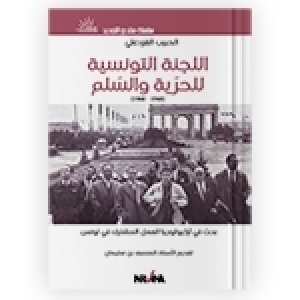COP 30: un lieu de rivalité et de collaboration

Par Pr Samir Allal
La diplomatie climatique est une arène où les pays se livrent une rude concurrence
Le monde est en train de vivre un épisode de transformations profondes provoquées par la crise climatique et ses conséquences socio-économiques. Notre capacité à gérer politiquement les incertitudes de cette période déterminera la qualité de vie, la sécurité et la prospérité de tous et toutes dans un avenir proche.
L'une des leçons les plus angoissantes des sciences contemporaines est que l'impact des activités humaines sur la planète n'est probablement pas graduel, mais connaît des points d'inflexion (tip-ping points) irréversibles, ce qui rend cet élément temporel plus pressant encore pour accélérer la décarbonation.
Or, dix ans après l'accord de Paris, le climat semble ne plus être une urgence pour les responsables politiques et les industriels du carbone. En cause ? Une vague réactionnaire, suprémaciste et raciste qui déferle sur le monde et fait de la transition écologique une cible à abattre, déployant des efforts tous azimuts pour nous maintenir à l'ère des énergies fossiles.
La diplomatie climatique est une arène où les pays se livrent une rude concurrence, ce qui en reconfigure les priorités: rivalité pour le leadership dans les technologies propres, l'accès aux matières premières critiques, l'influence géopolitique et le financement climatique. Sans compter que cette fois, le désengagement des Etats-Unis de Trump n'est pas seulement passif; il se mue en une opposition active à l’action climatique collective.
Le consensus sur la nature de la crise et ses principales causes est désormais parfaitement établi, même s'il fait l'objet d'attaques sans cesse renouvelées. Ces attaques sont pourtant moins la conséquence d'une incapacité à admettre le régime de vérité scientifique en général que du refus d'en admettre les conséquences politiques du changement climatique.
Partout sur la planète, les écosystèmes sont au bord de l'effondrement. La température augmente si vite que certaines parties de la biosphère sont déjà en passe de devenir inhabitables et les pires scénarios climatiques sont en train de se réaliser. Si la réalité de la catastrophe est désormais incontestable, l'écologie politique se dispute sur ses causes.
Ce qui se dessine aujourd’hui, c’est une véritable symbiose entre deux formes de chaos: l’un, climatique, qui échappe de plus en plus à nos modèles prédictifs et bouleverse notre quotidien par des phénomènes extrêmes de plus en plus fréquents et l’autre, politique et technologique, qui, de manière intentionnelle, capitalise sur cette incertitude pour redéfinir les règles du jeu.
Les «ingénieurs du chaos», comme les appelle Giuliano Da Empoli et les «élites technologiques» transforment chaque crise en opportunité, créant ainsi un nouvel ordre mondial où l’instabilité devient une ressource. Dans ce monde où le chaos climatique devient la toile de fond de notre quotidien, cette nouvelle élite, que Giuliano que Da Empoli nomme les «Borgia modernes», émerge et redessine les contours de notre réalité.
La catastrophe est déjà là, mais nous pouvons empêcher la survenue du cataclysme
Le climat n’est plus seulement l’arrière-plan des décisions économiques et politiques – il est devenu un acteur scénarisé. Ce qui circule dans l’espace public n’est pas la complexité des interactions atmosphériques, mais une version filtrée, hiérarchisée, et souvent tarifée du savoir climatique. Bernard Kalaora (AOC, 0ctobre 2025). Le savoir climatique, autrefois bien commun, est devenu une rente d’expertise.
Aujourd’hui, la montée des tensions géopolitiques et la nécessité induite de rétablir la compétitivité numérique, technologique et industrielle semblent changer la donne. La résurgence de conflits commerciaux place les pays en transition en porte-à-faux dans la mesure où ses régulations peuvent être considérées comme des barrières non tarifaires et remises en cause dans le cadre de négociations commerciales agressives.
Ce climat international pousse les États à s’interroger sur la soutenabilité de leur cadre régulatoire et sur la nécessité de les adapter ou de repenser leurs modalités d’application. Après une ère de convergence des modèles économiques et de coopération internationale, la question de la gouvernance climatique et économique internationale est posée.
Ces enjeux sont centraux pour les politiques publiques et les stratégies d’entreprises. Ils interrogent également les cadres académiques de réflexion, impliqués dans la transformation numérique, la transition écologique et la régulation climatique:
• Doit-on s’attendre à une fragmentation irrémédiable autour de quelques pôles régionaux totalement étanches, ou la coopération est-elle encore possible?
• Faut-il imputer la crise à des traits anthropologiques fondamentaux de l’espèce humaine, son insatiable et éternel désir de consommation?
• Faut-il au contraire incriminer des modes de pensée typiquement modernes?
• Ou alors, serait-ce le cumul de choix technologiques inadaptés qui nous aurait insidieusement conduits à la situation actuelle?
• L'économie capitaliste serait-elle la principale responsable du désastre?
Les différentes approches de l'écologie politique divergent sur la façon de comprendre l'histoire de la catastrophe climatique. Elles proposent des pistes qui, sans être toujours contradictoires ou exclusives, n'en mettent pas moins l'accent sur des tendances différentes au sein des sociétés modernes.
Certains insistent sur l'insatiabilité humaine dont témoignerait le désir effréné de consommation, d'autres sur la marchandisation, le productivisme et la croissance et insistent sur l'histoire coloniale ou sur le capitalisme dominant l’homme et la nature.
Si le déni, minoritaire, de la crise climatique s'exprime avec virulence, il recouvre des réalités différentes: les climatosceptiques contestent la réalité du changement climatique parce qu'ils sont opposés à l'écologie politique et au progrès; pour eux, il s'agit d'un complot, des élites, de la Chine. Pour tous les autres, c'est plutôt le fatalisme et le sentiment d'impuissance qui dominent, comme le refus de modifier leur mode de vie.
Pour Daniel Tanuro «Les causes de la catastrophe environnementale sont liées aux tendances inhérentes au capitalisme, si bien que conjurer le désastre climatique suppose la constitution de nouvelles alliance climatique».
L'exposé des faits scientifiques sur les causes et les conséquences de la crise climatique ne suffit plus à mobiliser. En tout cas, il ne se traduit que faiblement par un passage à l'action, qu'elle soit individuelle ou politique et collective.
La réponse à la crise climatique passe en premier lieu, par un changement de système, à la fois économique, social et politique. Mais, à l'heure de la segmentation des publics par les réseaux sociaux et par la communication politique, la réponse efficace à la crise climatique passe par des stratégies de communication et de mobilisation différenciées.
La lutte contre la crise climatique doit passer aussi, par la démonstration de l'efficacité de l'action collective sur des problèmes qui préoccupent directement les gens. S'il est important de mettre en œuvre des stratégies différenciées en fonction du public visé, il est tout aussi essentiel que celles-ci soient coordonnées.
Tenir la corde quand tout incite à la couper
Le débat sur la gouvernance climatiques mondiale fait l'objet d'expertises contradictoires et soulève des passions positives comme négatives extrêmement puissantes. L’ordre économique, géopolitique et démocratique tient à la réponse qui sera apportée à l'épuisement du modèle de développement fossile encore largement prédominant.
A Belém (Brésil), la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations pour le climat (COP 30), s’ouvre en pleine instabilité climatique et à un moment où la confiance dans les capacités de succès de la gouvernance multilatérale s’érode : plus de rivalité et moins de collaboration face à l'urgence de la transition.
La COP30 est la troisième étape cruciale pour l'Accord de Paris. C’est là que les pays sont censés mettre à jour et renforcer leur Contribution Déterminée au Niveau National (CDN, plans nationaux d'action climatique non contraignants élaborés par chaque pays pour remplir les objectifs des accords de Paris), marqueur de leur ambition en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Pourtant, fin octobre, seule une minorité de pays avaient soumis des engagements révisés. La majorité des émissions mondiales ne sont pas prises en charge par des objectifs crédibles ou mis à jour pour 2035. La promesse centrale des accords de Paris - rehausser progressivement l'ambition climatiques tous les cinq ans - est fortement mise à l’épreuve.
La présidence brésilienne de la COP 30 est sur tous les fronts : jouer les intermédiaires, adopter des récits mobilisateurs, définir les priorités. Sa volonté affichée est d’empêcher une nouvelle érosion de la confiance entre le Nord et le Sud. Pays-hôte de la COP, le Brésil veut recentrer les négociations sur les forêts, la biodiversité et le financement et imposer la notion de "transition axée sur le développement".
Une fois de plus, le financement de la transition sera la question pivot de la COP 30. Il constitue une ligne de fracture récurrente, jamais entièrement résolue. Le Nouvel Objectif Collectif Quantifie (NCQG) doit être actualisé pour la période post-2030.
En effet, l'accord obtenu lors de la COP29 (objectif ambitieux de 1 300 milliards de dollars de flux annuels de financement climatique et un minimum de 300 milliards de dollars par an en financement public d'ici 2035), est largement considéré comme insuffisant face à l'ampleur des investissements requis.
Pour parvenir à l’objectif de +1,5°C, il faudrait entre 4 et 5 billions dollars d’investissements annuels dans l'énergie propre d'ici 2030, soit environ le triple des niveaux actuels. La situation économique et géopolitique actuelle n’incite pas à l’optimisme.
L'essentiel du débat et des conflits auxquels donne lieu l'impératif climatique va dépendre de la traduction véritablement politique des engagements prises. Toute politique est désormais, une politique climatique.
Nous savons que l'industrie, les transports, le logement et l'agriculture, autrement dit les piliers de l'économie mondiale et de la vie quotidienne, doivent être remodelés. Nous savons aussi, cela a été intégré aux conclusions du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), que seule une transition écologique juste est possible, tout simplement parce qu'elle doit être acceptée par une majorité de la population, qui la considérera comme étant dans ses intérêts à proche et moyen terme.
Les affrontements à l’échelle nationale et internationale autour de la transition écologique et énergétique dessinent une ligne de clivage entre une coalition favorable au changement que Pierre Charbonnier appelle «la coalition climat» et une autre qui lui fait face, «la coalition fossile».
Pour Pierre Charbonnier: «L'économie politique capitaliste s'accorde bien avec l'âge des fossiles et n'inclut pas de dispositifs de freinage ou de choix technologique radical, une partie significative des perdants de cet ordre économique reste inféodée, par conviction ou par nécessité, au monde que ces énergies ont créé.»
Le déclin nécessaire de certains secteurs industriels et de certains usages du monde ne se fait donc pas sans réaction. Pour Pierre Charbonnier «L'une des choses qui entravent la compréhension pleinement politique de la crise climatique est son confinement dans un problème d'autorité des sciences (pourquoi n'écoutons-nous pas les scientifiques ?), de choix technologiques (comment produire de l'électricité ?), ou encore de salut planétaire (comment réconcilier l'homme et la Terre ?). Ces questions sont à l'évidence importantes, mais elles ne peuvent être séparées du reste des enjeux socio-économiques et idéologiques.»
La fragilité de l'économie politique contemporaine et du compromis social qui l'accompagne est généralement décrite comme une crise endogène, c'est-à-dire attribuable aux vices de conception de la globalisation et à l'échec des dispositifs de contrôle existants, en particulier la dette publique.
À cela s'ajouterait de façon de plus en plus nette une crise considérée comme exogène, provoquée par les externalités écologiques du mode de production et de reproduction industriel, que ces dispositifs n'arriveraient pas non plus à contrôler.
Présenté ainsi le lien entre la crise du climat et celle de l'ordre socio-économique est un lien faible, dans la mesure où il s'agit d'une rencontre entre deux trajectoires causales l'un de l'autre. Pour Pierre Charbonnier: «il est possible de lier de façon plus structurelle ces deux crises, de sorte que la seconde n'apparaisse plus, précisément, comme exogène.»
Autrement dit, le caractère endogène de la crise climatique par rapport à l'organisation socio-économique prédominante constitue un enjeu empirique et théorique majeur. La question climatique se pose au niveau de l'humanité et de son appartenance à la planète, mais elle se reflète dans l'expérience immédiate des individus via les infrastructures dans lesquelles ils vivent, les modèles de croissance qu'ils font fonctionner, les conflits qui les opposent, localement et à l'échelle internationale.
Nous vivons une période marquée par le développement de systèmes idéologiques conçus soit pour contourner, nier, repousser l'impératif du changement technologique et social, soit pour envisager une transition effective, mais sans conséquence politique. L'économie insoutenable ne tient que par l'action d'acteurs clés de l'industrie, qui amalgament leurs intérêts à ceux de l'État et des consommateurs.
Tout projet consistant à embrasser la transformation écologique comme un horizon de prospérité et de sécurité affranchi de l'expansion matérielle indéfinie apparait comme minoritaire et fragile, écrasé entre deux perspectives qui aujourd'hui occupent le centre de l'espace politique mondial, et encore très majoritaire au sein des COP.
Climat et démocratie, pour un nouvel imaginaire positif et entraînant
Face à la crise climatique, le catastrophisme, même éclairé, ne suffit pas ; les faits non plus. Gagner la bataille culturelle pour le climat passe par la construction de nouveaux imaginaires: un imaginaire positif et entraînant, porteur d'espoir et de confiance.
La meilleure façon de construire ces nouveaux imaginaires est sans doute de créer l'espace, notamment politique, depuis les situations réelles, les relations humaines et les expériences collectives, pour leur donner naissance.
Les partis nationaux populistes surfent sur une vague de colère et de ressentiment, légitime, d'une partie de la population. Ils ont fait du climat, comme de la démocratie libérale, leur ennemi. A mesure que la démocratie s'effrite et perd en légitimité et en efficacité, ce sont les conditions de l'action pour le climat qui se dérobent.
Dans la plupart des cas, comme aux Etats-Unis de Trump, les régimes autoritaires se caractérisent par un déni total et même une dissimulation des impacts de la crise climatique sur leur propre territoire. C'est ce que nous avons vu hier au Brésil avec Jair Bolsonaro). C'est ce que nous voyons aujourd'hui avec Javier Milei en Argentine et Viktor Orbán en Hongrie (…) demain avec Marine Le Pen.
Ces régimes ont depuis longtemps compris une règle simple : diviser pour mieux régner. Autrement dit: trouver un bouc émissaire (l’immigré, le jeune, la femme) et exacerber les antagonismes. Les réseaux sociaux, désormais principale source d'information devant les médias traditionnels, sont utilisés comme des armes dans leur guerre hybride.
La démocratie s’érode par glissement thermique: trop lente pour rivaliser avec les smart territoires ou territoires intelligents, le territoire devenant un produit à monétiser, où les citoyens sont transformés en capteurs mobiles (leurs corps, leurs gestes, leurs trajets, leurs achats, leurs affects sous contrôle).
L’optimisation technique remplace la décision collective. On pilote par algorithme, pas par le débat. Les entreprises qui gèrent les plateformes détiennent un pouvoir considérable sur l’espace public, souvent hors contrôle démocratique. Leur objectif est de semer le trouble et la confusion, plus encore que d'imposer une version de la vérité.
De ce point de vue, les adversaires de la démocratie et les lobbyistes des énergies fossiles ont les mêmes méthodes: introduire toujours plus de doutes, qui n'ont rien à voir avec le doute méthodologique scientifique ni l'esprit critique, et instiller que toute vérité serait relative. Les citoyens, épuisés de canicules et de notifications cèdent au fétichisme de la solution clé en main.
Un autre récit est possible: se battre non seulement pour sauver la planète mais pour se sauver soi. Se lever, se tenir et rester droit, ignorer le fatalisme sans ignorer la réalité, penser que construire une bonne vie, c'est se construire sur des convictions, et que, dans cette lutte pour éviter la catastrophe, nous sommes, tous, embarqués.
Alors autant les prendre de front, et inspirés par Victor Hugo nous enjoignant de «prendre corps à corps le destin, étonner la catastrophe par le peu de peur qu'elle nous fait», trouver l'énergie avec tous ceux qui sont prêts à en donner.
En ne transformant pas les rapports sociaux inégalitaires, l'écologie dominante dépossède, désavantage et divise les classes populaires, premières victimes de la crise écologique. Pour se mettre pleinement à leur service, l'écologie doit au contraire politiser l'injustice écologique qu'elles subissent.
Cela implique de lier la question écologique à la rupture avec l'ordre économique et social «écocidaire», pour construire une société affranchie du fossile. Il y a donc une «lutte écologique des classes sociales» à mener. Elle pourra mobiliser non seulement les classes populaires, mais aussi des franges de la bourgeoisie culturelle précarisée de moins en moins attachées à l'ordre social carboné.
Sur la base de cette nouvelle alliance de classe, l'écologie transformatrice pourrait imposer un rapport de force capable d'instituer une société valorisant des modes d'existence immédiatement respectueux des grands équilibres de la vie sur Terre. Les pro-carbones sont trop puissants pour que l'agrégation de quelques forces dispersées suffise à les renverser.
La lutte contre la destruction du monde impose une mobilisation massive des puissances d'émancipation et la composition d'une nouvelle force sociale appelée à renverser les pouvoirs du capital et du fascisme fossiles: «l’alliance climat». Le capitalisme est structurellement dépendant des énergies fossiles qui constituent la principale cause du réchauffement climatique.
Les nouveaux conquistadors (l’alliance fossile), armés de technologies de pointe, de finance débridée et d’idéologies ultra-libérales, jouent avec les incertitudes. Ils profitent de l’instabilité chronique induite par les canicules, l’érosion de la biodiversité, les tempêtes imprévisibles, pour imposer leur vision d’un futur affranchi des contraintes traditionnelles.
Pendant que les canicules se multiplient, que les tempêtes deviennent monnaie courante et que l’érosion des côtes menace des populations entières, ces élites façonnent un futur où l’instabilité n’est plus une menace, mais une ressource. En transformant chaque crise en opportunité, ils consolident leur pouvoir, laissant les structures démocratiques traditionnelles fondre comme glace au soleil.
En fin de compte, cette « alliance fossile » entre finance, technologie et politique redéfinit les règles du jeu. Le chaos climatique, bien qu’involontaire, devient l’allié inattendu d’une élite qui sait transformer l’incertitude en atout, façonnant un avenir où le pouvoir appartient à ceux qui maîtrisent l’art de la jonglerie numérique.
Ce parallèle entre l’imprévisibilité du climat et celle de la géopolitique met en lumière les négociations au sein des COP, une ère où l’adaptation et la résilience deviennent des maîtres-mots, et où le pouvoir appartient à ceux qui savent naviguer dans l’incertitude.
Dans ce nouveau contexte, l’innovation technologique et les dynamiques financières ne sont plus simplement des outils de développement, mais deviennent de véritables leviers de pouvoir, permettant à ceux qui les maîtrisent de façonner l’avenir.
Pr Samir Allal
Université de Versailles-Saclay
Lire aussi
Samir Allal - Une COP et après : le capitalisme prédateur à l’épreuve du climat
- Ecrire un commentaire
- Commenter