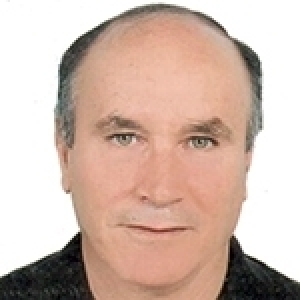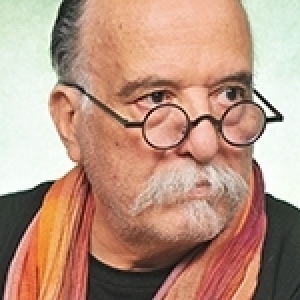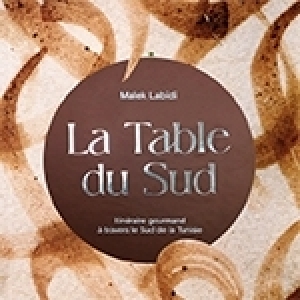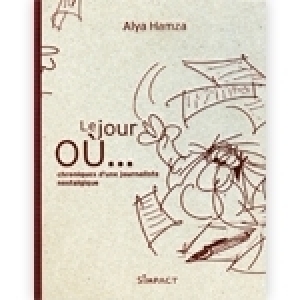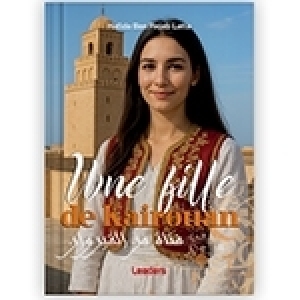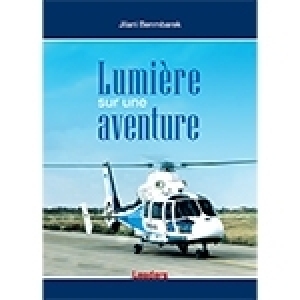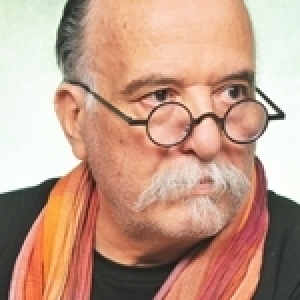Elyes Ghariani: Comment la résolution sur le Sahara occidental peut débloquer l’avenir de la région

La résolution adoptée par le Conseil de sécurité de l’ONU le 30 octobre 2025, qui appuie le plan marocain d’autonomie sous souveraineté, marque un tournant diplomatique majeur. Décryptage.
Le Sahara occidental, fracture géopolitique et défi méditerranéen
La Méditerranée reste un carrefour stratégique où s’entremêlent rivalités géopolitiques, enjeux sécuritaires, défis énergétiques et pressions migratoires. Au cœur de cette zone d’instabilité, la fracture maghrébine agit comme une faille structurelle qui affaiblit la rive sud au moment même où celle-ci cherche à se stabiliser.
Le conflit du Sahara occidental, gelé depuis près d’un demi-siècle, en est l’expression la plus visible. Bien plus qu’un différend territorial, il symbolise le blocage d’une intégration régionale pourtant indispensable à la prospérité du Maghreb et à l’équilibre de la Méditerranée.
Depuis 1975, ce territoire oppose le Maroc — qui en contrôle la majeure partie — au Front Polisario et à la République arabe sahraouie démocratique (RASD), soutenus par l’Algérie. Malgré un cessez-le-feu fragile et la présence de la MINURSO, les négociations n’ont jamais abouti à une solution durable.
Cinquante ans après le début du conflit, le «coût du non-Maghreb» — économique, sécuritaire et humain — atteint un niveau insoutenable. Sans une volonté politique de part et d’autre, cette fracture continuera de peser sur la stabilité du Maghreb et d’hypothéquer l’avenir de toute la Méditerranée.
Le coût du non-Maghreb: un potentiel économique et humain sacrifié
Une intégration économique inachevée
La fragmentation du Maghreb a un coût tangible : selon la Banque mondiale, le «non-Maghreb» prive la région de 13 à 16 milliards de dollars par an. Ce manque à gagner résulte des frontières fermées, de l’absence d’infrastructures transfrontalières et de chaînes de valeur régionales paralysées — un paradoxe dans un espace où la proximité géographique devrait naturellement favoriser les échanges.
Symbole éclatant de cette impasse: la frontière entre le Maroc et l’Algérie, close depuis 1994. Au-delà de son poids symbolique, elle incarne l’absence d’une vision commune d’intégration économique, indispensable pour rivaliser avec d’autres ensembles régionaux. L’harmonisation des politiques douanières, des normes commerciales et des réseaux logistiques demeure un défi majeur, maintenant la région dans une sous-performance chronique.
Une transition énergétique entravée
Le Maghreb recèle d’immenses atouts: ressources gazières abondantes et potentiel exceptionnel en énergies renouvelables. Pourtant, faute d’interconnexions, ses infrastructures énergétiques restent fragmentées et sous-exploitées. Le Gazoduc Maghreb-Europe ou les terminaux de GNL en sont des exemples : leur manque de coordination prive la région d’une sécurité énergétique collective et limite les investissements conjoints, notamment dans l’hydrogène vert, le solaire et l’éolien.
Ce cloisonnement est d’autant plus regrettable que l’Europe, en quête de diversification énergétique, pourrait trouver dans le Maghreb un partenaire stratégique. L’absence de coordination régionale freine ainsi une dynamique qui aurait pu bénéficier aux deux rives de la Méditerranée.
Un bilan humain et social préoccupant
Les effets du «non-Maghreb» dépassent le domaine économique:
• Camps de Tindouf: des milliers de Sahraouis y vivent depuis des décennies dans une précarité persistante, dépendants de l’aide internationale et privés d’un avenir stable.
• Pressions migratoires: la Tunisie, en première ligne, subit les conséquences de l’absence de coopération régionale. Les flux migratoires subsahariens, mal gérés, exacerbent tensions sociales et insécurité, tandis que la Méditerranée reste le théâtre de tragédies humaines.
• Fuite des compétences: chaque année, des milliers de jeunes diplômés quittent le Maghreb pour l’Europe ou le Golfe, privant la région de son capital humain et accentuant le déficit en compétences.
Une coopération régionale en panne
L’Union du Maghreb Arabe (UMA), créée pour promouvoir l’unité régionale, demeure paralysée par les divergences entre États membres, chacun privilégiant ses intérêts nationaux. Faute de volonté politique, les projets communs stratégiques n’aboutissent pas, privant le Maghreb de toute capacité à peser collectivement sur la scène internationale.
Un constat urgent
Le «coût du non-Maghreb» ne se limite pas à des pertes financières. Il se traduit par:
• des opportunités économiques gâchées,
• des crises sociales non résolues,
• et une vulnérabilité croissante face aux défis sécuritaires et géopolitiques.
Alors que d’autres régions du monde renforcent leur intégration, le Maghreb demeure prisonnier de ses divisions. L’enjeu est désormais clair : renouer le dialogue, dépasser les rivalités et transformer cette fracture en levier de développement partagé.
De la rivalité régionale aux tensions sécuritaires en Méditerranée: un équilibre fragile
Une militarisation croissante et ses répercussions régionales
Les divisions persistantes au Maghreb alimentent une escalade sécuritaire où la rivalité entre le Maroc et l’Algérie occupe une place centrale. Ces dernières années, les deux pays se sont engagés dans une course aux armements qui dépasse le cadre régional pour s’inscrire dans des logiques géostratégiques globales.
Cette dynamique de réarmement, doublée d’une diplomatie sécuritaire active, accroît le risque d’escalade autour du Sahara occidental, où le cessez-le-feu supervisé par la MINURSO depuis 1991 demeure fragile. La multiplication des incidents frontaliers rend cet équilibre précaire et menace de déborder les frontières bilatérales.
La Libye, foyer d’instabilité et d’ingérences extérieures
La crise libyenne accentue cette fragilité. Divisée entre un gouvernement à Tripoli et des forces rivales à l’Est, la Libye est devenue un théâtre d’ingérences étrangères où mercenaires et trafics d’armes prolifèrent. Ce chaos nourrit une rivalité indirecte entre Alger et Rabat, chacun cherchant à préserver ses intérêts.
La porosité des frontières et la faiblesse institutionnelle des États maghrébins favorisent en outre l’enracinement de groupes jihadistes transnationaux (AQMI, Daech Sahara), qui exploitent les failles sécuritaires. Ces réseaux étendent leur influence du Sahel jusqu’aux confins du Maghreb, fragilisant davantage la région.
La Méditerranée, théâtre d’une compétition géopolitique pluripolaire
La fragilité maghrébine s’inscrit dans une Méditerranée redevenue un espace de compétition mondiale. Carrefour stratégique concentrant 25 % du trafic maritime et 30 % des échanges pétroliers, le bassin méditerranéen attire les convoitises:
• Les États-Unis, malgré leur recentrage sur l’Indopacifique, maintiennent une présence militaire significative, garantissant leur influence.
• La Russie, profitant des tensions régionales, renforce son ancrage en Syrie, en Libye et au Sahel, s’imposant comme puissance d’équilibre alternative.
• La Chine, quant à elle, privilégie une approche économique — investissements portuaires, corridors commerciaux — et accroît son influence sans ambitions militaires affichées.
Dans ce contexte pluripolaire, la stabilité du Maghreb devient un enjeu géopolitique central. La capacité des acteurs régionaux à surmonter leurs rivalités déterminera leur aptitude à relever les défis énergétiques, sécuritaires et migratoires qui conditionnent l’équilibre de la Méditerranée.
Le pivot diplomatique: une résolution aux lectures contrastées
Un tournant stratégique occidental
Le 30 octobre 2025, le Conseil de Sécurité a adopté une résolution historique — la 2797 — soutenant le plan marocain d’autonomie sous souveraineté. Appuyée par les puissances occidentales (États-Unis, France, Royaume-Uni), cette initiative marque un tournant majeur dans la quête d’une solution à un conflit gelé depuis plus de cinquante ans, redéfinissant les équilibres diplomatiques au Maghreb.
Cette position s’inscrit dans une logique de réalisme : le Maroc, qui administre la majeure partie du territoire, présente depuis 2007 son plan d’autonomie comme la voie la plus praticable vers une issue politique. La diplomatie marocaine, forte d’un réseau d’alliances en Afrique subsaharienne et auprès des puissances occidentales, a su présenter ce projet comme un gage de stabilité et de développement durable.
Des lectures divergentes, reflet des clivages régionaux
Cette résolution, loin de faire consensus, a révélé les lignes de fracture persistantes.
• Pour le Maroc, elle représente une victoire diplomatique majeure et la reconnaissance de son rôle stabilisateur dans la région.
• Pour l’Algérie et le Front Polisario, elle constitue une violation du principe d’autodétermination et une légitimation implicite de la tutelle marocaine.
• L’UE et l’ONU, quant à elles, adoptent une position prudente, reconnaissant les réalités du terrain tout en réaffirmant la nécessité d’une solution négociée, inclusive et conforme au droit international.
Entre principe et réalisme: un équilibre à trouver
Au cœur de ce débat se joue la tension entre le principe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et le réalisme diplomatique qui privilégie la stabilité régionale. Cette équation complexe illustre la difficulté de concilier justice historique et paix durable.
Les puissances abstentionnistes, comme la Russie et la Chine, adoptent une posture ambiguë, refusant de s’aligner ouvertement tout en cherchant à préserver leurs leviers d’influence en Méditerranée. Ce flou stratégique traduit la rivalité silencieuse des grandes puissances dans un espace hautement compétitif.
Vers une lecture pragmatique et constructive
Ce pivot diplomatique appelle une approche mesurée : après un demi-siècle d’immobilisme, la résolution du conflit du Sahara occidental apparaît comme une condition essentielle à l’émergence d’une dynamique maghrébine et méditerranéenne stable. L’enjeu n’est plus de choisir entre principe et réalisme, mais de trouver un équilibre nouveau — fondé sur le dialogue et la recherche d’un compromis durable — pour transformer cette fracture historique en levier de stabilité et de prospérité partagée.
Vers une Méditerranée stable?
Deux trajectoires possibles pour le Sahara occidental
L’année 2025, marquée par la résolution du Conseil de sécurité, ouvre une fenêtre d’opportunité — mais aussi de vulnérabilité — pour le Sahara occidental. Deux scénarios se dessinent clairement:
• L’immobilisme persistant: faute de convergence diplomatique, la MINURSO risquerait de demeurer un simple observateur, sans avancée tangible vers la paix. Le conflit resterait figé, perpétuant le « coût du non-Maghreb » — blocages économiques, tensions sécuritaires, radicalisation des jeunes Sahraouis. Ce statu quo minerait la crédibilité des institutions internationales et ferait peser un risque d’escalade durable sur la région.
• Le déverrouillage progressif: si les conditions stratégiques s’y prêtent, une reprise des négociations directes entre le Maroc et le Front Polisario, sous l’égide de l’ONU et avec une implication accrue de l’Union africaine, pourrait émerger. L’acceptation graduelle du plan d’autonomie marocain, assortie de garanties solides pour les droits politiques et culturels des Sahraouis, ouvrirait la voie à un règlement durable. La réouverture des frontières algéro-marocaines constituerait alors un signal fort de réconciliation, libérant un potentiel économique et diplomatique aujourd’hui étouffé.
Recommandations pour un Maghreb réconcilié
• Pour le Maroc: transformer la victoire diplomatique en dynamique concrète.
Mettre en œuvre une autonomie crédible, fondée sur une gouvernance inclusive et respectueuse des droits humains, tout en faisant du développement du Sahara occidental un levier de paix grâce à des projets structurants — énergies renouvelables, agriculture durable, infrastructures intégrées.
• Pour l’Algérie: incarner un rôle stabilisateur. La réouverture des frontières avec le Maroc doit devenir une priorité stratégique, non seulement pour relancer l’économie régionale, mais aussi pour apaiser le climat sécuritaire. Alger pourrait affirmer son rôle de pilier politique dans une dynamique maghrébine renouvelée.
• Pour l’ONU et la communauté internationale: renforcer le cadre de médiation et de protection. La MINURSO devrait évoluer vers un mandat proactif de facilitation du dialogue, accompagné de mécanismes crédibles de suivi des droits humains, afin de garantir la confiance et la transparence du processus.
La Méditerranée, laboratoire d’une nouvelle coopération
La stabilité du Maghreb ne peut s’envisager isolément. Elle doit s’inscrire dans une dynamique euro-méditerranéenne repensée:
• Le Pacte pour la Méditerranée (2025), initié par l’UE, pourrait ancrer durablement le Maghreb dans une logique d’intégration économique et sociale. Les projets de connectivité — transports, énergie, numérique — doivent être accélérés pour créer des interdépendances positives et réduire les tensions.
• Le format 5+5 Défense, réunissant pays européens et maghrébins, doit être renforcé pour contrer les menaces hybrides, le terrorisme transnational et la criminalité organisée. Une coopération sécuritaire efficace ferait de la Méditerranée un modèle de stabilité partagée.
Un équilibre à construire : réconciliation ou stagnation ?
Le Sahara occidental peut demeurer le symbole d’un conflit sans fin ou devenir le catalyseur d’une réconciliation historique. Tout dépendra de la capacité des acteurs à conjuguer:
• le réalisme, en reconnaissant les équilibres de pouvoir;
• l’inclusivité, en garantissant les droits légitimes des Sahraouis;
• et la coopération régionale, en misant sur une intégration économique et sécuritaire progressive.
La Méditerranée ne retrouvera sa vocation de paix et de prospérité que si le Sahara occidental cesse d’être une fracture et devient un pont. Les années à venir seront décisives pour savoir si la région choisira l’immobilisme ou osera la réconciliation.
Le Sahara occidental: miracle ou mirage méditerranéen?
Le Sahara occidental n’est pas seulement un conflit territorial gelé ; il est devenu l’épreuve de vérité du Maghreb et de la Méditerranée. Saura-t-on transformer cette fracture historique en levier de stabilité, ou laissera-t-on cette crise hypothéquer l’avenir d’une région tout entière? L’enjeu dépasse désormais les frontières : il s’agit de savoir si les acteurs régionaux et internationaux sauront placer l’impératif de paix au-dessus des rivalités, ou si la logique des blocs continuera d’alimenter la division et l’instabilité.
Une solution durable ne peut se limiter à une victoire diplomatique passagère ; elle doit servir de socle à une refondation maghrébine, capable de libérer le potentiel géopolitique, économique et humain d’une région en quête de cohérence.
Imaginez un Maghreb réuni, de Tanger à Tripoli — un pôle d’équilibre méditerranéen, un carrefour d’échanges florissants, une force de coopération multisectorielle. Ce n’est pas une utopie: c’est une nécessité stratégique.
Pour y parvenir, il faut oser l’audace:
• Transformer le plan d’autonomie en une gouvernance inclusive, garantissant aux Sahraouis leurs droits par des mécanismes transparents et crédibles ;
• Rouvrir les frontières non comme un symbole, mais comme l’acte fondateur d’une nouvelle ère de coopération économique et sécuritaire ;
• Convoquer une conférence maghrébine sous l’égide de l’Union africaine, réunissant Maroc, Algérie, Mauritanie, Tunisie, Libye et représentants sahraouis, afin de définir une feuille de route commune. Forte de sa légitimité panafricaine et de son expérience en médiation, l’UA offrirait le cadre neutre et structurant nécessaire pour dépasser les blocages historiques.
Le défi est immense, mais l’enjeu l’est davantage: faire du Sahara occidental non plus une cicatrice, mais un trait d’union, là où réalisme politique et justice historique se rejoignent enfin.
Le choix est désormais entre nos mains: perpétuer l’immobilisme ou écrire une nouvelle page de l’histoire maghrébine. L’heure n’est plus aux calculs tactiques, mais à la vision stratégique. Car, au bout du compte, le Sahara occidental ne sera pas seulement le miroir des ambitions méditerranéennes — il en sera le juge de paix.
Elyes Ghariani
Ancien ambassadeur
- Ecrire un commentaire
- Commenter