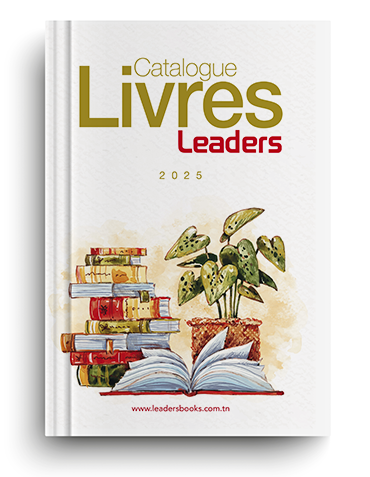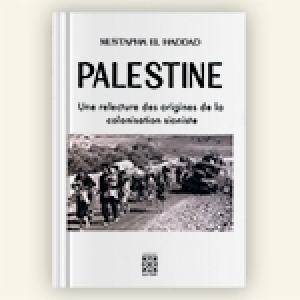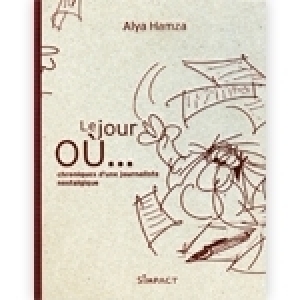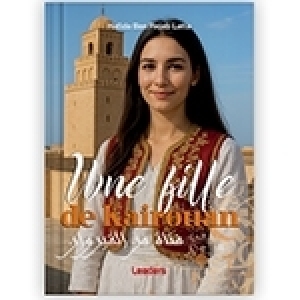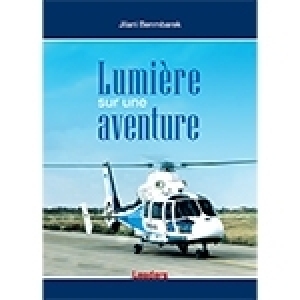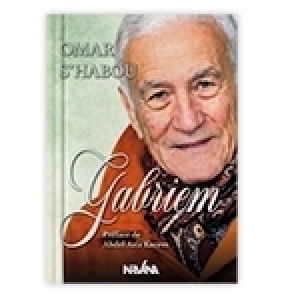Changement climatique: La raison économique peut-elle faire l’économie de la raison?

.jpg) Par Pr Samir Allal. Université de Versailles/ Paris-Saclay
Par Pr Samir Allal. Université de Versailles/ Paris-Saclay
1- Changer de trajectoire plus rapidement que nous ne le faisons aujourd’hui et prendre soin de nos communs globaux
Le réchauffement climatique est aujourd’hui un constat largement partagé. Les entreprises, les ménages, les gouvernements, tous assurent de leur engagement sans faiblesse dans la lutte pour le réduire et en atténuer les conséquences néfastes dont le dernier été nous a donné un aperçu.
Les émissions globales de gaz à effet de serre continuent à croître. Pire, alors que nous ne devrions pas émettre plus de 800 Gigatonnes supplémentaires pour espérer atteindre la cible des 1,5° C, le niveau actuel des émissions est autour de 40 Gigatonnes par an. A ce rythme la limite sera atteinte en 2040. Pourtant, c’est 2050 qui est la date qu’avancent les États pour atteindre les « zéro émissions nettes ».
Une conclusion s’impose : même en supposant que toutes les actions entreprises soient nécessaires, elles ne sont clairement pas suffisantes et il nous faut changer de trajectoire plus rapidement que nous ne le faisons aujourd’hui.
Actuellement, on peut classer les stratégies de lutte contre le changement climatique dans trois catégories : (1) les solutions anthropologiques qui consistent à chercher à modifier les comportements des acteurs, (2) les solutions institutionnelles et (3) les ‘appels à la raison ou la prise de conscience individuelle (la morale).
L’appel à la raison s’appuie sur les évidences scientifiques de la réalité du réchauffement et de ses conséquences, pour inciter les agents à réduire leur empreinte carbone. La collapsologie est représentative de cette approche.
Pour l’instant, on est obligé de constater qu’aucune de ces approches n’a permis d’obtenir une réduction des émissions globales.
Les solutions technologiques supposent l’existence de nouveaux processus de production fournissant une énergie verte, une alimentation saine, des transports non polluants, des logements avec moins de béton (qui représente entre 15 et 25% des émissions de CO2 sur leur cycle de vie). Pour l’instant ces processus nouveaux restent largement à inventer.
L’autre direction c’est la géo-ingénierie dont toutes les conséquences n’ont pas été étudiées. Ce serait un saut dans l’inconnu. Un pari risqué qui oublie que la technologie a toujours deux faces. L’une règle des problèmes et l’autre en créé des nouveaux. Il ne faut pas oublier que ce sont les technologies liées aux fossiles qui ont conduit au réchauffement actuel.
Quant aux solutions institutionnelles, la seule qui soit pratiquée aujourd’hui, ce sont les COP (dont la 27ème est programmée du 7 au 18 novembre 2022 à Charm el-Cheikh en Égypte). L’obstacle principal auquel elles se heurtent est celui de l’abandon de souveraineté qu’impliquerait une institution internationale ayant un pouvoir contraignant. Pour l’instant les États ne le souhaitent pas, bien au contraire, ce qui explique que, les émissions globales continuent à croître.
Là aussi la conclusion s’impose : Il devient de plus en plus difficile d’appeler « solutions » des orientations qui donnent d’aussi médiocres résultats.
2- Si les « solutions » n’en sont pas, faut peut-être revoir le diagnostic ?
Si le changement climatique, la perte de biodiversité et les pollutions diverses sont aujourd’hui difficilement discutables, il reste la question concernant les causes de ces dérèglements. Question évidemment essentielle si on souhaite vraiment lutter efficacement contre eux.
Deux réponses principales sont proposées:
La première, maintenant médiatisée sous le qualificatif d’anthropocène, fait porter la responsabilité de ces changements sur l’espèce humaine, qui, par nature, serait conduite à produire et consommer toujours plus.
Cette soif de croissance infinie dans un monde fini nous conduirait inexorablement dans le mur. La seule solution serait donc de changer nos comportements, solution globalisante, qui en mettant sur le même pied le milliardaire et le chômeur ; l’habitant des pays riches et l’habitant des pays en développement néglige trop la question des inégalités croissantes du monde réel pour être opérationnelle.
La seconde, partage l’idée d’une transformation nécessaire de nos modes de production et de consommation, mais en les appelant par leur nom : le capitalisme. Ce serait le capitalisme qui serait responsable de la crise globale de notre monde, écologique, sociale, économique, anthropologique. Sans doute est-il nécessaire de préciser ce que recouvre ce qualificatif de capitalisme, tant il est sujet à de multiples interprétations.
Sa logique profonde c’est la recherche sans fin du profit maximum qui transforme en marchandise toute chose susceptible d’en procurer. Ce qui compte dans le Produit Intérieur Brut (PIB), ce n’est pas la valeur d’usage des biens et services produits, c’est ce qu’ils peuvent rapporter par leur vente.
Il n’est pas bien difficile de donner de multiples exemples des conséquences néfastes de cette logique. Quand un produit révèle sa nocivité, comme le tabac, le téflon, le Mediator, l’amiante, aujourd’hui le pétrole ou les pesticides, l’industrie qui le fournit ou l’utilise commence par nier tout effet nocif, n’hésitant pas à engager des scientifiques et des experts à l’appui de ses dires.
Ensuite, quand les effets deviennent trop visibles, elle lutte sur le plan juridique pour échapper du mieux possible aux condamnations éventuelles. Enfin, elle promet de se transformer et de devenir le leader des changements nécessaires.
La société Total, est une des grandes entreprises qui vient d’être épinglée alors qu’elle connaissait depuis 50 ans les conséquences climaticides de son activité. Et aujourd’hui elle s’engage à devenir exemplaire tout en se préparant à extraire 2,2 milliards de barils en Ouganda.
Mais la dissimulation d’informations pouvant remettre en cause une production n’est pas la seule pratique qu’une entreprise soucieuse avant tout de ses profits met en place. Le gâchis d’intelligence humaine pour truquer les contrôles de normes comme l’a fait Volkswagen en donne un exemple.
On n’en finirait pas de donner des exemples de comportements d’entreprises dont les produits sont plus utiles pour augmenter leurs profits que pour leur utilité sociale. Et quand cette utilité existe, le profit reste le but visé, comme avec Pfizer, qui préfère vacciner les enfants des pays développés plutôt que les centaines de millions d’africains non solvables, au risque d’une relance de la pandémie.
C’est donc, la société qui devrait pouvoir décider de ce qui doit être produit dans l’intérêt général et pas les seuls propriétaires des moyens de production pour leur enrichissement personnel.
Tant qu’extraire un baril de pétrole, qu’émettre une tonne de CO2 ou licencier un travailleur seront rentables, ce baril sera extrait, cette tonne sera émise et ce travailleur sera licencié.
3- La "sobriété" une aubaine pour les entreprises, fuite en avant ou changement de cap ?
La sobriété est dans toutes les bouches. Les politiques et les institutions internationales s’en sont emparés. Mais en même temps qu’il s’est vulgarisé, nous assistons à un véritable brouillage du message.
Voici que la chasse au gaspi initiée par les gouvernements pour affronter les pénuries temporaires du conflit ukrainien est qualifiée de « plan de sobriété ». Voici que les institutions internationales (OCDE, AIE, Banque Mondiale, UE, …) s’emparent du terme pour évoquer tout ce qui vise à diminuer l’empreinte carbone de nos sociétés.
Ce brouillage voile en fait la profondeur de la remise en cause de notre régime de croissance à laquelle engage la sobriété.
Si la sobriété est juste une chasse au gaspi, essentiellement circonscrite à la climatisation et au chauffage des bâtiments ou limitant les transports par le télétravail ou le covoiturage, pour préserver les usages industriels, son impact sur la croissance est très limité : il s’agit essentiellement d’économiser des ressources fossiles que nous importons, avec un impact dérisoire sur le PIB.
Si la sobriété englobe tous les investissements que les pays engagent pour diminuer leur empreinte carbone (isolation thermique, développement des énergies renouvelables, …), là encore, elle ne pose pas de question existentielle au capitalisme.
Le déclassement naturel ou accéléré de technologies carbonées et le renouvellement du capital ancien par du capital nouveau s’inscrivent dans la marche même du capitalisme. On peut lui appliquer une lecture schumpetérienne de type destruction créatrice, qui est précisément ce qui a permis jusqu’à ce jour au système de sans cesse se régénérer et de se réinventer. Surmontant l’entropie liée aux rendements décroissants et aux excès de la concentration.
La sobriété carbone apparaît même à certains égards comme une aubaine pour les entreprises, puisqu’elle ne cesse de démultiplier les nouveaux besoins : rajoutant une couche de coûts dans le bâtiment, d’expertise et de cahiers des charges coûteux dans les entreprises confrontées à la RSE, conduisant à relocaliser tout un pan de la production d’énergie que nous importions massivement jusqu’ici. Ou encore appelant à remplacer notre parc de machines et de voitures.
On arrive alors assez aisément à démontrer dans ce cadre que la sobriété non seulement nous fait économiser des ressources, mais qu’elle nous permet en outre de développer de nouveaux débouchés. C’est tout le discours véhiculé par les tenants de la croissance verte. Et le capitalisme financiarisé, devient même le système le mieux à même d’organiser son financement sans drame.
Mais le sens du mot est dévoyé. Car la sobriété, c’est à la fois beaucoup plus que la chasse anti-gaspi et beaucoup moins que ce qu’entend l’OCDE, AIE, … à travers la sobriété carbone.
4- Les politiques et les institutions se sont approprié le terme, mais qu’en est-il de la société ? Limiter les fins
Jean-Marc Jancovici ou l’association négawatt sont très éclairants sur ce point. La sobriété, c’est abandonner délibérément et de façon organisée, des services, des flux physiques, des usages… Consommer ou s’équiper moins donc. "Précisément, parce que le concept dont se différencie la sobriété, celui d’efficacité énergétique, ne fait pas le job ».
L’efficacité énergétique étant toutes les solutions qui permettent de produire autant ou plus à moindres émissions. Ainsi, investir dans l’isolation, c’est de l’efficacité, c’est pouvoir se chauffer autant à moindre consommation énergétique. Développer l’éolien, le solaire, c’est produire autant ou plus en substituant des technologies à d’autres, etc.
On est sur le terrain de l’optimisation sur lesquels les économistes sont à l’aise. Et de la confiance dans le progrès technique et le pouvoir des signaux prix pour rationner le carbone. Or, c’est cette double confiance que torpille le concept de sobriété:
• Premièrement, le capitalisme ne dispose pas des ressorts internes pour préserver la biosphère : l’innovation non seulement ne solutionne pas tous les abus, mais parfois les aggrave, à l’instar du digital, ou anime l’appétit consumériste à grand renfort de marketing.
• Deuxièmement, contrairement à ce que revendique la science économique, il ne s’agit pas seulement d’économiser ou réallouer les moyens, pour préserver le climat, mais aussi de rationner les fins, déplaçant la contrainte sur les usages humains.
Cette idée torpille le fondement même du calcul économique, dont la vocation est d’optimiser les process pour satisfaire des fins sans cesse renouvelées et augmentées. Économiser les facteurs, on sait le faire. C’est le but même du calcul économique. Limiter les fins. Non.
Et dans un capitalisme financiarisé, où tout le métabolisme du financement repose sur les promesses de création de valeur, de plus-values incessantes, la sobriété pose une vraie question existentielle.
On aimerait que la sobriété ne soit qu’une chasse au gaspi assez indolore et l’aiguillon d’une créativité porteuse d’emplois et de croissance. Mais vraisemblablement c’est plus que cela. C’est ce que nous devrons accomplir par moins de croissance si l’efficacité n’est pas au rendez-vous.
La prise de conscience que la préservation de la planète ne peut tout entière reposer sur les solutions d’efficacité ou les hyper-pouvoirs de l’innovation, et que tous les acteurs économiques doivent aussi modérer leurs pratiques de consommation a fait son chemin.
Le mot « sobriété » comporte une dimension punitive : l’idée du renoncement à un consumérisme sans limite, mais aussi à des usages, des conforts que le capitalisme valorisait jusqu’ici comme appartenant à la marche du progrès.
Cette renonciation soulève la question conflictuelle du « sur qui doit peser l’effort ? ». Avec l’inévitable défiance qu’elle suscite. Les plus pauvres ou les classes moyennes sauront-ils encore en première ligne pour que quelques-uns préservent leurs privilèges ?
La sobriété et la responsabilisation individuelle, ne sont-ils qu’une diversion accouchant d’effets microscopiques, pour détourner l’attention sur le fait que, pendant ce temps, se poursuit la course productiviste du grand capital ? Entre complotisme, conflictualité sociale, tous les ingrédients sont réunis pour que l’enjeu fâche et fracture un peu plus les opinions.
5- Face au réchauffement planétaire : résilience et démocratie font-ils bon ménage?
Dans les régimes démocratiques, une protection élevée des libertés d’expression facilite la lutte contre les pollutions locales. Les citoyens affectés peuvent se défendre et les scientifiques établir leurs diagnostics en toute indépendance. Dans le cas de menace global, résilience et démocratie font- ils bon ménage ?
Les menaces environnementales globales diffèrent des pollutions locales tant sous l’angle spatial que temporel. Elles constituent autant de « frontières planétaires, au-delà desquelles c’est l’ensemble du système Terre qui est menacé.
Elles s’inscrivent dans le temps long, car le franchissement d’une de ces frontières résulte d’une agrégation d’impacts locaux qui altère durablement un système de régulation naturel.
Si l’action concertée dans le cadre multilatéral contre la destruction de la couche d’ozone a porté ses fruits, les politiques conduites dans la plupart des pays, comme la gouvernance mise en place au sein des Nations-Unies, pour faire face au réchauffement du climat n’ont pas apporté de réponses à la hauteur de l’enjeu.
Pour enrayer le réchauffement global, il faut stabiliser au plus vite la concentration des gaz à effet de serre dans l’atmosphère en visant la « neutralité climat », situation dans laquelle les émissions brutes de gaz à effet de serre auront été ramenées à la capacité d’absorption de ces gaz par les puits (les forêts, les sols, l’océan et le captage technologique pour le CO2, l’élimination par des réactions chimiques pour les gaz hors CO2).
Une telle neutralité climat implique une double transformation : la transition énergétique consistant à décarboner un système dont 80% des sources sont d’origine fossile ; la transition agro-écologique visant à protéger les puits de carbone terrestres et à réduire les émissions hors CO2 dont l’agriculture est la principale source.
De telles transformations exigent des changements radicaux dans l’organisation économique et sociale des sociétés, impossibles à piloter à partir de simples normes réglementaires comme dans le cas de la protection de la couche d’ozone.
La gouvernance de réduction d’émission introduite par l’Accord de Paris, qualifie « d’ascendante » (bottom up) pour atteindre la neutralité carbone, a le grand mérite de permettre l’expression de tout pays, grand ou petit, riche ou pauvre, vulnérable ou pas aux extrêmes climatiques. Ce principe démocratique de représentativité mérite d’être conservé. Il convient en revanche de s’interroger sur trois faiblesses de cette gouvernance :
1.La règle du consensus pour la prise de décision est un facteur récurrent de difficultés car il donne un pouvoir exorbitant aux minorités de blocage.
2. Le système de contrôle et vérification des émissions et de leur conformité aux engagements reste d’une grande faiblesse. Il ne s’agit pas d’un problème technique mais d’une question hautement politique.
3. La gouvernance multilatérale du climat répartit égalitairement les voix et les temps de parole entre les gouvernements, pas entre les peuples. L’Accord de Paris fait bien explicitement référence au rôle de la société civile, et plus spécifiquement à celui des populations vivant directement au contact des milieux naturels fragiles, qui sont présents à toutes les conférences climat. Mais les accords climatiques ne se négocient qu’entre les États qui sont ensuite les seuls responsables de leur mise en œuvre.
C’est pourquoi la question de la résilience démocratique mérite d’être examinée au niveau des États. L’action face au réchauffement de la planète requiert une profonde transformation des structures économiques. Le « tic-tac de l’horloge climatique » nous impose d’agir à la fois vite et dans la durée.
Les intérêts géopolitiques de court terme y priment face aux risques climatiques et les contrepouvoirs des citoyens ou de la science sont impuissants.
Le cas de la Chine (le plus gros pays pollueur) interroge. Le pouvoir central ne nie pas le caractère anthropique du réchauffement et se tient informé de ses dégâts via le GIEC et la communauté scientifique. Au début des années 2010, la prise en compte du message des scientifiques par le pouvoir central a conduit à des résultats très rapides. Mais ces avancées semblent impossibles à tenir dans la durée car le changement des structures économiques et des modes de vie ne se pilote pas depuis le centre, en faisant l’économie du débat et de l’adhésion citoyenne.
Du côté des États-Unis, les fâcheux stops &go américains, si néfastes pour l’action climatique, reflètent la fragilisation du fonctionnement démocratique. Pour une part, la polarisation des questions climatiques provient de la puissance des intérêts privés liés à l’énergie fossile qui ont pollué la démocratie libérale au nom du néolibéralisme.
Les conditions économiques changent avec la montée en régime du capitalisme numérique puisant dans une nouvelle matière première : le stock d’information. Ils s’y développent de nouvelles formes de consumérismes basées sur l’individualisme et l’omniprésence des réseaux sociaux.
Le fonctionnement démocratique en est doublement altéré : l’intérêt commun disparaît derrière l’individu roi ; la radicalisation des opinions sur les réseaux devient antinomique avec le respect des droits de la minorité et du fait majoritaire.
Ces tendances atteignent l’Europe (et les autres pays) confrontée à la montée des populismes et des nationalismes qui ébranlent leur gouvernance climatique. Cette gouvernance peut-elle résister à ces coups de butoir, au moment où les objectifs de réduction d’émission pour 2030 viennent d’être rehaussés ?
Les bonnes réponses ne sont pas à chercher du côté de ce qui limite l’exercice des libertés. Elles consistent à renforcer le fonctionnement de la démocratie représentative par les multiples innovations locales portées par la société civile et la démocratie participative.
Avec la prise de conscience croissante des périls climatiques, notamment au sein des jeunes générations, la multiplication de ces initiatives est un levier crucial pour l’adhésion citoyenne et l’atteinte d’objectifs climatiques ambitieux.
Pr Samir Allal
Université de Versailles/ Paris-Saclay
- Ecrire un commentaire
- Commenter