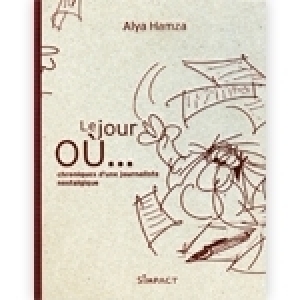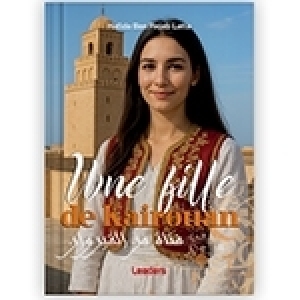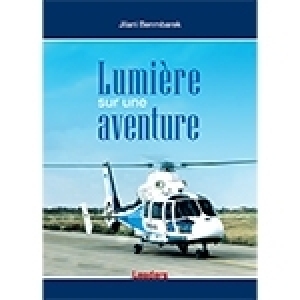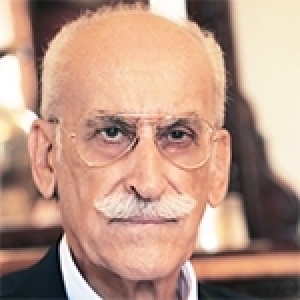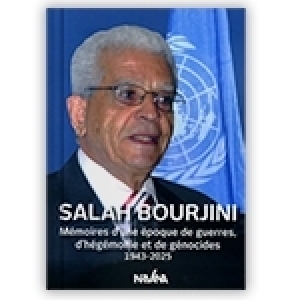Mohamed-El Aziz Ben Achour: L’Instauration du protectorat français en Tunisie

.jpg) Etabli en vertu du traité du Bardo du 12 mai 1881 puis, de manière explicite, de la convention de La Marsa du 8 juin 1883, le protectorat français était imposé à la Tunisie. Cet événement majeur n’eut un caractère soudain que par l’arrivée d’un imposant corps expéditionnaire venu d’Algérie et par mer. En réalité, il n’était que l’ultime étape d’un long processus de mise en dépendance de la Régence. Dans de précédents numéros de Leaders, nous avons présenté divers épisodes d’une histoire tunisienne marquée au XIXe siècle par des tentatives de réforme d’un Etat beylical bientôt confronté à des difficultés financières insurmontables qui affectaient également une société aux archaïsmes nombreux et dont l’économie subissait les effets destructeurs de la concurrence étrangère.
Etabli en vertu du traité du Bardo du 12 mai 1881 puis, de manière explicite, de la convention de La Marsa du 8 juin 1883, le protectorat français était imposé à la Tunisie. Cet événement majeur n’eut un caractère soudain que par l’arrivée d’un imposant corps expéditionnaire venu d’Algérie et par mer. En réalité, il n’était que l’ultime étape d’un long processus de mise en dépendance de la Régence. Dans de précédents numéros de Leaders, nous avons présenté divers épisodes d’une histoire tunisienne marquée au XIXe siècle par des tentatives de réforme d’un Etat beylical bientôt confronté à des difficultés financières insurmontables qui affectaient également une société aux archaïsmes nombreux et dont l’économie subissait les effets destructeurs de la concurrence étrangère.
 Certes, la nature despotique du pouvoir, la mauvaise gestion et la corruption puis la ruine des finances publiques eurent des effets destructeurs sur un pays désormais à la merci de ses créanciers étrangers. Mais ce qui, durant le cruel épisode précolonial, précipita la mise en dépendance, ce fut l’ingérence des puissances européennes, de plus en plus agressive vis-à-vis de la souveraineté tunisienne à mesure que l’on avançait dans le siècle. De sorte qu’à l’orée de l’année 1881, la Régence de Tunis, exsangue, était, de toute façon, dans l’incapacité de se défendre face à une expédition militaire étrangère. L’influence ancienne de la France mise à profit par l’habile consul Théodore Roustan, l’avantage stratégique que lui assurait sa présence en Algérie, l’appui obtenu par l’Allemagne et l’Angleterre firent que Paris fut le bénéficiaire du tragique aboutissement d’un projet impérialiste que lui disputaient naguère les cabinets de Londres et de Rome.
Certes, la nature despotique du pouvoir, la mauvaise gestion et la corruption puis la ruine des finances publiques eurent des effets destructeurs sur un pays désormais à la merci de ses créanciers étrangers. Mais ce qui, durant le cruel épisode précolonial, précipita la mise en dépendance, ce fut l’ingérence des puissances européennes, de plus en plus agressive vis-à-vis de la souveraineté tunisienne à mesure que l’on avançait dans le siècle. De sorte qu’à l’orée de l’année 1881, la Régence de Tunis, exsangue, était, de toute façon, dans l’incapacité de se défendre face à une expédition militaire étrangère. L’influence ancienne de la France mise à profit par l’habile consul Théodore Roustan, l’avantage stratégique que lui assurait sa présence en Algérie, l’appui obtenu par l’Allemagne et l’Angleterre firent que Paris fut le bénéficiaire du tragique aboutissement d’un projet impérialiste que lui disputaient naguère les cabinets de Londres et de Rome.
L’intervention française provoqua une onde de choc dans l’ensemble de la population tunisienne. Au sein des tribus mais aussi de certaines villes (Sfax, en particulier), il y eut une résistance à l’avancée des puissantes colonnes militaires. Quoique brouillonne et éparse, cette résistance sauva l’honneur ; mais le déséquilibre des forces était flagrant et la soumission fut générale. La consternation était néanmoins le sentiment dominant dans toutes les couches de la population. L’humiliation consécutive à l’occupation n’excluait pas,  cependant, l’apparition au sein du personnel politique d’un étrange sentiment de soulagement. En effet, le despotisme beylical, dont les travers ancestraux avaient été exacerbés tout au long de la deuxième moitié du XIXe siècle, avait commis tant d’abus, massacré et spolié tant de sujets, tant appauvri le pays que l’écœurement et la désespérance accablaient les esprits. Par ailleurs, durant toute la période précoloniale, le caractère féroce de l’ingérence étrangère dans les affaires tunisiennes, la place prépondérante prise dans l’économie et les finances par les négociants et créanciers étrangers, la ruine des métiers traditionnels et du commerce, la corruption enfin et les combines de toutes sortes que des aigrefins montaient pour s’enrichir sur le dos d’un pays en détresse, tout cela avait donné naissance à une détestation de la présence étrangère bien avant l’occupation militaire par la France. Comparés à cet «ensauvagement» généralisé, l’ordre, la rigueur et la pondération introduits par les autorités administratives du protectorat donnèrent à tous l’impression étrange d’une sécurité retrouvée.
cependant, l’apparition au sein du personnel politique d’un étrange sentiment de soulagement. En effet, le despotisme beylical, dont les travers ancestraux avaient été exacerbés tout au long de la deuxième moitié du XIXe siècle, avait commis tant d’abus, massacré et spolié tant de sujets, tant appauvri le pays que l’écœurement et la désespérance accablaient les esprits. Par ailleurs, durant toute la période précoloniale, le caractère féroce de l’ingérence étrangère dans les affaires tunisiennes, la place prépondérante prise dans l’économie et les finances par les négociants et créanciers étrangers, la ruine des métiers traditionnels et du commerce, la corruption enfin et les combines de toutes sortes que des aigrefins montaient pour s’enrichir sur le dos d’un pays en détresse, tout cela avait donné naissance à une détestation de la présence étrangère bien avant l’occupation militaire par la France. Comparés à cet «ensauvagement» généralisé, l’ordre, la rigueur et la pondération introduits par les autorités administratives du protectorat donnèrent à tous l’impression étrange d’une sécurité retrouvée.

L’acceptation, quoique à leur corps défendant, par les dignitaires et les fonctionnaires de l’ordre colonial est à mettre en liaison avec le principe du protectorat qui maintenait la dynastie régnante et les institutions tunisiennes, lesquelles jouèrent dès lors un rôle de repères rassurants en dépit de l’atteinte à une souveraineté, au demeurant depuis longtemps entravée. Le fait que la Régence était placée sous la tutelle du Quai d’Orsay et non du ministère des colonies ou, comme l’Algérie, du ministère de l’Intérieur contribuait à un relatif apaisement des esprits.

La conquête achevée, il s’agissait dès lors de mettre en place la nouvelle organisation politique et administrative du pays. La chose ne fut pas aisée. L’expédition militaire et le coût financier de la campagne suscitèrent en métropole, dans la presse et au parlement, une violente opposition. Le gouvernement présidé par Jules Ferry devait démontrer que l’occupation de la Tunisie ne serait pas un fardeau financier pour la France. La formule de l’annexion pure et simple par le rattachement à l’Algérie, département français, ne fut donc pas retenue, en raison, entre autres,des sacrifices financiers durables qu’elle n’aurait pas manqué d’entraîner. A ce propos, il est bon de noter que l’existence en Tunisie d’une dynastie séculaire, d’un Etat, somme toute organisé, d’une classe politique aguerrie et d’un personnel administratif à vieille tradition centralisatrice a été également un argument en faveur des partisans du régime de protectorat et a contribué à épargner au pays une annexion destructrice de sa personnalité avec son cortège de traumatismes définitifs. La Régence gardait son Etat, sa dynastie séculaire, son souverain, son Premier ministre, ses dignitaires et son administration ainsi que les marques de la souveraineté ou, à tout le moins, de l’identité telles que la nationalité, l’usage de l’arabe comme langue officielle et administrative à côté du français, le drapeau, les décorations officielles, la Garde beylicale.

Dans les faits, le ministre résident exerçait la réalité du pouvoir politique. Il représentait la puissance occupante auprès du bey et devenait aussi «son ministre des Affaires étrangères» tandis que le général commandant les troupes d’occupation devenait «son ministre de la guerre». Cependant, dans les toutes premières années, le problème pour l’autorité civile était que le chef de l’armée d’occupation, le général Georges Boulanger (celui-là même qui plus tard, porté par le mouvement «boulangiste», allait secouer la IIIe République), entendait maintenir sa propre administration territoriale et se comporter en pays conquis. Le successeur de Th. Roustan, Paul Cambon, préfet du Nord, administrateur brillant nommé à Tunis en 1882, eut à subir l’hostilité non seulement des militaires mais aussi de la Justice française de Tunisie qui refusait toute autorité hormis celle du garde des Sceaux à Paris. Le président du Tribunal civil, Honoré Pontois, comme de nombreux Français de Tunisie, était de plus un partisan acharné de l’annexion. Son autorité sérieusement bridée, Paul Cambon devait donc faire changer les choses afin d’asseoir durablement le protectorat. L’opportunité lui fut donnée à l’occasion de «l’affaire Tesi». Un Italien de ce nom ayant frappé un officier français fut condamné à quelques jours d’emprisonnement. Boulanger, considérant que le verdict était trop clément, ordonna «à tout militaire de faire usage de ses armes toutes les fois qu’il serait assailli ou frappé par un individu de nationalité quelconque». Cambon, appuyé par le ministre des Affaires étrangères, fit savoir qu’il s’agissait là d’une dérive dangereuse et réussit à obtenir, par le décret du 23 juin 1885, la consécration officielle du principe de l’unité de direction au profit de la Résidence et de son chef, désormais «dépositaire des pouvoirs de la République» avec le titre de Résident général. Il pouvait désormais engager fermement son programme de réorganisation d’une Tunisie ruinée depuis les années 1860-1880.

Il convient de souligner ici que cette entreprise de régénération bénéficia de la vieille tradition administrative de l’Etat beylical, d’une organisation déjà en partie modernisée grâce aux réformes des beys Ahmed, Mhammad et Sadok et du ministère Khérédine, ainsi que d’un personnel administratif nombreux et bon connaisseur du pays, de ses hommes et de ses usages. Le principe du protectorat étant le contrôle étroit de l’Etat beylical, à tous les niveaux administratifs, se trouvait un directeur français flanquant un responsable tunisien. En 1883, fut créé le Secrétariat général du Gouvernement auprès du Premier ministre avec autorité sur l’ensemble de l’administration. En octobre 1884, le corps des contrôleurs civils fut institué. Représentants du Résident dans les régions, ils exerçaient leur autorité sur les caïds-gouverneurs. Au lendemain de la crise de 1885 entre la Résidence et l’Etat-major, les bureaux des Affaires indigènes, sorte d’administration régionale relevant de la Division d’occupation, furent supprimés à l’exception des territoires du Sud limitrophes de la Tripolitaine qui seront maintenus jusqu’en 1956 sous l’autorité militaire.

Afin de mettre en application le programme de modernisation du pays, des Directions françaises furent créées : les Travaux Publics en 1882, l’Enseignement l’année suivante, les Finances en 1884, le Service des Antiquités en 1885, l’Office postal en 1888. Les programmes mis en œuvre donnèrent rapidement des résultats : un redressement des finances, une rigueur budgétaire et le paiement de la dette qui fut colossale dans les années précédant l’établissement du Protectorat. Le réseau routier, jusque-là inexistant, fut créé, développé et entretenu en même temps que l’on développait le chemin de fer et l’ensemble des infrastructures.

 Grâce aux efforts du premier responsable de la politique scolaire du protectorat, l’excellent arabisant Louis Machuel, en poste de 1883 à 1908, et de ses successeurs, brillants universitaires, un enseignement moderne bilingue français-arabe fut dispensé et des écoles publiques créées dans différents endroits du pays. Pour inciter les familles musulmanes à inscrire leurs enfants dans les écoles franco-arabes, les titulaires du certificat d’études primaires étaient automatiquement exemptés du service militaire. Les fleurons de cet enseignement bilingue étaient le Collège Sadiki réorganisé (on sait qu’il avait été créé par Sadok Bey à l’initiative de son ministre Khérédine en 1875, mais qu’après le départ de ce dernier, il fut désorganisé et ses ressources financières pillées) et le Collège Alaoui créé en 1884. En 1900, 3 782 élèves tunisiens musulmans fréquentaient les établissements relevant de la Direction de l’Enseignement. Trente ans plus tard, ils seront 29 491 dont 2 918 jeunes filles. Dans le domaine de la santé, des efforts inédits en Tunisie furent déployés. L’Institut Pasteur est créé en 1894, l’hôpital Sadiki réorganisé et des services d’hygiène institués. En 1897, Béchir Dinguizli, ancien élève du Collège Sadiki, est le premier Tunisien à soutenir une thèse de doctorat en médecine, inaugurant une tradition qui n’allait cesser de se renforcer.
Grâce aux efforts du premier responsable de la politique scolaire du protectorat, l’excellent arabisant Louis Machuel, en poste de 1883 à 1908, et de ses successeurs, brillants universitaires, un enseignement moderne bilingue français-arabe fut dispensé et des écoles publiques créées dans différents endroits du pays. Pour inciter les familles musulmanes à inscrire leurs enfants dans les écoles franco-arabes, les titulaires du certificat d’études primaires étaient automatiquement exemptés du service militaire. Les fleurons de cet enseignement bilingue étaient le Collège Sadiki réorganisé (on sait qu’il avait été créé par Sadok Bey à l’initiative de son ministre Khérédine en 1875, mais qu’après le départ de ce dernier, il fut désorganisé et ses ressources financières pillées) et le Collège Alaoui créé en 1884. En 1900, 3 782 élèves tunisiens musulmans fréquentaient les établissements relevant de la Direction de l’Enseignement. Trente ans plus tard, ils seront 29 491 dont 2 918 jeunes filles. Dans le domaine de la santé, des efforts inédits en Tunisie furent déployés. L’Institut Pasteur est créé en 1894, l’hôpital Sadiki réorganisé et des services d’hygiène institués. En 1897, Béchir Dinguizli, ancien élève du Collège Sadiki, est le premier Tunisien à soutenir une thèse de doctorat en médecine, inaugurant une tradition qui n’allait cesser de se renforcer.
Dans le domaine agricole, les efforts portaient principalement sur les moyens de développer la colonisation et de faire bénéficier les Français des meilleures terres au détriment de la population tunisienne. A ce sujet, le géographe Jean Poncet souligne que l’action de la France en Tunisie «était commandée par le désir de réserver à ses capitalistes et à ses productions ce pays dépeuplé, techniquement et économiquement arriéré. (…) Il ressort que les premiers colonisateurs français de la Régence n’ont pas été de véritables agriculteurs mais plutôt des spéculateurs ou, tout au moins, une aristocratie de propriétaires absentéistes et de gros exploitants indirects.» Ce n’est que dans les dernières années du XIXe siècle que les autorités du protectorat adopteront une politique de colonisation officielle en encourageant l’installation d’exploitants directs. On comprend ainsi pourquoi la Direction de l’agriculture, du commerce et de la colonisation n’a été créée qu’en 1896.

Justin Massicault (1886-1892), Charles Rouvier (1892-1894), René Millet (1894-1900), successeurs de Paul Cambon nommé ambassadeur à Madrid en 1886, furent eux aussi de grands résidents généraux. Il convient de souligner que tous suscitèrent l’hostilité des milieux français de Tunisie qui les accusaient d’être trop favorables aux intérêts tunisiens. Le représentant des grands colons et des partisans de l’annexion, l’abominable Victor de Carnières, accusait ainsi Millet d’arabophilie parce qu’il poursuivait la création des écoles destinées aux enfants tunisiens et qu’il donna son appui pour la création en 1896 de la Khaldounia, association destinée à la diffusion des disciplines scientifiques et littéraires modernes au bénéfice des Tunisiens et notamment des élèves de l’université musulmane de la Zitouna. En février 1901, le journal parisien La Justice rapportait qu’au Palais-Bourbon, un député interpella le gouvernement sur « le désaccord permanent entre la population française et le résident général»et, dans une envolée oratoire, ajouta que «le mot d’ordre des colons est de réclamer pour eux la situation de l’arabe le plus favorisé»(!)

Au sein de l’administration centrale et régionale, la cohabitation entre Tunisiens et Français avait permis d’obtenir de bons résultats. L’historienne Fatma Chelfouh, dans un ouvrage sur l’administration et les hauts fonctionnaires tunisiens de 1881 à 1956, a bien montré que, malgré un statut inférieur, cette élite contribua avec dévouement à l’œuvre de modernisation d’une administration dont les acquis allaient s’avérer si utiles au pays une fois l’indépendance recouvrée. Mais le sentiment d’injustice était présent chez tous les cadres tunisiens, et des hauts fonctionnaires tels que Béchir Sfar ou Kheirallah Ben Mustafa contribuèrent, par leur engagement associatif, à l’émergence d’une culture de réforme et de revendication.

L’enrichissement intellectuel des élites consécutif au protectorat avait sa source principalement dans l’influence de la culture française et les idées de la Révolution, mais aussi dans l’expérience réformatrice de Khérédine (1873-1877) et le réformisme musulman apparu dans l’Orient ottoman. Cette émancipation des esprits ne manqua pas d’aboutir à un mouvement associatif et revendicatif de type moderne. En 1896, la Khaldounia est créée, dispensant des études modernes sanctionnées par un diplôme. L’Association des anciens élèves du collège Sadiki est fondée en 1905; le Cercle tunisien en 1908. La presse figura parmi les expressions les plus efficaces de cet engagement intellectuel et social : le journal Al Hâdhira, fondé en 1888 par Ali Bouchoucha, ouvrit ses colonnes à des personnalités soucieuses de contribuer au relèvement de la population. Le Tunisien, «premier journal arabe de langue française» créé le 7 février 1907, se définissait comme «l’organe des intérêts indigènes». Dès lors la presse – souvent confrontée à la censure et à des mesures coercitives - allait jouer un rôle sans cesse croissant dans la vie politique du pays.

L’exigence de réforme s’organisa autour du mouvement dit «Jeune-Tunisien». Ses dirigeants étaient, outre Béchir Sfar et Kheirallah déjà évoqués, Ali Bach Hamba, Abdeljélil Zaouche, ainsi que Hassan Guellaty et Sadok Zmerli. Le premier souci de cette nouvelle élite musulmane était d’œuvrer au relèvement intellectuel, économique et social de la population. Sfar, évoquant la Khaldounia qu’il avait créée en 1896, disait : «cette société contribue à répandre parmi les Musulmans le goût des sciences, à développer leur intelligence, à détruire des préjugés et leur ouvrir bien des horizons qui leur étaient totalement inconnus ». Deux manifestations officielles organisées en France, le congrès colonial de Marseille en 1906 et le congrès de l’Afrique du nord à Paris en 1908, donnèrent à ces intellectuels tunisiens l’occasion d’exprimer leurs doléances. Ils y ajoutèrent une dimension revendicatrice. Dans le premier numéro du Tunisien, son fondateur, Bach Hamba, présentait un programme qui réclamait« la mise en harmonie des institutions tunisiennes avec la conception moderne, l’égalité des droits et des devoirs respectifs des gouvernements et des peuples ; la participation à la vie politique ; une participation plus large à l’administration du pays ». Il ajoutait: «l’œuvre de progrès entreprise par la France en Tunisie commence à porter ses fruits. Une génération nouvelle, instruite dans la langue française et fortement imprégnée des idées généreuses dont elle est le véhicule, se trouve aujourd’hui en état de prendre sa place dans la rénovation qui s’y accomplit ».
Parallèlement à l’action de cette élite de formation moderne, la protestation populaire ne tarda pas à s’exprimer. En 1885 à Tunis, notables et citadins refusèrent des mesures municipales jugées injustes, rédigèrent des pétitions et se rendirent en masse au palais du Bey à La Marsa. En 1906, à Thala, dans la région de Kasserine, le froid et la misère provoquèrent une émeute et des colons furent tués et les émeutiers sévèrement châtiés. En 1911, une malencontreuse mesure d’immatriculation du cimetière du Djellaz provoqua des troubles sanglants, suivis en 1912 par les incidents anti-Italiens consécutifs au boycottage des tramways dans un contexte marqué par l’intervention italienne en Tripolitaine. Il y eut des morts, des condamnations à la peine capitale et les autorités du protectorat accusèrent Bach Hamba et Zaouche d’avoir inspiré les émeutiers. La première grève que connut la Tunisie eut lieu à la Zitouna en mars 1910 à l’initiative des étudiants qui réclamaient une réforme de leurs études et une amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Malgré tout, les discriminations, inhérentes qu’elles étaient à la situation coloniale, demeuraient en vigueur Ce n’est que dans l’entre-deux-guerres puis après 1945, à la faveur du nouvel ordre mondial, que la protestation politique conduite par le Néo-Destour s’organisera et se radicalisera pour aboutir à l’autonomie interne en 1955 et à l’indépendance, le 20 mars 1956.
Masquant une réalité colonialiste, le protectorat fut toutefois, pour la souveraineté de l’Etat et la personnalité nationale, un moindre mal à une époque de l’histoire du monde marquée par l’irrésistible expansion de l’impérialisme européen. Ayant récupéré l’administration beylicale, le protectorat eut le mérite d’associer les Tunisiens à la modernisation et à la rationalisation de la gestion du pays. Plus tard, l’élite dirigeante tunisienne saura se battre avec honneur puis redonner au pays sa souveraineté mais sans gaspiller les acquis d’une rationalité et d’un modernisme développés par l’ancienne puissance occupante. La Tunisie y gagna en termes de pérennité de l’Etat et de son administration, de compétence de ses fonctionnaires et de qualité de ses élites éduquées.
Mohamed-El Aziz Ben Achour
- Ecrire un commentaire
- Commenter