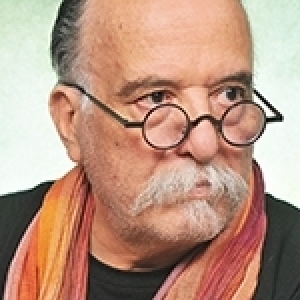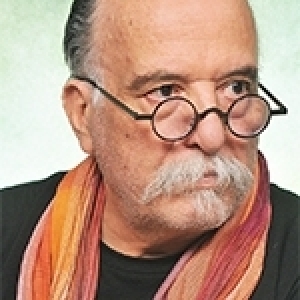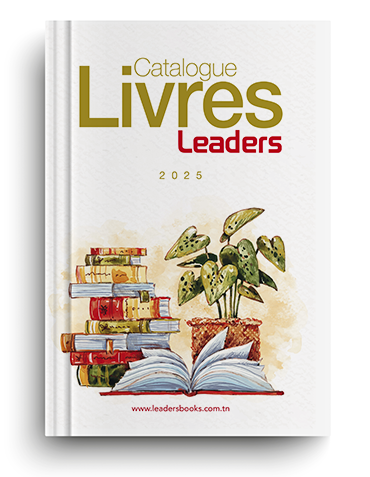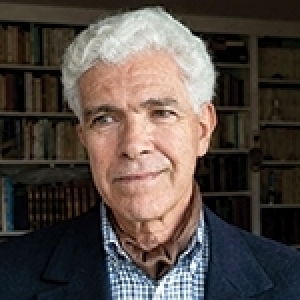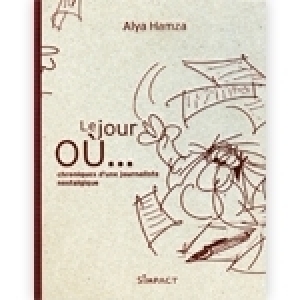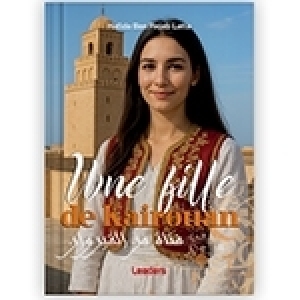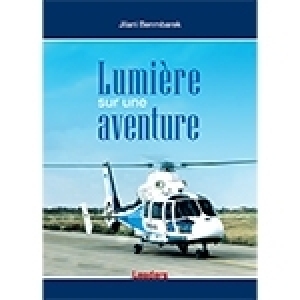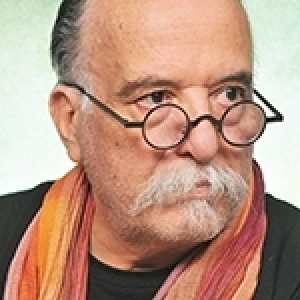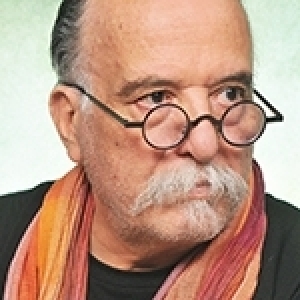Les relations extérieures de l’Etat carthaginois Traités, pactes et conventions conclus du VIe au IIIe siècle av. J.-C.

Dans un raccourci remarquable, souvent cité en raison de sa concision et de sa justesse, un grand historien du Maghreb antique avait ainsi dépeint, au début du XXe siècle, les axes essentiels de la politique extérieure de Carthage. Soutenue et tenace, écrivait-il, l’action de l’Etat carthaginois consistait «soit par la force, soit par des traités, soit par des fondations de colonies, à ouvrir aux Carthaginois des marchés, leur en réserver l’exploitation dans les contrées d’où il était possible d’écarter toute concurrence ; dans celles où ce monopole ne pouvait pas être établi, régler les transactions par des pactes stipulant des avantages réciproques; assurer contre les pirates la liberté de navigation, l’existence des cités et des comptoirs maritimes.» (St. Gsell, Histoire ancienne de l’Afrique du Nord, IV, 1924, p. 113).
L’instrument principal de cette politique était la marine de guerre et les flottes commerciales, que divers documents ont permis, sinon de connaître, du moins de se représenter avec plus ou moins d’exactitude. Déjà au début du premier millénaire avant le Christ, les navires de commerce phéniciens longeaient les côtes et sillonnaient la mer intérieure. Le relais fut pris, après la fondation de Carthage, par la marine punique, dont la flotte marchande devint à son tour omniprésente entre les rives de la Méditerranée occidentale. Et chaque fois qu’une flotte marchande concurrente imposait sa présence, avaient noté les auteurs anciens, l’organisation du commerce maritime carthaginois était réglée par des traités, conclus surtout afin de délimiter les zones d’influence respectives. Pour faire respecter ces traités, et aussi pour écarter les pirates, la marine de guerre constitua longtemps l’arme principale sinon exclusive de Carthage qui mena, grâce au nombre et à la redoutable efficacité de ses vaisseaux de guerre, les batailles navales les plus décisives de l’Antiquité; ce n’est que plus tard, après la première guerre punique, que le recours aux troupes terrestres devint tout aussi important que l’arme marine.
Les premiers traités conclus entre Carthage et Rome (en 509, 348 et 306 av. J.-C.)
Le premier traité entre Carthage et Rome fut conclu, semble-t-il, dès la fin du VIe siècle avant le Christ en 509. Traduisant en grec le texte de ce traité, rédigé en latin archaïque, Polybe (III, 1, 22) en avait déjà souligné les difficultés d’interprétation. En voici le texte intégral, tel que transmis par l’historien grec: «Les Romains et leurs alliés s’abstiendront de naviguer au-delà du Beau Promontoire, à moins que la tempête, ou une force ennemie ne les contraigne ; si un navire se trouve entraîné malgré lui au-delà de ce cap, il sera interdit à l’équipage de rien vendre et de rien acheter, sinon ce qui sera nécessaire pour mettre ledit navire en état de reprendre la mer ou pour offrir un sacrifice. Le navire devra repartir dans les cinq jours. Pour ceux qui viendront faire du commerce, aucune transaction ne pourra être conclue sans la présence d’un héraut ou d’un greffier. Quant au règlement des achats effectués en présence de ces fonctionnaires, l’Etat se portera garant envers le vendeur – cela pour les ventes effectuées en Sardaigne et en Afrique. Tout Romain qui se rendra en Sicile, dans la zone soumise à l’autorité de Carthage jouira des mêmes droits que les autres…».
Très nombreux sont les historiens qui ont expliqué, commenté et interprété ce texte; mais la discussion est loin d’être close, notamment au sujet de l’identification du «Beau Promontoire». Polybe lui-même avait cependant ajouté un commentaire très bref au texte du traité, en y apportant une précision importante: «le Beau Promontoire est le cap avançant devant Carthage même, en direction du Nord». Plusieurs historiens modernes, et non des moindres, ont choisi d’identifier ce cap avec Ras Sidi Ali el-Mekki (baptisé Cap Farina à l’époque coloniale) que les navires de guerre, venus du Nord ou du Nord-Ouest, doublent pour s’engager dans le golfe de Tunis-Carthage. Pourtant, c’est en direction de l’Est que ce cap avance sa pointe, et il suffit de bien observer l’horizon, au large du rivage carthaginois, pour se convaincre, comme l’avait déjà signalé S. Lancel, que c’est le Cap Bon qui, incontestablement, pointe son extrémité en direction du Nord.
Quant à cette qualification de «Beau» ou de «Bon Promontoire» (Kalon Akrotèrion), elle procède d’un euphémisme par litote, car la navigation est des plus périlleuses au large de Ras ed-Drek, cap qualifié cette fois, en arabe, sans euphémisme ni antiphrase. On retrouve le même euphémisme par antiphrase dans l’appellation grecque de la mer Noire (Pontos Euxeinos, le Pont Euxin de l’époque romaine). Quoique redoutable en raison des dangers qu’elle présentait pour les navigateurs, elle était néanmoins qualifiée en grec «d’accueillante et favorable à l’étranger» (Euxeinos). Afin de surveiller la navigation au large de la rive nord du Cap Bon et de protéger la côte, Carthage l’avait jalonnée de postes de garde et de fortins, qui s’échelonnaient de Ras el-Fartas à Ras ed-Drek et étaient prolongés par les remparts de Kerkouane et la forteresse de Clypea (Kélibia).
Poursuivant le commentaire de ce traité, Polybe avait précisé son sens et sa portée; cet acte, écrivait-il «montre que les Carthaginois considéraient la Sardaigne et l’Afrique comme leur domaine propre, mais qu’il n’en allait pas de même pour la Sicile, où l’on distinguait explicitement la partie de l’île qui se trouvait soumise à Carthage ». En effet, si les Carthaginois surveillaient si étroitement la navigation à l’extrémité du Cap Bon, c’était bien parce qu’ils voulaient interdire leur hinterland africain aux Romains; il était en effet nécessaire de les empêcher de doubler le Cap Bon pour cingler vers les côtés orientales et commercer tant avec les riches cités de la Byzacène (le Sahel actuel) qu’avec les Emporia de la petite Syrte (le golfe de Gabès). Conclu en 509, date avancée par Polybe et mise en doute un moment, avant d’être généralement admise par la plupart des historiens, ce traité consacrait un rapport de force des deux puissances à l’extrême fin du VIe siècle. Rome venait d’instaurer le régime républicain, sa marine était au stade de la création, et elle n’avait pas encore étendu sa domination sur les Etrusques, qui avaient des relations commerciales importantes avec Carthage. Une véritable alliance s’était même nouée entre les Puniques et la principauté du sud de l’Etrurie. Carthage, par contre, avait déjà assuré à cette époque sa mainmise sur le bassin occidental de la mer intérieure. Elle était donc en mesure d’imposer le verrouillage des côtes africaines, et de celles de la Sardaigne, pièce maîtresse au Nord de la Méditerranée.
Mais la situation était nettement différente pour les côtes de la Sicile, théâtre d’une lutte acharnée entre Carthaginois et Grecs; lutte qui se prolongea du Ve siècle jusqu’en 264 av. J.-C., date de l’intervention de Rome et du déclenchement de la première guerre punique.
Au milieu du IVe siècle, un deuxième traité qu’on date de 348 av. J.-C. réaffirma avec force les clauses du premier. «Les Romains, précisait-il, ne pourront en aucun cas faire du commerce ou fonder des villes en Sardaigne ou en Afrique» ; ils ne pourront, non plus, s’avancer le long des côtes ibériques au-delà du cap de Palos. Au IVe siècle, en effet, Carthage avait étendu son emprise sur la totalité de la Sardaigne, et avait aussi pris pied en Espagne; ce qui nécessitait l’ajout de nouvelles clauses, tout en réaffirmant celles du premier traité. Ecrivant beaucoup plus tard, et faisant partie du cercle de Scipion Emilien, Polybe (III, 26, 3) avait mis en doute l’existence d’un troisième traité. Mais il était circonvenu sans doute par les aristocrates romains de son entourage, qui ne voulaient pas admettre qu’en intervenant en Sicile, Rome avait transgressé le traité. C’est donc à Philinos, un Grec sicilien du IIIe siècle av. J.-C., qu’on doit la transmission des clauses de ce troisième traité, daté de 306 av. J.-C. Tout en maintenant les limites respectives d’intervention des deux puissances, il excluait totalement Carthage des côtes italiennes, mais il interdisait surtout tout acte de souveraineté, toute immixtion politique des Romains en Sicile.
Convention, pacte et traité en relation avec la deuxième guerre punique
Lorsque Hamilcar Barca succomba en Espagne en se noyant dans le Jucar, son gendre Hasdrubal l’Ancien lui succéda à la tête de l’armée. En 226 av. J.-C., il signa au nom de Carthage, avec une ambassade romaine, une convention qui délimitait dans la péninsule ibérique les zones d’influence respectives des deux puissances. Au terme de cet accord, défense était faite aux Carthaginois de franchir en armes le fleuve Iber (Polybe, II, 13, 7 et III, 27, 9). Il s’agit de l’Ebre, ce fleuve qui débouche en Méditerranée très nettement au Nord de Sagonte, une cité peu importante située donc incontestablement dans la zone d’influence carthaginoise. Mais un conflit éclata entre les Sagontains et une tribu voisine, vassale de Carthage, et une partie des notables de la cité sollicita, en vain, la protection de Rome. Celle-ci, au début de 219 av. J.-C., envoya toutefois à Sagonte des députés qui, sous prétexte d’arbitrer le différend, facilitèrent aux notables pro-romains l’élimination physique de leurs adversaires. Ces mêmes députés romains invitèrent ensuite Hannibal- qui se trouvait à Carthagène et avait succédé à Hasdrubal à la tête de l’armée- de s’abstenir de tout acte d’hostilité contre Sagonte. Il leur répondit qu’il vengerait les victimes d’une injustice et le Sénat carthaginois, qu’il avait consulté, lui laissa la liberté de décision. Il n’hésita donc pas à assiéger Sagonte. Rome avait donc, sans aucun doute, transgressé la convention signée avec Hasdrubal en 226 av. J.-C., utilisant le prétexte de Sagonte pour déclencher la deuxième guerre punique, comme l’affirme d’ailleurs Stéphane Gsell (H.A.A.N., II, p.137); son but était de contrecarrer la domination punique au sud de l’Espagne, entre le détroit de Gibraltar et l’Ebre. Polybe, encore une fois, ne fait sans doute que rapporter l’opinion des aristocrates romains gravitant autour de Scipion Emilien lorsqu’il écrit (III, 6), à propos du déclenchement de la deuxième guerre punique: «comme première cause, le siège de Sagonte par les Carthaginois, et, comme cause seconde, le franchissement de ces mêmes Carthaginois du fleuve que les gens du pays appellent Iber». Deux causes avancées dans le dessein évident d’accuser Hannibal et de rejeter sur les Puniques la transgression de la convention, tout en passant sous silence le meurtre des Sagontains partisans de Carthage, et, surtout, en situant Sagonte au Nord de l’Ebre. Or, au lieu de relever l’erreur délibérée de Polybe, et de souligner son parti-pris manifeste, l’historiographie française s’est évertuée, à force d’arguties, à essayer de justifier l’injustifiable: en prétendant par exemple, en dépit de toute évidence, que l’Iber mentionné dans la convention n’est pas l’Ebre actuel mais un autre fleuve, le Jucar, qui coule au sud de Sagonte (J. Carcopino, suivi par G.-Ch. Picard), ou bien en avançant qu’en 219 av. J.-C., année du déclenchement de la guerre, la situation avait évolué par rapport à 226, date de la convention, car Sagonte, au sud de l’Ebre, était devenue l’alliée du peuple romain (S. Lancel qui avait omis sciemment d’évoquer le coup de force et les meurtres commis par la faction pro-romaine à Sagonte).
En 215, un autre acte diplomatique fut conclu après la victoire éclatante de Cannes, la bataille célèbre que les Etats européens étudieront dans leurs écoles de guerre jusqu’au XIXe siècle. Hannibal y avait perdu quatre mille Gaulois, et mille cinq cents Ibères et Africains, mais du côté romain, ce fut un désastre sans précédent. Huit légions romaines furent détruites, avec soixante-dix mille morts, et parmi eux, le consul Paul-Emile, le père de Scipion Emilien, ainsi que les deux consuls de l’année précédente. Des ambassadeurs de Philippe V de Macédoine vinrent alors conclure avec Hannibal un pacte d’alliance, dont le texte nous a été transmis par Polybe (VII, 9) dans une traduction grecque de ce qui paraît être un texte original en punique. Invoquant par triades les divinités puniques, en jurant de respecter le traité, les alliés décidaient que les Macédoniens soutiendraient les Carthaginois, que les deux Etats ne concluraient pas de paix séparée avec leurs ennemis communs, et que si l’un des deux alliés était attaqué, l’autre viendrait à son secours. Mais, contrairement à ce qu’avaient prétendu les auteurs romains (Tite Live, Zonaras), Hannibal et Philippe V n’avaient aucunement l’intention d’anéantir, après Cannes, l’Etat romain: «Si les Romains demandent la paix, ajoute le pacte, nous (les Carthaginois)
la leur accorderont» (Polybe, VII, 9, 12). Tite Live (XXII, 58, 3) mentionne d’ailleurs un discours d’Hannibal, à l’adresse des prisonniers romains, où il affirmait qu’il ne faisait pas à Rome une guerre d’extermination, car il combattait pour permettre à Carthage de garder son rang de grande puissance (dignitas) et afin de lui assurer l’hégémonie (imperium). Le pacte d’alliance était placé sous la protection des divinités carthaginoises sollicitées par triade et citées, dans le serment d’Hannibal, sous les noms de leurs équivalents grecs : Zeus, Héra et Apollon en premier lieu, puis le «daimon» des Carthaginois – c’est-à-dire la voix intérieure qui guide et conseille –accompagné d’Héraclès et de Iolaos, et enfin Arès, Triton et Poseidon. Pour certains historiens, ces dieux constituaient le panthéon de Carthage, mais pour d’autres, la liste s’en tenait aux seules divinités du panthéon personnel d’Hannibal et de la famille des Barcides ; mais les discussions et les controverses sont loin d’être closes. Dans la première hypothèse, Zeus, pense-t-on, serait Ba’al Hammon, la première divinité masculine de Carthage à l’époque d’Hannibal ; à moins que ce ne soit, toujours selon cette hypothèse, Ba’al Shamim, le dieu traditionnel des cieux. Héra, à son tour, pourrait être soit Astarté soit, plutôt, Tanit qui accompagnait Ba’al Hammon comme Héra accompagnait Zeus. Apollon, la troisième divinité, pose un problème encore insoluble ; car si Appien (Libyca 127 et 133) signale, à l’époque de la destruction de Carthage en 146 av. J.-C., un temple d’Apollon près de l’agora de la cité, le dieu sémite correspondant serait Reshef. Mais ce dieu n’est toujours pas attesté dans l’épigraphie punique.
Le «daimon» de la deuxième triade serait, pensent certains historiens, Tanit la déesse tutélaire de Carthage; mais dans ce cas, elle ne pourrait être l’équivalente d’Héra. Héraclès, normalement, est l’équivalent de Melqart et Iolaos serait le dieu Sid; à moins de l’identifier plutôt avec Eschmoun, le dieu guérisseur qui était la divinité principale de Sidon et dont le temple, sur la colline de Byrsa, était le sanctuaire le plus vaste de Carthage. Mais Eschmoun fait difficulté, car il est habituellement identifié avec le dieu grec Asclépios et, de toute façon, on ne peut admettre son absence parmi les divinités citées. Les difficultés ne sont pas moindres pour l’identification de la troisième triade. Arès serait Ba’al Haddad, dieu de l’orage chez les Sémites occidentaux, qui correspondrait à l’Addad mésopotamien. Triton, de son côté, serait Ba’al Malagè et Poseidon, enfin, pourrait être identifié à Ba’al Saphon. On ne peut donc que constater, en définitive, que la plus grande incertitude existe toujours pour comprendre et interpréter ce document capital pour l’identification des divinités de Carthage; car comme on ne cesse de le répéter, on ne dispose pour l’essentiel de nos connaissances dans ce domaine, comme dans celui des institutions de Carthage, que de textes classiques grecs et latins, afin d’accéder aux réalités d’une culture qui était celle d’un monde sémitique dissemblable. Un monde dont la réalité sémitique est trahie par une documentation classique différente et particulièrement incompatible. Les motivations des deux alliés étaient concordantes: le roi de Macédoine était résolu à empêcher les Romains de s’établir en Illyrie, sur l’autre côte de l’Adriatique et visait même la mainmise sur la côte orientale de l’Italie; il était donc prêt, en échange, à favoriser le dessein de Carthage visant à organiser une confédération italienne d’obédience carthaginoise présidée par Capoue. Mais retenu par sa guerre en Illyrie puis en Grèce, Philippe V ne put envoyer l’armée macédonienne promise à Hannibal, une armée dont les troupes comptaient encore parmi les meilleures de l’époque. Le roi finit même, en 206, par traiter avec Rome, contrevenant aux clauses du pacte signé avec Hannibal. L’alliance des Puniques avec les Macédoniens avait ainsi tourné court.
Le traité de paix de 201, après la défaite de Zama
On sait que malgré les faits d’armes de l’épopée hannibalienne, la deuxième guerre punique prit fin avec la victoire de Scipion près de Zama (Jama, à une trentaine de kilomètres au Nord de Makthar). Le traité de paix fut négocié par Scipion, assisté par dix commissaires désignés par le Sénat romain. Il fut conclu, conformément aux clauses envisagées lors de ces pourparlers préliminaires menés en 203, mais aggravées par la suite. Les sources sont diverses, mais concordantes pour l’essentiel. Citons parmi elles notamment Polybe (XV, 19), Tite Live (XXX, 33-44), Appien, etc. Tout comme Hannibal, qui n’avait pas eu l’intention de détruire Rome, Scipion n’avait guère envisagé la destruction de Carthage. Mais le traité de 201 permettait à Rome d’obtenir plus que n’avait souhaité Scipion, qui voulait seulement sortir Hannibal de l’Italie, imposer aux Carthaginois la fin de cette longue guerre et prendre les mesures nécessaires pour les empêcher d’en déclencher une autre. Carthage demeura un Etat indépendant, mais le débat sur son maintien était déjà ouvert au Sénat romain, et on connaît l’acharnement et la phrase célèbre de Caton à ce sujet. (Un demi-siècle plus tard, on confia à Scipion Emilien, fils du vaincu de Cannes, l’exécution de la solution finale). Massinissa, selon les clauses du traité, récupérait son royaume, et tout le territoire contrôlé par ses ancêtres, avec la capitale Cirta; ce qui limitait le pays administré par Carthage aux «Fossae Punicae», une frontière qui devait suivre à peu près celle qui limitera à l’Ouest la première province romaine. Militairement et financièrement, les mesures furent draconiennes: Carthage ne pourrait plus faire la guerre en Afrique, ni ailleurs, sans l’accord du peuple romain; ses éléphants, une fois remis à Rome, elle s’engageait à ne pas en acquérir d’autres; elle devait saborder ses vaisseaux de combat et n’en garder que dix; l’indemnité de guerre, enfin, fixée en 203 à cinq mille talents d’argent, passait en 201 à dix mille payables en cinquante annuités.
Ammar Mahjoubi
- Ecrire un commentaire
- Commenter

.jpg)