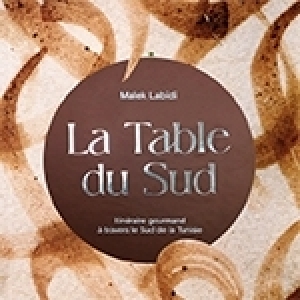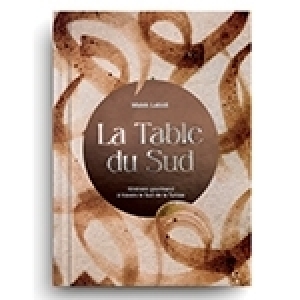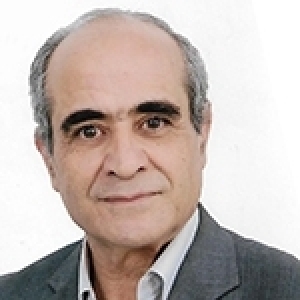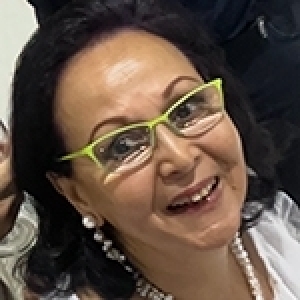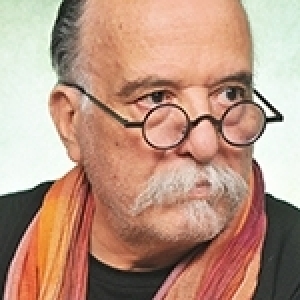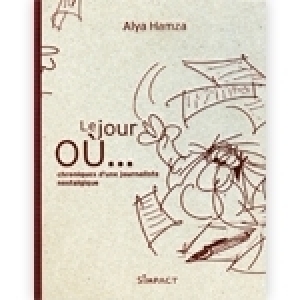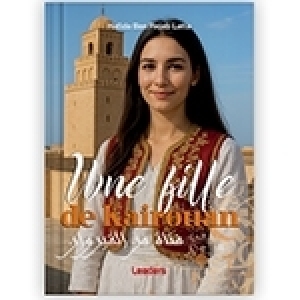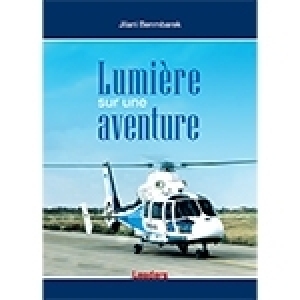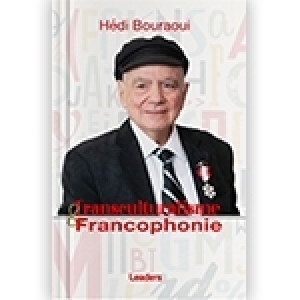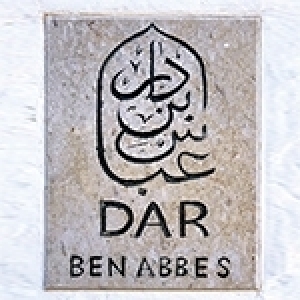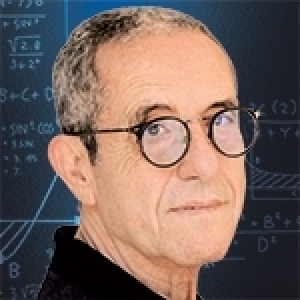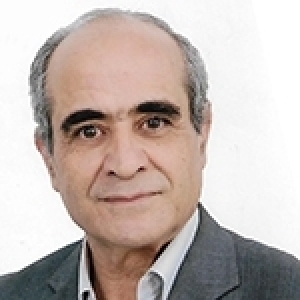Tunisie - Algérie: De la défiance à l'entente cordiale
Les relations tuniso-algériennes ont longtemps été frappées du sceau de la défiance et assombries par l’existence d’un contentieux territorial. Habib Bourguiba, qui leur avait offert l’hospitalité entre 1957 et 1962, reprochait volontiers aux anciens maquisards du FLN leur ingratitude et leur manque de considération pour les sacrifices consentis par la Tunisie. Les Algériens, de leur côté, le soupçonnaient d’avoir joué double jeu et d’avoir voulu négocier avec Charles de Gaulle la restitution à la Tunisie des territoires sahariens compris entre les bornes 220 et 233. Quelques arpents de sable inhabités, mais où l’on venait de découvrir d’importants gisements pétrolifères. A cette dispute sur le tracé des frontières s’ajoutait la rivalité idéologique entre l’Algérie révolutionnaire et arabiste et une Tunisie aux orientations modernistes et résolument atlantistes.
Comment sortir de l’étouffant tête-à-tête avec Alger?
Plusieurs fois, à plusieurs reprises, les gouvernants tunisiens caresseront l’idée de conclure des alliances défensives avec les puissances occidentales, pour sanctuariser leur territoire contre une possible agression. En décembre 1967, Bourguiba évoquera même, à demi-mots, l’éventualité d’une adhésion à l’Otan. Les alliés ne donneront pas suite. Car une telle initiative n’aurait pas manqué d’être interprétée comme une provocation par une Algérie, championne du non-alignement et viscéralement hostile à la présence de troupes étrangères au Maghreb. Paris et Washington, qui avaient été sollicités, ne souhaitaient pas offrir aux Algériens un prétexte pour se rapprocher davantage des Soviétiques. A défaut d’une alliance militaire en bonne et due forme, Bourguiba devra se contenter d’un «solide rempart d’amitiés occidentales». Suffisant, sans doute, mais pas totalement rassurant.
Le coup d’Etat libyen du 1er septembre 1969, qui porte au pouvoir le colonel Mouammar Kadhafi, vient compliquer un peu plus l’équation géopolitique régionale. Coincée entre deux pays se réclamant d’idéologies diamétralement opposées aux siennes, la Tunisie doit réagir. L’encerclement n’est pas tenable, et l’Etat, qui a choisi de donner la priorité à l’éducation et à la santé, n’a pas les moyens de se lancer dans une course aux armements.
Il faut vider le contentieux territorial avec Alger pour faire diminuer la pression. En novembre 1969, Bourguiba demande à Hédi Nouira de « normaliser » les relations avec l’Algérie. L’assouplissement de la position tunisienne débouche sur le traité du 6 janvier 1970, qui est ratifié le 30. La Tunisie renonce officiellement à ses vues sur les 900 kilomètres carrés de territoires sahariens situés au-delà de la fameuse borne 233, en échange de maigres contreparties.
La décennie 1970 / 1980 sera, pour la Tunisie, celle de tous les périls. La «parenthèse socialiste» a été refermée, et le pays a retrouvé une belle prospérité économique. Mais le déclin des facultés physiques et mentales de Bourguiba inquiète. Ses absences sont de plus en plus fréquentes. Cette situation attise les convoitises. L’Algérie est au faîte de sa puissance et aspire désormais ouvertement au leadership maghrébin.
En mai 1973, au Kef, Houari Boumediene propose un «traité d’union » à son homologue tunisien, qui refuse, en y mettant les formes. Bourguiba n’est pas foncièrement opposé à un rapprochement, voire à une association, mais il veut négocier d’égal à égal. Il confiera à son entourage: «L’Algérie, c’est un gros morceau, avec son Sahara, sa population, son potentiel et son gros ventre, nous risquons d’être engloutis» .
Les séquelles de Djerba: Gafsa et la guerre larvée avec la Libye
Le tête-à-tête avec Alger est étouffant et déséquilibré. Pour en sortir, le président tunisien se laisse convaincre par Mohamed Masmoudi, son ministre des Affaires étrangères, qu’il y a peut-être quelque chose à tenter avec Tripoli. Présomptueux, Bourguiba s’imagine qu’il pourra circonvenir le bouillant colonel libyen et mettre la main sur les fabuleuses richesses du sous-sol libyen. Ce malentendu est à l’origine du projet de fusion avorté entre la Tunisie et la Libye, signé par les deux leaders sur un coin de table dans un hôtel à Djerba, le 12 janvier 1974, et dénoncé quelques jours plus tard.
Cet épisode plombera durablement les relations tuniso-libyennes. Et débouchera sur une véritable guerre d’usure, ponctuée d’épisodes sanglants, comme l’attaque de la ville de Gafsa par un commando armé et entraîné en Libye, le 26 janvier 1980. Les rapports avec l’Algérie vont connaître des hauts et des bas jusqu’à l’accession au pouvoir de Chadli Benjedid, en 1980.
L’affaire de Gafsa, qui souligne la vulnérabilité tunisienne, constitue un moment charnière dans la relation entre Tunis et Alger. L’enquête met en évidence l’implication directe de la Libye, mais révèle que le commando a bénéficié de complicités à Alger. Chadli, qui vient de prendre ses fonctions à la présidence, tombe des nues. L’opération a été menée à son insu. Par Slimane Hoffmann. Il jure sur son honneur d’officier qu’il n’y est pour rien. Bourguiba choisit de le croire. La Tunisie rejette officiellement l’entière responsabilité de l’incident sur Tripoli.
Chadli et Bourguiba posent les bases d’une alliance stratégique
Les années Chadli se traduisent par une réelle embellie entre Alger et Tunis. Un traité de fraternité et de concorde est signé en mars 1983. L’amitié fait place à ce qui ressemble, de plus en plus, à une alliance, une alliance rendue d’ailleurs indispensable par la dégradation de la situation à la frontière libyenne. Alger s’inquiète pour la stabilité du régime tunisien, confronté à une interminable fin de règne, et en butte à une virulente contestation islamiste. Fin 1984, venu au chevet d’un Bourguiba alité après une énième alerte cardiaque, le chef de l’Etat algérien déclare à son homologue : «Monsieur le Président, que Dieu vous garde en vie, mais la Tunisie trouvera toujours l’Algérie à ses côtés.» Les Tunisiens respirent : ils ont désormais la certitude qu’Alger se portera à leur secours en cas d’attaque de Kadhafi.
Le sentiment de vulnérabilité tunisien, joint au besoin d’une amitié forte avec le grand voisin de l’Ouest, qui a maintenant renoncé à ses visées hégémoniques, finit par installer l’idée qu’Alger, en tant qu’allié stratégique, aurait une sorte de «droit de regard naturel» sur les affaires tunisiennes. Cette idée est désormais un des paramètres de l’équation politique. En novembre 1987, le Premier ministre Zine El Abidine Ben Ali s’empressera d’obtenir le feu vert d’Alger avant de déclencher son « coup d’Etat médical ». Les Algériens (et les Italiens) seront les premiers informés de ce qui se tramait à Tunis, ce qui provoquera d’ailleurs une brouille passagère avec la France de Mitterrand et Chirac, mise devant le fait accompli.
Les 23 années du règne de Ben Ali vont être marquées par une conjoncture géopolitique exceptionnelle et inédite: une tranquillité parfaite aux frontières, et l’entente cordiale avec les deux grands voisins. Tunis et Tripoli se réconcilient. Kadhafi, qui s’est assagi, a besoin de la neutralité bienveillante de la Tunisie pour atténuer les effets de l’embargo aérien. Les relations tuniso-algériennes resteront au beau fixe pendant toute la période. La coopération militaire s’intensifiera au fil des années, à mesure que la pression de l’insurrection islamiste du FIS puis du GIA s’accentuera. Cette alliance sécuritaire ne sera jamais prise en défaut. La Tunisie deviendra, aux yeux d’Alger, pendant toute la période, l’allié le plus sûr dans la lutte contre le terrorisme.
Samy Ghorbel
- Ecrire un commentaire
- Commenter

M. S.G. merci infiniment pour cet intéressant rappel historique !