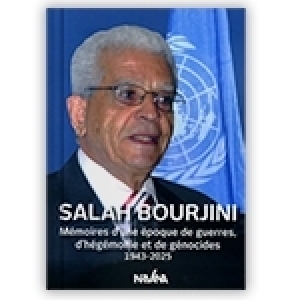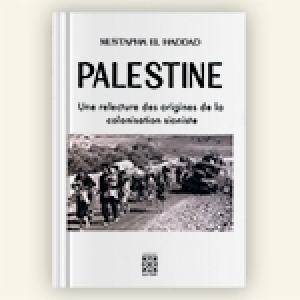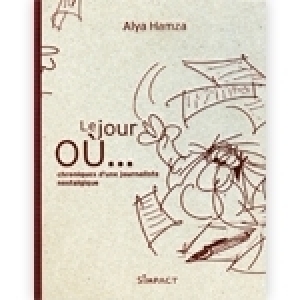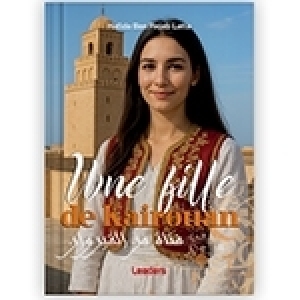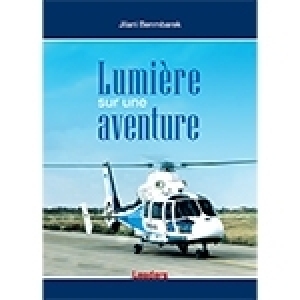Monia Kallel - Femmes en politique :seule la voix d’Abir Moussi a retenti ce jour-là

 Par Monia Kallel - 13 août 2020, le soixante-quatrième anniversaire de la promulgation du Code du statut personnel (CSP) vient couronner un été politique très chaud, ponctué de moments et de spectacles peu habituels où la tension rivalise avec le désordre et les antagonismes. Après le vote de la motion de censure contre le Président du Parlement (30 juillet), on a assisté, le 3 août, à l’anniversaire de Habib Bourguiba, l’Initiateur du CSP et fondateur la République tunisienne, anniversaire qui rappelle les « festivités » du 25 juillet. Une ambiance chaotique, et un communiqué scandaleux de l'ARP où le nom de Habib Bourguiba n'est même pas cité. Sur le terrain, le Président Kaïs Saïed, qui a refusé de se rendre au Parlement, a préféré se recueillir sur les tombes des martyrs, Chokri Belaid et Mohamed Brahmi. L'évènement a été sciemment occulté et la seule cérémonie (semi officielle) qui a été organisée ce jour-là était la célébration du premier anniversaire du décès de Béji Caïd Essebsi.
Par Monia Kallel - 13 août 2020, le soixante-quatrième anniversaire de la promulgation du Code du statut personnel (CSP) vient couronner un été politique très chaud, ponctué de moments et de spectacles peu habituels où la tension rivalise avec le désordre et les antagonismes. Après le vote de la motion de censure contre le Président du Parlement (30 juillet), on a assisté, le 3 août, à l’anniversaire de Habib Bourguiba, l’Initiateur du CSP et fondateur la République tunisienne, anniversaire qui rappelle les « festivités » du 25 juillet. Une ambiance chaotique, et un communiqué scandaleux de l'ARP où le nom de Habib Bourguiba n'est même pas cité. Sur le terrain, le Président Kaïs Saïed, qui a refusé de se rendre au Parlement, a préféré se recueillir sur les tombes des martyrs, Chokri Belaid et Mohamed Brahmi. L'évènement a été sciemment occulté et la seule cérémonie (semi officielle) qui a été organisée ce jour-là était la célébration du premier anniversaire du décès de Béji Caïd Essebsi.
Seule a retenti la voix d’Abir Moussi qui est, depuis quelques temps, sur toutes les lèvres et dans tous les médias. Journalistes, animateurs et faiseurs d'opinion relatent son parcours et esquissent le portrait de celle qui "est devenue l'icône de la croisade anti-islamiste", selon les propos de Rafik Khalsi, l’éditorialiste du « Temps ». Entre les islamistes et les modernistes, la discorde vouée à un éternel recommencent. Pareille à la "guerre des sexes" (comme on appelait l'inégalité homme/femme au Moyen âge), et à toutes les guerres à caractère idéologique, la bataille entre les adeptes de l’Islam politique et les défenseurs d’une société de droit (positif) change de jeux, d'enjeux, de langage mais persiste, résiste, et réapparaît sous de nouvelles formes.
A l'ère de l'extrême contemporain, Gilles Lipovetsky, brillant penseur, et apôtre de la modernité écrit un livre où il reconduit les vieilles typologies et les catégorisations (masculin/féminin) tout en saluant l'émergence de ce qu'il appelle "La troisième femme". Dans un discours très élégant, il annonce "le retour du masculin" dont il décrit (et regrette?) l'affaiblissement et la perte de son éclat premier face à « l'Eve nouvelle", déterminée, puissante, engagée dans les affaires publiques dont elle avait été exclue pendant des millénaires. Le livre qui a agacé les féministes offre une autre preuve que ce combat est non seulement interminable, mais qu’il fonctionne par flux et reflux ; les acquis de la femme sont toujours à (re)consolider, comme l’avait bien signalé Simone de Beauvoir.
En Tunisie, pays d’El Kahina, et d’Arwa Al Kairawania, la promulgation du Code du statut personnel (CSP) à l’aube de l’indépendance a sorti les femmes des rôles et des espaces où elles étaient cantonnées. L’interdiction de la polygamie, la contraception et la scolarisation massive ont très vite donné leurs fruits. C’est d’ailleurs à l’Université que le combat des femmes a commencé dans les années 70. Il s’est déployé sur deux fronts : contre la misogynie et le dogmatisme d’une société profondément conservatrice et contre l’hégémonie de l’Etat qui cherche à instrumentaliser la question de la femme en ayant la mainmise sur l’Union nationale des femmes tunisiennes (l’UNFT), courroie de transmission de ce « Féminisme d’Etat » promoteur « d’une émancipation sans égalité » (Sophie Bessis), comme l’explique Radia Haddad dans Parole de femmes. Imprégnées des idées de la gauche et du féminisme occidental (dans son versant universaliste), de jeunes militantes, réunies d’abord au sein du club Tahar-Haddad (dirigé par la pionnière Jalila Hafsia), ont fondé des associations (l’ATFD et l’AFTURD, notamment) qui ont tenu tête au pouvoir, et continué à œuvrer contre vents et marées. A la fois, audacieuses et discrètes, endurantes et solidaires, elles ont défendu la cause des Tunisiennes (citadines et rurales), et élargi l’horizon de leurs attentes et leurs aspirations.
La Révolution de 2011 a soudain ouvert une brèche nouvelle. Au lendemain de la chute de l’Ancien Régime, organisations, associations, (indépendantes et gouvernementales) et groupements citoyens ont tiré profit des espaces de liberté pour se reconfigurer, se constituer en réseau, et s’imposer comme un acteur socio-politique essentiel. Un travail d’arrache-pied, effectué dans les différentes régions, a permis d’inscrire l’égalité dans la Constitution, de faire élire la loi sur la parité (« horizontale et verticale »), d’inciter les femmes à se présenter aux élections, les aider à prendre la parole en public et à négocier leurs places dans les listes parlementaires. Négociations laborieuses et révélatrices : en général, le progressiste-démocrate qui est homme avant d’être acteur politique, ne voit pas pourquoi une candidate du « deuxième sexe » serait une « tête de liste » (ce sont d’ailleurs les candidates nahdaouies qui ont bénéficié de la loi sur la parité). Ce même « démocrate » ne verra pas non plus l’intérêt, ni « l’urgence » d’une loi sur l’égalité de l’héritage que feu Béji Caïd Essebsi, en héritier-continuateur de Bourguiba, essayera d’instituer.
Par une acrobatie dont l’Histoire est friande, Abir Moussi qui s’érige (et qu’on érige) comme « l’Eve nouvelle » (Gilles Lipovetsky) ne bénit ni la révolution, ni la démocratie ni le projet de loi sur l’égalité. Il faut dire que l’entrée en scène des islamistes, leurs sales manœuvres pour s’imposer et réécrire l’Histoire ont plongé le pays dans d’interminables débats identitaires au détriment des questions socio-économiques qui sont à l’origine des événements de 2011 (comme l’attestent tous les slogans brandis). Concomitamment à la dégradation du niveau de vie des citoyens, à l’affaiblissement de l’Etat, et à l’augmentation du nombre des déçus, se développe un discours contre « ladite révolution » et contre la «démocratie de façade », qui exalte (et exploite) les attitudes nostalgiques, sceptiques, aporétiques... Les argumentaires (vendables/recevables) sont nombreux : intervention de « mains » étrangères, « fabrique » dans les laboratoires américains (ou européens), amateurisme..., Idem pour la démocratie, les explications vont de la manipulation des électeurs, achat des voix, falsification des résultats, au déni du régime lui-même jugé mauvais, bancal, dépassé…en passant par la vieille théorie des races : le régime démocratique ne serait pas compatible avec la «nature » des peuples arabes (cette même théorie qui a légitimé l’esclavage, la colonisation, l’Impérialisme...)
Abir Moussi a nourri ce discours et s’en est nourrie. En faisant de la résistance contre les « khouanjias » (appellatif qu’elle chérit) son cheval de bataille, son « fonds de commerce » (écrit l’éditorialiste dans l’article précité), elle s’est vu propulsée au- devant de la scène, une scène horriblement vide après le décès de feu BCS, le déclin de la gauche, et la faillite de la classe politique.
Aujourd’hui, c’est une femme qui, à son corps défendant, tente de faire barrage à l’islamisation rampante en se dressant contre Ennahda plus que jamais manœuvrière, arrogante, et qui cherche, elle aussi, à profiter de ce vide, un moment historique inespéré pour elle. C’est également une femme qui bloque la laborieuse marche de ses consœurs, et devancières. Pas d’urgence pour les libertés individuelles et l’égalité successorale qui sont, prétexte-t-on, conçues à des fins électoralistes (par feu BCS) et « mal étudiées » par le « Colibe ». Un combat en chasse donc un autre, et la question de la femme est mise en sourdine, renvoyée aux calendes grecques.
Pour se positionner dans le paysage politique, chasse gardée des hommes, la femme «qui vaut plus que mille hommes» (selon l’expression de ses partisans), s'invente une posture nouvelle et campe dans l’image de la Tunisienne Puissante, Intransigeante, et Pure qui n'admet aucun compromis, (ou voit dans tout compromis une compromission), aucun mélange des genres (ni avec ses adversaires ni avec sa "famille" politique), et qui est déterminée à faire le « tri » dans la classe politique. « Nifriz », dit-elle. Abstraction faite du mot qui connote la friperie et la chosification des humains, il y a lieu de se demander sur son sens (signification et orientation). S’agit-il de rompre avec le « tawafok » (qui a montré ses limites) en amenant chaque parti à clarifier ses choix, à définir sa position sur l’échiquier politique, et à préciser ses objectifs et son référentiel (religieux ou civique)? Ou d’isoler les islamistes, de les exclure du paysage?
« Chasser » les « Occupants », ces «Ennemis » venus d’ailleurs, pour « libérer », le pays (le « nettoyer », l’« épurer »...) constitue la seule voie de sortie, le seul acte qui définit le patriotisme et en fonction duquel ses supporters cataloguent les personnes (islamistes et autres) et distribuent les étiquettes du patriote ou non patriote décliné en traître, mercenaire, vendu…sans nuance, ni recul critique, ni la moindre inquiétude quant aux implications et répercussions de tels propos (sur tous les citoyens tunisiens), le changement de catégorie (le patriote basculant dans la traitrise ou inversement), étant rapide, aléatoire, dépendant d’un mot, un point de vue, un geste. Que pense- telle de ce « langage » qui fait écho au takfirisme (dans sa forme tranchante, du moins)? Est-elle sure qu’il n’y a aucun lien entre ses flamboyants discours, ses réquisitoires enflammés et la rhétorique des clivages, et des étiquetages de ses adorateurs?
La promesse d’éloigner les islamistes par la force de la loi, et le recours au « kanoun » est intéressante et légitime. Mais faut-il qu’elle soit doublée d’un langage et une scénographie appropriés. Enoncé dans les hauts lieux du pouvoir, le discours politique (qui a ses caractéristiques, sa tradition, ses théoriciens et analystes, voir, Maingueneau, Charaudeau, Abdessalem Mseddi…) est, par définition, rigoureux et mesuré, percutent et coopératif, démonstratif et allusif. A moins qu’on ne cherche à jouer sur les deux tableaux, et qu’on mise sur les deux « styles » ? Curieux de la part des amateurs de la « clarté » et de la Grande éloquence ; tant pis pour l’oxymore !
"Que faire de Abir Moussi ?" titre le journal "le Temps?" (du 22 juillet 2020). Les destinées personnelles, comme les partis- et feu Béji Caïd Essebsi l’a bien dit- importent peu. En revanche, la Patrie appelle et attend nos questionnements. De quoi demain sera-t-il fait ? Que va-t-on faire de ce pays ? Et de son peuple qui, en un instant de son Histoire, a eu la bêtise ou l’audace d’investir les rues et de déboulonner le dictateur ? Et sur quoi va déboucher cette « révolution atypique » (Sophie Bessis) déjà inscrite dans les livres et rattachée à la «particularité tunisienne » ou « la tunisianité » (selon ce concept cher à Bourguiba). Non seulement les doutes, stigmatisations, dénis n’y changent rien, mais ils offrent aux islamistes la possibilité de se réapproprier l’Histoire, et de se positionner en Initiateurs de la révolution (qu’ils n’ont pas faite), en défenseurs de la Démocratie, Droits de l’Homme, libertés (auxquels ils ne croient pas) et en Promoteurs de l’«Eve Nouvelle », pivot du « féminisme islamique ». Ce nouveau-né (depuis une décennie environ) se dote de théoriciens (Rached Ghannouchi en tête), de programme, et d’organes de diffusion très puissants qui attirent un fervent public (jeune surtout) de plus en plus large. Rien d’étonnant à ce que les Nahdaouies se chargent de défendre, bec et ongle, leur Maître à penser, et d’embellir la vitrine islamiste au centre de laquelle figure la femme politique, ouverte, démocrate, autonome, libre de ses choix, et de son corps qui peut être voilé ou non voilé, genre Souad Abderrahim.
Une économie aux abois et une démocratie balbutiante, qui peine à se mettre en place, peuvent-elles supporter longtemps ces affrontements où s’amalgament le politique, l’idéologique, l’historique et le culturel (des champs aux temporalités, référentiels, et moyens d’action si différents) ? Où montent les surenchères rhétoriques, et se propage les violences, symbolique et réelle (l’une n’allant pas sans l’autre) ? Le penseur René Girard l’explique ainsi : « il faut [lui] reconnaître un caractère mimétique d’une intensité telle que la violence ne saurait mourir d’elle-même une fois qu’elle est installée dans une communauté ».
Ces questions semblent évitées. Mais, les scénarios pullulent avec les mêmes variantes chez les clans antagonistes. On va, dit-on, vers la "libanisation" de la Tunisie, la fracture sociale, le conflit civil…Et alors ! Advienne que pourra, « je prendrai les armes s’il le faut » (pour reprendre l’expression d’une activiste tunisienne). Paroles de pessimistes et jérémiades à la Cassandre répliquent les enthousiastes qui pensent qu’il suffit de "couper la tête" pour que "les veines se dessèchent" ; et puis ça ne risque pas d’arriver, car « nos ennemis » sont des « lâches » ; comme les rats, ils quitteront le navire très vite. Les pragmatiques, eux, avancent l’idée que les voix radicales, étant pour l’instant, les seules capables d’en finir avec les « khouanjias », on peut/doit s’en servir (comme d'un bon outil) en attendant... Demain est un autre jour, et de toutes les façons, "Dieu reconnaîtra les siens!"…Le capharnaüm !!!!
Lorsqu’il voulait interroger un phénomène social complexe, Flaubert allait demander l'avis d'un historien, ou consulter un livre d’Histoire, convaincu que le passé décide du présent et éclaire l'avenir. A l'époque la sociologie, la psychologie, l'anthropologie n'existaient pas encore (comme champs de connaissance). N’existaient pas non plus les études de genre qui ont montré que l’aspiration aux valeurs républicaines passe nécessairement par la déconstruction du patriarcat, pilier et moteur de toutes les formes d’inégalités (sexes, races, classes, ethnies…). Feu Gisèle Halimi, explique sans équivoque, ni fioritures : « Si je dois choisir, je choisirais mon combat. Celui de faire reconnaitre les femmes comme des êtres humains à part entière ». L’écrivaine engagée, avocate de son état, sait que l’égalité des sexes n’est pas un combat mais Le Combat : il fonde un projet sociétal, et ne vient pas s’y annexer.
Où est la Société Civile ? « Où sont les hommes », au sens que donne Patricia Kass à l’expression dans sa merveilleuse chanson-programme.
« Nous, sommes là, les jeunes filles de la politique, à « gauche de l’Histoire où son cœur palpite»(1) , écrit Aïcha Guellouz dans Banet Essiyasa. Six militantes y livrent des témoignages troublants sur les traitements qu’elles ont subis sous la dictature, et signent, en véritables Antigones, l’entrée des femmes dans l’Histoire politique de la Tunisie moderne.
Le chemin est encore long et épineux, mais elles sont bien « là », porteuses d’un immense rêve qu’elles sauront transmettre à leur progéniture.
Monia Kallel
(1) C’est nous qui traduisons de l’arabe.
- Ecrire un commentaire
- Commenter

Pourquoi avoir oublié Wassila? Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on ne peut pas nier qu'elle a joué un rôle majeur dans la vie politique tunisienne. Vous pouvez être sûre Mme Kallel que beaucoup de décisions de Bourguiba en faveur de la femme, notamment sur les questions d'héritage ou de divorce ont été prises sous la pression de Wassila.

Bravo.J ai rarement lu un article aussi bien ecrit solide et argumente .Merci madame Kallel.