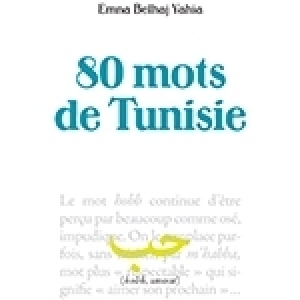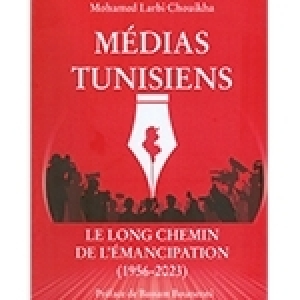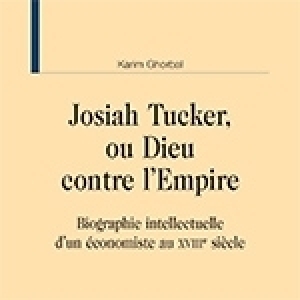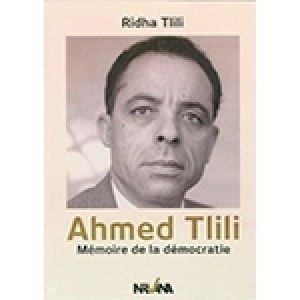La finance en crise
La plupart des pays, industrialisés ou en voie de développement, et la plupart des institutions financières et principalement bancaires, ont connu des difficultés de toute nature allant, pour certains, jusqu’à la crise et à la cessation d’activité n’était l’intervention des Etats pour leur porter secours comme c’est le cas des quatre premières banques d’Irlande dont il a fallu reconstituer les fonds propres engloutis par les pertes ou des principales banques d’Espagne dont le redressement exigerait plus de cent milliards de dollars des Etats-Unis.
Ne parlons pas de la Grèce et de ses banques qui sont en pleine crise. La crise a affecté en premier lieu les Etats-Unis dont une des principales banques, Lehman Brothers, n’a pas pu être sauvée et qui ont été contraints de soutenir au moyen de sommes folles leurs institutions financières comme la première organisation du monde de l’assurance. En Europe, le classement des banques espagnoles a subi une dégradation ainsi que les banques italiennes qui ne sont pas encore sorties de la crise. Et l’on se souvient encore de la faillite historique du Crédit Lyonnais, restée longtemps la plus importante en France.
La crise a atteint la Tunisie en tant que pays émergent ainsi que ses principales banques qui ont subi une dégradation de leur rang par les agences de notation. Elles sont maintenues en vie grâce au secours de la Banque Centrale qui a atteint un montant jamais connu jusqu’ici : plus de 5 milliards de dinars !
On doit alors se poser la question : pourquoi cette crise qui date déjà de quelques années et qui menace de durer et de s’amplifier ?
I/ Qu’en est-il de la crise de la finance publique ?
Il y a des causes générales qui tiennent à l’évolution globale de la gestion de l’Etat et de ses finances. Disons que dans l’ensemble, la plupart des Etats, développés ou non, ont vécu au-dessus de leurs moyens, ce qui s’est traduit par une croissance démesurée de la dépense publique et à un endettement excessif aussi bien des Etats que de leurs banques et autres institutions financières.
Malgré l’évolution de l’économie et de la société, les Etats ont continué à assumer des tâches qui pouvaient être assurées par des entités non étatiques ressortissant de la société civile. Cela peut aller du transport, où l’intervention de l’Etat ne s’impose pas, jusqu’au système éducatif où le monopole ou quasi monopole, institué dans de nombreux pays même industrialisés, ne s’imposait plus. Les ressources fiscales se sont trouvées insuffisantes pour faire face à l’aggravation incessante des dépenses résultant des charges lourdes assumées par l’Etat. Ce dernier ne s’est pas contenté d’assumer le rôle et les fonctions où il est irremplaçable : en premier lieu les domaines de la souveraineté comme la sécurité publique, la défense, la justice et les relations étrangères, en second lieu une intervention limitée aux secteurs ou domaines qui dépassent les possibilités du secteur non étatique ou enfin et je dirais surtout le pilotage général de l’économie, la définition de la politique économique dans les principaux domaines comme la fiscalité, le crédit qui autrement n’évoluent guère et ne s’adaptent plus à l’évolution générale de l’économie. Au lieu d’agir en souverain et en pilote, où il est irremplaçable, il se comporte, comme ses administrés, en producteur, en commerçant, en importateur, en exportateur, banquier, assureur et devient dans de nombreux cas juge et partie, augmentant par exemple les salaires d’une entreprise publique en grande difficulté, ce qui conduit à une augmentation similaire des salaires dans l’ensemble des entreprises.
Et parfois c’est le contraire, une grande puissance comme les Etats-Unis engage des dépenses énormes comme « gendarme » du Monde et se trouve incapable d’établir un système d’assurance sociale assurant le minimum de soins pour les plus démunis.
Donc augmentation incessante de la dépense publique et accroissement de la dette publique dont la charge de rémunération et de remboursement en vient à représenter une part considérable des dépenses budgétaires laissant peu de place aux dépenses ordinaires répétitives ou aux dépenses d’équipement. Autant, dans le passé, le rôle de l’Etat était très restreint au point qu’on l’a appelé au secours pour investir, créer des emplois et accroître la production, autant depuis qu’il s’est engagé dans cette voie, il se heurte à une course-poursuite entre la ressource et la dépense, la première ne pouvant pas suivre l’expansion excessive de la seconde.
La finance publique retrouvera un meilleur équilibre lorsque l’on réussira une répartition adéquate des tâches entre l’Etat et le secteur privé et la société civile et une répartition de la charge fiscale de façon à soulager le contribuable, à renforcer les entreprises et les entrepreneurs et à leur permettre d’accroître leurs moyens affectés à la production, à l’emploi et à l’expansion économique. Ce sera là une rude évolution touchant à des « droits acquis » qu’il sera difficile aux dirigeants politiques d’affronter. Réduire les cotisations à l’assurance sociale tout en ne faisant bénéficier de ses prestations que les personnes les plus démunies et en laissant à la charge des assurés une part de plus en plus importante des dépenses relatives aux petits soins ne nécessitant pas des sommes trop importantes. C’est là un des multiples exemples d’une réforme de l’Etat qui exigera beaucoup de courage, demandera du temps et de la continuité : pourra-t-elle se faire ? Seuls en tout cas pourraient éventuellement la réaliser les gouvernements démocratiques et légitimes capables de dire la vérité à l’opinion, leur conduite des affaires étant transparente à tous égards et dans tous les domaines.
Heureux les pays qui auront un jour la chance d’être dirigés par ce genre de gouvernement.
Aussi bien les Etats démocratiques avancés que les Etats autoritaires et peu démocratiques sont confrontés à ce problème majeur de l’organisation des pouvoirs publics et du jeu de la démocratie. Celle-ci se transforme vite en une course à la facilité pour « conquérir » les électeurs, ramasser le maximum de voix et durer au pouvoir. Les promesses électorales n’ont pas de limites et ne font qu’aggraver le problème. D’autant plus que le pouvoir, malgré l’effort entrepris pour le « décentraliser » et le partager avec les citoyens, reste concentré entre les mains du pouvoir central qui est considéré comme le responsable des malheurs et des joies du pays : les citoyens sont peu à peu transformés en spectateurs et la concentration outrancière du pouvoir reste une plaie considérable des Etats. Seuls des gouvernements authentiquement démocratiques, légitimes et crédibles sont à même de résister à la démagogie des promesses difficiles à tenir et d’affronter les vrais problèmes et réussir à être entendus.
A l’échelle des Etats, il y a lieu de supprimer l’orgueil des gouvernants, de faire participer la population, de décentraliser les institutions, communes et régions et de leur faire assumer leur destin, d’associer toutes les catégories de la société civile à l’ensemble de la vie économique pour alléger les charges de l’Etat, réduire la fiscalité, encourager les entreprises, organiser la solidarité nécessaire au sein de celles-ci pour éviter les grèves et sacraliser le travail, l’effort et combattre la paresse, l’anarchie et le laisser-aller.
Le problème fiscal comme exemple de la difficulté de gérer la chose publique
Un des problèmes les plus difficiles à aborder est celui du régime fiscal. La tendance générale est de conserver ce qui existe et d’augmenter les taux pour « boucher les trous », d’où la hausse générale des impôts, l’évasion et la fraude fiscale et une méfiance, sinon une hostilité permanente entre le pouvoir et les contribuables. Je me suis heurté à ce problème en tant que ministre du Commerce et de l’Industrie d’abord et celui des Finances ensuite. Les entreprises du secteur commercial et industriel étaient soumises à différentes taxes, à la production, à la consommation et de prestations de services à des taux faibles mais répétitives à chaque transaction et laissant le poids de l’impôt à la charge de ces entreprises, ce qui était de nature à augmenter les prix à la production et de nuire à la compétitivité générale de l’économie. J’ai effectué une large enquête de ce fait montrant que ces produits supportaient une hausse de leurs prix de revient comprise entre 10 et 15% dans la plupart des secteurs industriels. Cela se passait en 1967. Le problème était posé. Mais ce n’est qu’au cours des années 1979 en tant que ministre du Plan que j’ai pu mettre en place les premiers éléments de la TVA (Taxe à la valeur ajoutée), qui abolissait la rémanence fiscale, en épargnant l’entreprise et en «transportant» l’impôt jusqu’au consommateur, le contribuable réel et final. Je reprendrai le problème au début des années 1980 en tant que responsable du Plan et des Finances et ce n’est qu’à la fin de cette décennie que la TVA a achevé son parcours qui a duré ainsi une vingtaine d’années .
Mais « l’affaire » ne s’arrête pas là. La TVA posait un problème de taux. Les besoins de l’Etat, toujours grandissant, ont abouti à la fixation d’un taux de base élevé, 18% qui ne peut que conduire à l’évasion et à la fraude fiscales. Les « taux » tuent les « totaux », c’est évident. Plus le taux est élevé, plus la recette est faible, c’est inévitable. Le taux élevé complique également le problème du remboursement. En effet, l’entreprise paie la TVA en amont, c'est-à-dire l’achat de biens ou services pour ses fabrications et perçoit la TVA sur ses propres ventes à l’aval c'est-à-dire à la vente de ses produits. Si les montants payés en amont sont plus élevés que ceux perçus en aval, l’entreprise doit être remboursée de la différence par le Trésor régulièrement à chaque déclaration mensuelle. Or le fisc, toujours réticent à l’idée de « rembourser », n’exécute pas immédiatement ledit remboursement et « menace » l’entreprise d’une « vérification approfondie » avant de payer, ce qui peut durer longtemps et mettre l’entreprise en difficulté, des sommes, parfois très importantes, restant ainsi bloquées et sa trésorerie en difficulté. C’est là une façon de mettre à la charge de l’entreprise, fût-ce temporairement, la charge de l’impôt, ce qui constitue cette rémanence fiscale alors que l’entreprise ne joue qu’un simple rôle d’intermédiaire entre le contribuable et le fisc, aidant ce dernier à collecter l’impôt. Ce manque de loyauté n’est pas sans aggraver la méfiance entre les deux partenaires et explique en grande partie la fuite de l’impôt, surtout lorsque ce taux est élevé.
Donc baisser le taux et « jouer le jeu » en ce qui concerne le remboursement sont les deux facteurs de réconciliation et d’acceptation de l’impôt. Et il me semble certain que c’est dans l’intérêt des deux parties : les recettes provenant de la TVA ne pouvant qu’augmenter.
Je l’ai vérifié au début de 1980 lorsque j’ai entrepris d’examiner la fiscalité directe : l’impôt sur le revenu des personnes physiques et l’impôt sur le bénéfice des sociétés. Le caractère excessif de l’impôt était flagrant. Il était de 36% pour les industriels et de 46% pour les commerçants.
Un commerçant personne physique’ ayant gagné un bénéfice de 10.000 Dinars devait donc payer 46%, c'est-à-dire 4.600 Dinars, solde qui devait supporter encore l’impôt sur ce revenu disponible. Or l’échelle de la taxation à l’époque prévoyait le taux maximum à 8.000 Dinars seulement. Il ne devait lui rester que les yeux pour pleurer : il évite les pleurs en faisant une déclaration adaptée à la situation ! J’ai réduit considérablement ce taux, presque de 50%, pour effacer une disposition aussi périmée et j’ai élevé les 8.000 à 80.000 Dinars. Restait l’impôt sur le bénéfice des sociétés, 36% pour les sociétés industrielles et 46% pour les sociétés commerciales. J’ai établi une trajectoire qui devait réduire de 2% l’impôt chaque année pendant 10 ans pour le ramener à un niveau acceptable autour ou même au-dessous de 20%. La première réduction de 2% a soulevé des gémissements de la part des ministères consommateurs craignant une diminution de leurs crédits. Ce fut le contraire qui est arrivé : la recette a augmenté visiblement. Rassurés, les contribuables ont « joué le jeu », certains ayant fait des déclarations plus sincères, l’ont regretté après mon départ des Finances, la « routine » ayant repris son cours.
Alléger les charges de l’Etat, moderniser la fiscalité, rétablir des rapports loyaux et de confiance entre les partenaires constituent autant de nécessités pour éviter la crise des finances publiques. Celles-ci méritent d’autres développements difficiles à aborder dans le cadre de cet article.
II/ Qu’en est-il de la crise de la finance privée ?
Reste à examiner la crise de la finance non étatique et particulièrement la situation du secteur bancaire. La banque, instrument de financement de l’économie, constitue un outil essentiel qui ne fait que se détériorer étant donné la mauvaise gouvernance qui y règne et qui ne fait que s’aggraver comme l’a révélé la crise installée dans ce secteur et dans le monde entier, depuis surtout 2008. L’on peut s’en rendre compte en lisant le « compte rendu » de la crise décrit par Jacques Attali dans son livre La Crise et Après ? à partir de la page 103.
La tradition était de séparer les banques de dépôt qui utilisent comme ressources principales les dépôts de leurs clients et les banques d’investissement, ou de développement qui utilisent principalement leurs fonds propres ou des emprunts à moyen ou long terme auprès du marché financier. Les premières financent le « court terme », c'est-à-dire les opérations commerciales, de vente ou d’achat, d’importations ou d’exportation qui nécessitent des concours bancaires pour une courte période, de 3 à 9 mois suivant la nature de la transaction ou de l’opération. Ils utilisent en effet des ressources ne leur appartenant guère et doivent être prêts à tout moment à les remettre sans délai à la disposition du déposant et c’est ce qui fonde la confiance dans une banque. A l’ouverture de la Banque Centrale et à l’occasion de la création de la STB, un déposant est venu ouvrir un compte et y déposer une somme d’argent et s’est vu remettre un carnet de chèques. Inquiet de s’être ainsi dépouillé de son bien, il revient au guichet après avoir atteint la porte de sortie, signe un chèque pour retirer son argent. Il a vu l’employé le faire sans hésitation. Voyant cela, le client se décide à remettre l’argent dans le compte, ayant vu qu’on ne va pas le lui confisquer et qu’il peut le reprendre à tout moment.
Les banques de dépôt doivent donc mériter et garder la confiance de leurs clients. Pour pouvoir y parvenir, elles doivent gérer ces dépôts le plus soigneusement possible et les crédits qu’elles accordent à leurs clients doivent être aussi « liquides » que les dépôts des clients et pour ce faire, ces crédits doivent obéir à des règles strictes de prudence, de garanties et de division des risques. Toujours à l’ouverture de la BCT, une petite banque française installée à Tunis avait des dépôts de l’ordre de 500 millions d’anciens francs tunisiens dont la moitié a été utilisée pour accorder un crédit considérable à une briqueterie qui est tombée en faillite en entraînant la banque dans sa chute, cette dernière ne pouvant plus satisfaire ses déposants qui avaient besoin de récupérer ou d’utiliser leurs dépôts. Le propriétaire s’est suicidé et la STB, sur la demande de la Banque Centrale, a repris ce qui reste de cette banque et de la briqueterie.
Pourquoi cette défaillance : le directeur de cette banque a cru pouvoir disposer comme il entend et comme si c’était son bien propre, des dépôts de ses clients. Et c’est ce qui arrive aujourd’hui dans les banques de dépôt dont les dirigeants sont dans le même état d’esprit, comme j’ai eu le loisir de le constater après 20 ans dans ce métier.
Qui gouverne en effet ces banques de dépôt ? Ce sont les actionnaires qui ne « risquent » que le montant de leur mise dans le capital de la banque, lequel ne représente que 4 à 5% des ressources dans une banque de dépôt alors que les dépôts de la clientèle en représentent les 95%. Pour la banque que je connais, ce capital est de l’ordre de 170 millions de Dinars alors que les dépôts représentent cinq milliards et demi de dinars environ.
Une petite minorité gouverne donc la Banque et la majorité, les déposants, n’a aucun droit de regard sur l’utilisation qu’on fait de leurs dépôts. Le sort de ces dépôts est en jeu. Si la banque ne gère pas convenablement ses crédits, elle peut tomber en faillite et ne pourra pas rembourser les dépôts des clients sauf intervention massive de l’Etat et donc du contribuable. Une gestion rigoureuse des crédits s’impose donc pour éviter les impayés, les crédits gelés et ceux irrécouvrables qu’on doit provisionner, c'est-à-dire les remplacer par des montants prélevés sur les bénéfices et si nécessaire sur les fonds propres de la banque, ce qui est évidemment de nature à l’appauvrir et à priver les déposants d’une bonne rémunération de leurs dépôts. Or le mode de direction de la Banque de dépôts n’incite pas à la bonne gestion de celle-ci. En effet, le conseil d’administration est composé des actionnaires disposant du plus grand nombre de voix au sein de l’Assemblée générale des actionnaires. Les plus gros actionnaires se trouvent être généralement des hommes d’affaires et constituent la majorité du conseil d’administration. Avec le peu d’argent qu’ils ont mis dans la banque, ils vont prétendre pouvoir bénéficier de crédits importants, peu garantis et à des conditions de faveur dont notamment des intérêts à un taux favorable.
L’intérêt et la rentabilité de l’institution ne constituent pas leur première occupation. Par ailleurs, ils ne peuvent guère jouer un rôle déterminant dans la gestion de la banque et l’examen des crédits ne pouvant accéder aux dossiers de crédits dont certains concernent leurs concurrents, secret professionnel oblige, c’est donc le staff de la Banque qui examine ces crédits et se faisait aider par les membres du conseil d’administration neutres et qui ne bénéficient pas de crédits de la banque. C’est un système absurde. Il l’est d’autant plus qu’il organise la complicité entre le conseil d’administration et le personnel de direction sur le dos de la Banque. Des crédits favorables sont consentis par la direction de la banque et des avantages financiers importants sont consentis aux dirigeants de celle-ci. D’où les abus de toutes sortes.
Le système doit être changé. Ce sont les déposants détenant 95% des ressources utilisés qui sont les mieux placés pour gouverner la banque et constituer le conseil d’administration, ce qui leur permet de protéger leurs avoirs et leurs intérêts. Ces déposants doivent être actionnaires de la banque et l’assemblée générale des actionnaires doit désigner parmi eux les membres du conseil d’Administration à condition qu’ils ne bénéficient pas de crédits de la banque, n’ayant pas d’entreprise à gérer. Les autres actionnaires déposants ou non mais bénéficiant de crédits de la banque ne pourront plus, dans cette formule, accéder au conseil d’administration. Ainsi la banque va échapper à l’influence du secteur des affaires et par voie de conséquence à celle du monde politique dont les liens avec les affaires sont évidents.
Les hommes d’affaires sont trop vulnérables et trop influençables pour pouvoir gérer sainement une banque de dépôt. Ce qui leur importe, c’est de protéger leurs affaires et de tenir compte de considérations autres que l’intérêt direct de la banque. J’ai constaté cette vulnérabilité de très près en dirigeant la banque que j’ai créée et je me suis souvent trouvé en conflit avec cette catégorie d’actionnaires, n’étant pas moi-même homme d’affaires concerné par des crédits importants. Limiter les crédits d’un homme d’affaires membre du conseil d’administration est une entreprise redoutable à laquelle j’ai été souvent confronté.
Changer le mode de gestion, comme on vient de le souligner, est la seule solution possible. On a beau établir des ratios de toutes sortes concernant les montants des crédits et les garanties, les dérapages continueront et les crédits compromis ne cesseront pas d’augmenter. Aller opposer un « ratio » quelconque à un proche du pouvoir, celui dictatorial notamment, pour éviter un crédit surabondant et irrécupérable et vous ne serez écouté que d’une oreille distraite. C’est donc le degré de vulnérabilité des dirigeants vis-à-vis des affaires comme de la politique et du pouvoir qui est le plus important.
Il y a lieu également de renforcer cette invulnérabilité en interdisant la participation au capital d’une banque de dépôt à plus de 10% pour rendre la gestion de la banque neutre et indépendante. L’obscurité peut régner dans ce secteur si un actionnaire, une famille ou un groupe d’actionnaires, surtout s’ils sont débiteurs auprès des banques, contrôlent le capital de la banque et procèdent à une gestion dans leur propre intérêt. La banque est un organisme public, d’intérêt général, jouant un rôle considérable dans l’économie et elle doit échapper au contrôle de minorités privilégiées.
III/ La banque et le développement
La crise bancaire ne se limite pas à la gouvernance des banques de dépôt. Elle concerne également le rôle du système financier dans le développement économique. Ce rôle a été énormément controversé et on n’a guère abouti à une solution satisfaisante. On peut même dire qu’on a en fait renoncé à faire jouer à la banque un rôle substantiel dans le développement du pays. Au départ, la Banque Centrale a joué à la dame qui ne veut pas se « mouiller ». Elle se limitait au court terme et refusait toute initiative de nature à l’engager dans le développement du pays.
Une fois l’Institut d’émission créé, j’ai proposé en tant que directeur général de la Banque Centrale de créer au sein de celle-ci un institut de développement dont la mission serait de promouvoir le développement du pays qui vient d’accéder à l’Indépendance en utilisant l’appareil bancaire qui s’est enrichi de quelques institutions tunisiennes animées du souci de la promotion des investissements et de la croissance économique. Devant le refus du gouverneur de la BCT, feu Hédi Nouira à l’époque, on a été conduit à créer une « Société nationale d’investissement » au capital de un million de Dinars dont la souscription par le public a été rendue obligatoire. Son objet a été, erreur qui la conduira à l’échec, exclusivement la participation au capital des entreprises promotrices de projets d’investissements. Elle a en effet vite fait de « consommer » ce capital en l’utilisant dans la souscription au capital d’entreprises nouvelles dont certaines appartenaient au secteur public et elle est restée immobilisée, les actions ainsi acquises ne pouvant être cédées, n’ayant pas mûri et ne pouvant procurer des dividendes aux acheteurs. Devant cette « panne », le président de la République m’a demandé, tout en gardant mes fonctions à la Banque Centrale, d’étudier la question et de proposer des solutions et j’ai été nommé, pour ce faire, président-directeur général de la « SNI » pour pouvoir agir.
La solution consistait à transformer la SNI en banque nationale d’investissement ( BNI ), qui ne doit pas se limiter à la participation au capital mais qui doit pouvoir accorder des crédits d’investissement, à moyen et surtout à long terme, aux promoteurs pour financer leurs projets, prêts qui, grâce à leur remboursement échelonné, permettait le renouvellement des ressources de la banque.
Encore fallait-il trouver pour la BNI des ressources lui permettant d’accorder de tels crédits : des propositions concrètes ont été élaborées pour ce faire.En premier lieu émission de « certificats d’investissements » auprès des banques de dépôt, parallèlement aux bons d’équipement émis par le Trésor et souscrits par les banques, le Trésor pouvant en outre s’adresser au marché financier étant l’emprunteur le plus crédible, en second lieu, utilisation des bénéfices de la Banque Centrale, qui ne pouvaient qu’augmenter rapidement au lieu de les verser au Trésor, et enfin réescompte auprès de la Banque Centrale des échéances des prêts consentis ayant moins de 2 ans et des emprunts extérieurs avec la garantie de l’Etat. On procurait ainsi à la BNI des ressources longues et renouvelables lui permettant d’exercer une activité continue.
Et on a commencé à travailler avec l’espoir que ces propositions seront discutées, enrichies et adaptées et en attendant, on a pu obtenir une augmentation du capital de 4 millions de Dinars. Installés dans un local rudimentaire, on a pu sortir les premiers projets, dont notamment celui concernant l’industrie textile. Un rapport approfondi a été établi avec le concours du professeur Maillard, dont je garde la copie, et qui a été à l’origine du lancement de l’industrie textile et la création de ce syndicat avec un capital de 10.000 Dinars pour démarrer et qui deviendra la Sogitex.
Malheureusement, nos efforts vont finir par échouer, le soutien du président de la République en personne qui a prononcé deux discours pour annoncer la création de la BNI. Toute la bureaucratie s’est liguée pour pousser à l’échec, pour des raisons « irrationnelles » et peu objectives,la BNI, citadelle du capitalisme pour les uns, inutile pour les autres, refus de lui attribuer les ressources nécessaires pour la Banque Centrale. Celle-ci ira plus loin et refusera le détachement de l’équipe qui a accepté de se consacrer à la création de la BNI et au développement malgré l’attrait reposant de leurs fonctions à la BCT. On me remercie en me remplaçant à la BCT et je commence ma première « traversée du désert » : la Tunisie n’a pas de gouvernement malgré le système présidentiel qui organise en fait l’irresponsabilité et l’imprévision, telle a été alors ma conclusion.
La suite des évènements me donnera raison. Devant le nouvel échec, inévitable de la SNI, on a été contraint de faire appel à l’extérieur, à la Société Financière Internationale (SFI), filiale de la Banque Mondiale, signe pénible de l’incompétence reconnue par les responsables du domaine financier et bancaire. La SFI aboutit à la même conclusion : transformer la SNI en BNI. Mais tout en acceptant d’en devenir actionnaire, elle n’apporte pas de solutions durables et efficaces au problème des ressources. La nouvelle institution, Banque de développement économique de la Tunisie (BDET), vivra avec des ressources d’emprunt auprès de la SFI et d’autres organismes financiers extérieurs arabes et européens. Ces prêts sont garantis par l’Etat. Ce dernier doit les subventionner pour que le taux d’intérêt pratiqué par la Banque soit acceptable pour les promoteurs. Solution bureaucratique, boiteuse et qui ne pouvait durer, ne permettant pas à la BDET de vivre un jour par ses propres moyens. Aussi, après avoir rendu des services éminents au pays, elle sera fusionnée avec la STB par le gouvernement de Ben Ali qui n’a que faire de ce « casse-tête ». Il en sera de même de la BNDT, Banque nationale de développement du tourisme. Et aussi des quatre banques de développement créées en commun avec les pays du Golfe et qui vont permettre la mobilisation de 750 millions de Dinars.Après avoir utilisé leur capital, elles s’immobilisent. Ces banques de développement ont été purement et simplement transformées en banques commerciales, sous le couvert théorique de banques « universelles », c'est-à-dire « bonnes à tout faire ».
Cette évolution attristante confirme la règle d’or qui veut qu’une banque de dépôt utilisant les dépôts du public qui peuvent être retirés à tout instant, ne peut pas financer l’investissement qui requiert des ressources longues renouvelables. Et en effet, une autre expérience a eu lieu avec ces banques de dépôt qui consistaient à les obliger à consacrer 25% de leurs dépôts au financement à moyen terme de projets d’investissement en vérifiant chaque fin de mois qu’ils obéissent à cette réglementation, sinon l’insuffisance constatée est punie par un dépôt non rémunéré à la Banque Centrale, bureaucratie tatillonne, la vérification pouvant se faire trimestriellement ou semestriellement ou annuellement de façon à permettre aux banques d’étudier leurs projets convenablement pour éviter les « déchets ».
Cette obligation a fini par disparaître, ce qui a conduit les banques à privilégier les crédits à la consommation qui ont atteint des niveaux extravagants et aggravé le déficit de la balance des paiements.
IV/ Crise des finances extérieures
Ladite balance des paiements est en déficit depuis l’Indépendance. En effet, la balance commerciale est largement déficitaire : les exportations de biens ne couvrent qu’environ 70% de nos importations : une donnée quasi permanente. Encore faut-il préciser que c’est grâce à la loi d’avril 1974 que ce déficit est limité à 30%. Les entreprises de la loi de 1974 enregistrent un excédant important qui ne suffit pas cependant à couvrir l’énorme déficit du secteur ne bénéficiant pas de cette loi. Le déficit commercial est comblé par la balance des services : tourisme et transport des travailleurs tunisiens à l’étranger. Il reste encore un déficit de la balance courante (biens et services) qui s’appelle le « déficit courant ». Ce déficit est couvert par le recours à l’apport extérieur sous forme de dons, d’investissements directs étrangers (IDE) et surtout d’emprunts à court, moyen et long terme auprès des organismes financiers publics à l’étranger ou sur le marché financier international, d’où l’aggravation de la dette extérieure dont le remboursement en principal et intérêts a été évalué à 27 milliards de Dinars pour le XIe Plan.
Un énorme effort est à faire pour promouvoir nos exportations de biens et services de façon à ce que le « déficit courant » annuel de l’ordre de 2 milliards de Dinars se transforme en « excédant courant » qui nous permettra de réduire l’endettement et donc la dépendance vis-à-vis de l’extérieur.
Il est évident donc que le domaine financier dans son ensemble est en crise. Il y a lieu de tout revoir dès que l’agitation des prétendants au pouvoir se calmera et que le pays se remettra au travail !
M.M.
- Ecrire un commentaire
- Commenter

J'ai lu et relu avec plaisir ce long article.L'aspect fiscal et bancaire ont retenu particuliérement mon attention.Je dis que la Tunisie a des competences qui ont roulé leurs bosses un peu partout.Je propose qu'ils se réunissent dans un comité apolitique, qu'ils s'entourent de jeunes cadres économiques, financiers et monétaires pour analyser la situation économique, financiére et monétaire du pays et proposer aux sevices du Gouvernement les ajustements à opérer.Ce comité pourrait relever de l'ANC et se poursuivre avec la prochaine assemblée.

Le ratio d'effet privés à moyen terme et d'effets publics, qui n'est plus en vigueur aujourd'hui, et tant décrié par si Mansour, a été institué par la BCT, dans des circonstances particuliéres, pour obliger les banques à octroyer des crédits à moyen terme aux entreprises et financer le Trésor.Si la BCT a été acculée à le faire c'est parce que les banques, surtout privées, recherchent le gain sans risque alors que le métier même du banquier est un métier de risques calculés.Certaines banques ont préféré être pénalisées plutôt que d'octroyer des crédits.Il faudrait une étude objective pour relever, à posteriori, les avantages et les inconvénients de ce ratio.Le banquier qui se rabat sur les crédits à la consommation fait du dividende, soigne son portefeuille et se préoccupe, à titre secondaire, du développement économique du pays.Le tissu industriel a été l'oeuvre des banques publiques où l'actionnaire est donc l'Etat.Une banque publique supporte l'essentiel du financement de l'agriculture ce que refusent les banques privées qui sont plus selectivesdans ce secteur.Il ne faudrait pas tirer à bouler rouge sur la BCT, a posteriori et en s'absence de ses representants.

Un article vraiment décevant prouve encore une fois que Mansour Moalla est un libéral conservateur capable de délester les fonctions sociales de l’Etat comme l’éducation et le transport au profit du secteur privé. Son seul souci est d’alléger les charges de l’Etat pour réduire les impôts, des riches bien sur. Il parle des IDE comme solution pour boucler le déficit de la balance des paiements alors que maintenant le compte IDE est déficitaire et participe au creusement de la balance des paiements. Aucune réflexion dans ce papier, il n'y a que des généralités datant des années 80.

Une analyse digne d'un homme aux compétences innombrables, les sujets évoqués et les solutions proposées paraissent simple et évidentes mais dure à appliquer avec les mentalités tunisiennes et l'égoisme qui entoure notre société. Notre Tunisie a besoin d'HOMME (et de femme bien sûre) avec des compétences et des idées novatrices pour nous sortir du gouffre dans le quel on s'enfonce de jour en jour. Un passage qui a retenu mon attention c'est là ou si Mansour dit"sacraliser le travail, l’effort et combattre la paresse, l’anarchie et le laisser" c'est à écrire partout pour les générations futurs.