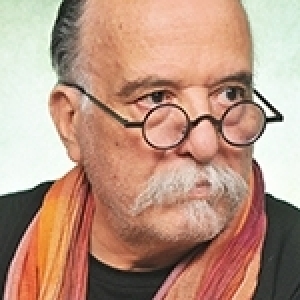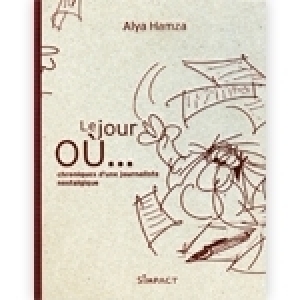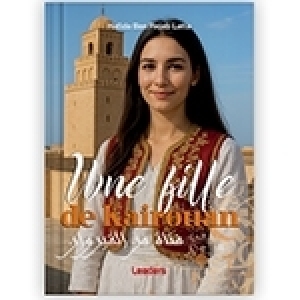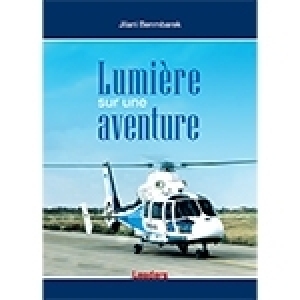Youssef Nebli: Et si les enseignants-chercheurs en gestion assument leurs responsabilités (Partie 1)

Introduction générale
Le milieu de l'enseignement supérieur (ES) et de la recherche scientifique (RS) vit en Tunisie, depuis l’aube de l’année 2017, sous le rythme d’activation du projet de la réforme de son système. Une initiative à encourager, à renforcer et à consolider. Avoir un système d’enseignement véritablement performant constitue un facteur essentiel, pour ne pas dire sine qua non, du progrès socioéconomique de tout pays. L’examen du projet de réforme de l'ES et de la RS montre clairement qu’il est à la fois ambitieux et d’un potentiel fort performant : il recouvre presque tous les facteurs et les aspects qui sont de nature à améliorer le système d’enseignement supérieur (SES). Il est au même diapason des projets de réforme des pays développés. Le projet comprend par exemple un thème très en vogue de nos jours, qui n’est plus une simple tendance de mode soumise au bon vouloir de la conjoncture, à savoir la responsabilité sociétale des établissements d’enseignement supérieur.
Problématique
Cependant, il paraît que toutes les réformes, passées et actuelles (en Tunisie et ailleurs), continuent à ignorer l’acteur clé et essentiel du SES, à savoir l’enseignant universitaire. Les réformes sont conçues comme si tout enseignant (ou du moins la majorité des enseignants) est d’un potentiel qui frôle la perfection et ne souffre d’aucune insuffisance majeure telle que le déficit au niveau savoir-faire (SF). On a tendance à oublier que l’enseignant universitaire est le produit du SES qui souffre de plusieurs maux, même dans les pays développés ayant une expérience managériale et une avancée technologique. Et ce n’est pas un concourt d’assistanat ou quelque enquête réalisée auprès des entreprises pour les besoins des travaux de recherche qui va combler le déficit de l’enseignant en matière de savoir-être (SE) et de SF. Nous considérons que tant que la qualité de l’enseignant universitaire demeure une question taboue, les résultats de tout projet de réforme, si ambitieux et sophistiqué soit-il, ne peuvent pas justifier les investigations, les énergies et les investissements engagés. Au contraire, si l’on traite au sérieux cette question, les résultats ne peuvent que dépasser les objectifs escomptés et les attentes en fonction des moyens investis. Le problème se pose avec une plus grande acuité dans les domaines de l’action et de l’efficacité tels que la gestion, l’ingéniorat et l’économie.
Nous allons focaliser notre analyse sur le système d’enseignement de gestion (SEG) car nous sommes plus habilité à traiter ce système (notre domaine) qu’un autre système et nous considérons que la gestion constitue le moteur, le barycentre et le catalyseur du progrès économique et social. Nous pouvons nous interroger alors si le SEG, avec le profil actuel de son acteur clé, est capable de produire un véritable gestionnaire ou non ? L’interrogation est légitime dans la mesure où l’on continue à constater la relative absence du diplômé en gestion dans les grandes sphères de décision. Ce constat nous conduit à élargir le champ de la problématique posée pour toucher plusieurs aspects et acteurs de la société. En effet, ces sphères se situent à plusieurs niveaux, tels que politique, social, culturel, médiatique, législatif, macro-économique et micro-économique, et sont concernés et impliqués par des prérogatives relevant de la gestion.
Depuis que nous étions étudiant, nous avons constaté que le diplôme en gestion ne figure pas dans la liste de ceux qui sont considérés comme nobles par la société. A cette époque, la plupart des acteurs de la société n’étaient pas encore conscients de l’importance de la nouvelle discipline qu’est les sciences de gestion. De nos jours, le diplômé en gestion n’a pas encore la place et la valeur qu’il mérite. Cependant, si hier la jeunesse de la discipline peut expliquer la position non privilégiée du diplômé en gestion, rien n’explique aujourd’hui cette position. En effet, la société est actuellement consciente de l’importance cruciale des sciences de gestion. Mais cela ne l’a pas empêché de continuer à ignorer et de négliger encore le diplômé en gestion. Il s’agit bien d’un phénomène paradoxal qui mérite réflexion. Pour ceux qui doutent encore de ce paradoxe, ils n’ont qu’à examiner la nature du diplôme de la plupart des Ministres, des détendeurs des grands postes de l’Administration ou de l’entreprise et des invités dans les débats politiques et socio-économiques alors qu’une grande part de leurs préoccupations relève de la gestion telles que la bonne gouvernance, le travail, la production (de biens ou de services), la productivité et la performance. Il est très rare d’y observer un diplômé en gestion (pour ne pas dire une absence totale).
Le paradoxe observé pose un grand problème, voire un grand obstacle, pour tout pays voulant assurer un véritable progrès socioéconomique, du moins pour les pays qui n’ont pas encore acquis une bonne expérience managériale. Nous considérons que le facteur premier permettant à tout pays de réaliser un tel progrès continu et significatif est le fait de disposer de véritables gestionnaires capables de conduire tout type d’organisation (une entreprise ou tout autre type d’entité socioéconomique) vers le chemin de l’excellence aux niveaux résultats et performances. Donc, en l’absence de véritables gestionnaires dans les grandes sphères de décision, tout projet visant un progrès substantiel pourrait être bien compromis. Faut-il préciser que cette problématique concerne également les pays développés tels que la France.
La même problématique observée par le directeur de la publication de la revue des sciences de gestion mais sans pour autant mettre en doute la qualité de l’enseignant
En effet, le Professeur Philippe Naszályi, Directeur de la publication de la revue des sciences de gestion (RSG), dans son éditorial du N°278-279 (2016) de cette revue, a soulevé la même problématique. L’éditorial est intitulé : « Et si l’on faisait (enfin) appel à un gestionnaire !? ». Ce titre traduit la solution à la problématique posée. Celle-ci peut-être résumée de la sorte: « devant l’absence de solution en matière de croissance et de développement de la France comme de ses partenaires européens », on observe une absence quasi-totale des véritables chercheurs en gestion dans les grandes sphères d’analyse et de décision telles que l’entreprise, l’organisation à but non lucratif (l’hôpital par exemple), les masses médias, l’Administration et la sphère politique et gouvernementale, etc. Les gestionnaires « sont largement remplacés par toutes sortes d’experts » qui « ignorent les règles, les pratiques, les théories qui portent [la] science nouvelle qui est celle des sciences de gestion ». Cela paraît inadmissible, voire illogique, dans la mesure où celles-ci « existent bien ! ». Par exemple, la RSG « en est la preuve depuis plus de 50 ans ! ». D’ailleurs, « c’est pour cela que [l’auteur] enrage presque quotidiennement, pour tous ces gestionnaires qu’[’il lit], que [son] revue publie, de ne pas les voir traités comme des experts des organisations et des entreprises qu’ils sont, dans les médias et auprès du grand public » (septembre 2016).
Cette attitude ne peut être que légitime : la règle d’or en Organisation (à entendre en tant que substance du verbe organiser) stipulant l’homme qu’il faut dans la place qu’il faut n’est pas respectée. C’était la même attitude que j’avais adoptée lors de mon accès au milieu professionnel (en janvier 1982). J’ai vite constaté que les postes de gestion et de direction sont privilégiés notamment aux détendeurs des diplômes d’ingéniorat et d’expertise comptable. Je trouve que c’est à la fois inadmissible et contre productif que l’ingénieur ou l’expert comptable dirige et gère le gestionnaire alors que celui-ci (le spécialiste en gestion) est plutôt confiné à un autre rôle (plutôt administratif) qui n’est pas le sien. En plus de cela, ils sont mieux rémunérés que le diplômé en gestion.
Philippe Naszályi met en garde contre les dérives de la finance dans les organisations et souligne que des auteurs, comme Vincent de Gauléjac, ont contribué « à démonétiser la gestion et les gestionnaires dans une grande frange de la population, y compris savante ou prétendue telle lorsque l’on pense à la plupart des médias ». Pendant ce temps, le directeur de la RSG remarque que les masses médias continuent à ignorer les gestionnaires alors que « le vaste champ des organisations est celui du gestionnaire, pas celui des autres ».
Si certaines chaînes invitent un patron, un inventeur, un cadre d’entreprise, ajoute-t-il, « c’est pour témoigner, débattre parfois avec des syndicalistes voire des politiques, mais jamais aucun gestionnaire n’est là pour poser enfin, les bonnes questions, tirer les enseignements ou faire une synthèse ». Il conclu que « tout est donc toujours approximatif, inexact voire totalement erroné dans le domaine précis des organisations et de leur fonctionnement. Inviter un gestionnaire pour expliquer la loi travail vue de la part des vraies entreprises aurait gagné du temps et de l’efficacité, mais à croire que ce n’est pas ce qu’on cherche ! » (Ph. Naszályi, 2016).
Il est facile d’observer que nous avons essayé, autant que faire se peut, de rapporter fidèlement et exactement les propos (à travers les citations) du directeur de la RSG, et ce, afin d’y éviter tout risque de défiguration et de mutilation. Son éditorial constitue l’inspirateur et le vecteur directeur de la présente recherche dans la mesure où il s’agit de la même problématique posée mais avec des divergences au niveau explication du paradoxe observé et par suite aux niveaux solutions qui sont de nature à résoudre la problématique. La grande divergence se situe notamment au niveau de la qualité de l’enseignant universitaire en gestion. Et ce sont les divergences qui peuvent donner une légitimité et un sens au présent article.
Questions, objectifs et but de recherche
Il est clair que le paradoxe observé constitue effectivement une problématique entravant l’emprunt du chemin de l’excellence. Nous pouvons même avancer que ce phénomène n’est pas spécifique aux pays européens mais s’étend également ailleurs, bien entendu à des degrés plus ou moins grands. Si en France, Phylippe Naszályi prévoit à court terme « l’effondrement intellectuel des universités françaises » (op. cité, 2016), en Tunisie, nous pouvons dire que tel effondrement est déjà établi. Par contre, au Japon, les business schools ou les écoles supérieures de gestion n’existent même pas (donc, le diplôme de gestion n’existe pas). Et cela ne semble pas affecter de façon claire ni son économie ni la gestion de ses entreprises. Harold J. Leavitt (Directeur du business school de Stanford) déclare en 1980 : « les managers japonais sont bons, même très bon, les managers américains sont mauvais…, même très mauvais. Les américains sont diplômés des business schools. Les japonais ne le sont pas. Alors quels sont les fautifs ? Les professeurs, bien sûr, de ces sacrées écoles… » (Cité par D. Xardel, 1986, p. 70).
Ce constat nous amène à nous interroger sur plusieurs points : 1. Si les enseignants-chercheurs remplissent convenablement leurs missions classiques de recherche et de transmission de savoir à leurs étudiants en gestion ? 2. Si le SEG (LMD) est capable de produire un diplômé de bonne qualité en gestion ? 3. Si « les toutes sortes d’experts » (autres que les diplômés en gestion), moyennant l’expérience managériale acquise par leur entreprise et l’adoption d’une politique de formation continue, sont capables de rivaliser, voire parfois de dépasser, le diplômé en gestion dans leurs activités managériales ? 4. Si seule une étude réelle de terrain qui « permet de savoir de quoi l’on parle » et de favoriser « le fameux doute cartésien » (Ph. Naszályi, 2016).
Quant aux objectifs de recherche, ils résident notamment à répondre à toutes ces questions et à montrer que l’attitude consistant à reprocher les divers acteurs de la société qui continuent à ignorer le spécialiste en gestion est à réviser. Il s’agit également de montrer que la solution à la problématique posée réside effectivement dans l’invitation à faire « appel (enfin) à un gestionnaire », mais faut-il ajouter et préciser qui possède des compétences distinctives que ne possède aucun autre type d’expert. En d’autres termes, avant de faire des reproches à la société, faut-il que les enseignants-chercheurs assument leurs responsabilités dans le processus conduisant à la production de véritables gestionnaires. C’est à ce prix là que nous pouvons songer dans un proche avenir que le diplôme en gestion soit parmi les diplômes les plus nobles (si ce n’est pas le plus noble) dans la société. Par suite, les acteurs de la société vont faire d’eux même le soin d’inviter le diplômé en gestion à participer dans le processus de prise de décisions. Tout cela pour le bien de la société. D’ailleurs, le but suprême de ce papier de recherche, est de contribuer, un tant soit peu, à la valorisation méritée et nécessaire du spécialiste en gestion.
Démarche de recherche
Un projet ayant comme finalité la valorisation du diplômé en gestion ne peut que susciter l’intérêt du corps enseignant de gestion. Mais adopter un tel projet tout en mettant en doute la qualité de l’enseignant universitaire n’est pas du tout une activité reposante. Nous sommes bien conscient qu’il s’agit d’un projet embarrassant, choquant et affecte, à part le corps enseignant, plusieurs acteurs de la société aux niveaux entendement et sentiment. Affirmer que le SEG souffre de plusieurs maux ne dérange personne. Mais le fait de conclure que le potentiel de l’enseignant universitaire n’est pas satisfaisant vu que celui-ci n’est que le produit du SEG, cela ne peut pas percer l’entendement d’une bonne part des acteurs de la société, plus particulièrement le corps enseignant. D’ailleurs, nous même et avant de vivre une expérience professionnelle (juste après le diplôme de maîtrise), si quelqu’un avait soutenu une telle conclusion nous n’aurions jamais cru à ses dires. Nous étions bien convaincu du contenu du cursus d’études et nous étions bien fier d’être diplômé en gestion de la production. Que dire alors si nous étions au niveau d’études d’un enseignant universitaire ? Au niveau psychologique, un tel projet touche les considérations d’amour propre, d’égo, de dignité, de prestige social, etc.
C’est pour cela, étant conscient de ses considérations, que nous allons, dans notre démarche, nous focaliser essentiellement à démontrer où résident les insuffisances du potentiel de l’enseignant universitaires dans ses missions classiques d’enseignement et de recherche. S’attarder à la définition des solutions à certaines insuffisances qui ne peuvent pas être perçues par les concernés sans démonstration rigoureuse serait une peine perdue. Ainsi, les solutions permettant de remédier à ses insuffisances et d’aboutir à la finalité du projet ne seront abordées qu’en ses grandes lignes. Un article ne peut être aussi long.
Chacune de ces solutions peut faire l’objet d’un article spécifique. Nous considérons que pour convaincre un intellectuel, il faut procéder selon les règles de la raison et l’argumentation objective afin de vaincre les résistances aux changements dues aux influences des sentiments. Nous pensons alors que c’est la manière adéquate permettant de percer l’entendement du lecteur afin qu’il puisse admettre le fait choquant et de surpasser les forces irrésistibles des sentiments. C’est le point critique qui permet le déclenchement d’un processus aboutissant à la valorisation méritée du diplômé en gestion. L’inclination naturelle mais non objective aux forces irrésistibles des sentiments constitue un obstacle majeur à l’aboutissement de la finalité de notre projet. Dans ce cas, l’enseignant universitaire en gestion doit admettre et subir pour toujours les conséquences du paradoxe que nous venons de soulever. De notre part, nous ne pouvons pas accepter un tel sort où les spécialistes en gestion demeurent toujours confinés à des tâches administratives et « sont largement remplacés », dans des attributions relevant de leur spécialité (gestion), « par toutes sortes d’experts » qui « ignorent les règles, les pratiques, les théories qui portent [la] science nouvelle qui est celle des sciences de gestion ». Et, il y a de quoi être enragé « de ne pas les voir traités comme des experts des organisations et des entreprises qu’ils sont, dans les médias et auprès du grand public » (Ph. Naszályi, op. cité). Un tel positionnement (ou place) dans la société ne peut susciter ni la fierté ni la valeur méritée de tout véritable enseignant universitaire en gestion ayant le sens de responsabilité et la volonté de contribuer, de façon significative et distinctive, au progrès socioéconomique de son pays. Reconnaître certaines insuffisances pour améliorer son potentiel de compétence et assumer ses responsabilités n’est pas un signe de faiblesse mais plutôt un signe de force (assurance et confiance en soi) et d’audace.
La démarche de recherche va comprendre alors trois volet ou composantes : les insuffisances du SEG et par suite du potentiel de l’enseignant universitaire au niveau notamment de sa mission d’enseignement, les insuffisances au niveau de la RS pour toucher enfin les solutions (dans ses grandes lignes) à ses insuffisances. Dans le premier volet, volet le plus long impliquant toute la première partie, il s’agit d’abord d’attirer l’attention au lecteur à certains faits attestant que l’attitude de reproche envers les acteurs de la société est à réviser en montrant notamment que le SEG et de la RS dans le champ de la gestion ne sont pas encore arrivée au stade de distinction satisfaisante de ses concepts clés. S’il y a un reproche à faire, il y a lieu de l’adresser à nous même en tant qu’enseignants-chercheurs en gestion. Ensuite, nous allons expliquer le déclic qui a déclenché en nous le processus de réviser l’attitude de reproche envers la société. Sans la genèse explicative de ce déclic, nous n’aurions peut-être jamais pensé à remettre en question le SEG ou à répondre à l’éditorial du professeur Naszályi. Puis, il y a lieu d’indiquer les maux majeurs du SEG, déjà montrés par les auteurs qui ont essayé de résoudre la problématique de la complexité et la contradiction managériales. Faut-il signaler qu’un projet d’un potentiel prometteur d’amélioration du SEG a été abandonné au profit du système LMD. Enfin, il est utile de s’interroger sur les facteurs ou obstacles majeurs qui empêchent la réalisation effective de tout projet de réforme radicale si féconde soit-elle.
Dans le deuxième volet, il y a lieu de déterminer les maux majeurs de la recherche observés de notre part qui résident notamment dans le rejet catégorique de la communauté savante du rationalisme sans pour autant accéder à la thèse de son fondateur d’une part, et dans la diversité de jugements entre les auteurs sur la forme d’expérience savante à adopter dans la recherche de terrain d’autre part. Quant au dernier volet, il y a lieu d’entamer d’abord une discussion avec le Professeur Emérite Henri Savall pour proposer ensuite des solutions préconisées (dans ses grandes lignes) à des fins de valorisation méritée et nécessaire du diplômé en gestion.
Attitude de reproche a réviser
Parmi les facteurs qui expliquent le paradoxe représentant la problématique évoquée est le fait que la majorité, si ce n’est pas la totalité, des acteurs politiques, économiques et de médias ont une saisie chancelante, flottante et confuse de ce qu’est la gestion et sa raison d’être à savoir la performance ainsi que les performances élémentaires telles que l’efficacité, la productivité, le rendement et la rentabilité. Ils ne distinguent pas convenablement le terme de gestion avec les mots analogiques (ayant un rapport étroit avec la gestion) tels que la comptabilité et la finance, l’Administration, le management, l’économie, l’Organisation. Pour certains même, tous ces termes ne font qu’un. Il ne serait pas alors surprenant que les acteurs fassent appel à « toutes sortes d’experts » et ignorent le plus souvent les gestionnaires « comme des experts des organisations et des entreprises qu’ils sont » (ibid.). Mais peut-on en vouloir à ces acteurs alors que les spécialistes(les auteurs et enseignants-chercheurs) en gestion en eux même ne sont ni d’accord sur le sens que devait avoir le terme gestion ni de sa raison d’être.
Les enseignants-chercheurs ne sont pas d’accord sur que représente le terme gestion
Pour certains, le sens du terme de gestion est synonyme au mot management, pour d’autres celui-ci n’est qu’une composante de la gestion alors que pour d’autres encore c’est le contraire : c’est le management qui englobe la gestion (ainsi que l’Organisation et la Direction de l’entreprise- gestion stratégique). En attendant que les auteurs en gestion (ou en management selon le terme qui représente le tout) se mettent d’accord sur les sens des termes clés, il faut que chaque auteur d’un ouvrage ou d’un article précise ce qu’il entend par les termes clés utilisés (se rapportant à la gestion ou la performance). De notre part, nous avons opté pour le terme management qui représente le tout. Ce choix présente l’avantage d’une distinction plus aisée et plus claire des termes analogiques ainsi que l’avantage de respecter le principe d’univocité (principe propre des mathématiques que nous nous sommes proposé d’appliquer) mais comporte l’inconvénient qu’il ne représente pas l’usage le plus fréquent. Cet inconvénient risque de compromettre la saisie fidèle de notre discours de la part du lecteur, d’autant plus que l’auteur de l’éditorial, qui représente le vecteur directeur du présent article, adopte pour le terme gestion représentant le tout. C’est pour cette raison, nous allons (exceptionnellement) retenir les termes management et gestion comme des synonymes représentant le tout et ne pas respecter ainsi le principe d’univocité. Par suite, nous optons à ce que le terme management ne représente pas une composante de la gestion. La distinction de ce tout, désigné par les termes gestion ou management, en ses composantes, réside alors dans les éléments suivants : la gestion opérationnelle (qui comprend elle-même la gestion à court terme et l’organisation du travail), la gestion stratégique (ou tout simplement la Direction) et le reste des composantes de l’Organisation (notamment la structure organisationnelle et la structure).
Les enseignants-chercheurs ne sont pas d’accord sur ce devait être la Performance (la raison d’être de la gestion)
Ce qui est encore plus grave c’est le fait que les auteurs ne sont d’accord de ce devait être la « la raison des postes de gestion » (Albanèse, 1978, p. 15), c’est-à-dire la Performance qui demeure toujours un thème d’actualité. Ce qui rend le problème avec une plus grande acuité, la plupart des auteurs refusent d’indiquer le sens retenu. Annick Bourguignon remarque que, malgré l’abondance d’utilisation, « le terme de performance soit rarement explicitement défini, même dans des ouvrages dont la performance représente à l’évidence l’objet d’étude central ». Elle précise que « tout se passe comme si le sens du mot performance(s) était si évident que sa définition en devienne superflue ». Or, il est manifeste que « le sens n’est pas exactement le même dans toutes les expressions citées » (1995, p. 61).
Nous avons observé un volume impressionnant de sens du concept performance (au moins 22 sens significatifs sans pour autant retenir les autres sens) tant au niveau académique qu’au niveau pratique. Ce vaste étendu de définitions n’est pas de nature à aider les auteurs académiques à cerner avec une certaine assurance les contours de la performance ni les praticiens à choisir ses indicateurs les plus appropriés à leur entreprise. Pourrons-nous, à l’aube du XXIème siècle (2017), continuer à accepter cette diversité ? D’un point de vue purement logique, dans une diversité de jugements, il ne peut y avoir, tout au plus, qu’un seul jugement valide. Il s’agit d’un principe logique qui a été clairement énoncé par Descartes : « considérant combien il peut y avoir de diverses opinions touchant une même matière, qui soient soutenues par des gens doctes, sans qu’il y en puisse avoir jamais plus d’une seule qui soit vraie, je réputais presque pour faux tout ce qui n’était que vraisemblable » (Partie II du Discours de la méthode, paragraphe 5- D, II, 5). Ce principe est emprunté des mathématiques. Désormais, nous nous sommes proposé de le désigner par le principe de diversité exclue par analogie à la désignation du principe du tiers (ou milieu) exclu qui stipule : « une proposition est soit vraie, soit fausse ; entre les deux pas de milieu » (K.M., mot d’entrée : Aristote, 1971).
Nous considérons que le fait d’accepter la diversité de jugements entre les auteurs, peut poser plusieurs problèmes d’ordres théorique, logique, pédagogique et pratique. En effet, dans ses missions classiques de recherche et de transmission du savoir aux étudiants ainsi que dans son rôle de consultant d’entreprise, il est rare qu’un enseignant universitaire en management puisse se trouver dans une situation où il ne serait pas appelé à préciser de ce qu’est la performance. Devant le volume impressionnant des définitions observées dans la littérature, l’enseignant se trouve alors confronté à un problème crucial : quel est le sens et par suite la définition doit-il se référer pour la proposer à ses étudiants ou aux dirigeants de l’entreprise (objet de recherche-intervention ou d’assistance et de conseil) ? Il est clair, une grande responsabilité incombe à l’enseignant quant aux choix de la définition de la performance à proposer. Pour définir la performance, « un "mot-valise" qui recouvre plusieurs acceptions » (M. Lebas, 1995, p. 66), il est essentiel de savoir localiser ses sens les plus pertinents. Sans ce savoir, il est difficile, si ce n’est pas impossible, d’aboutir à des méthodes sûres et fiables d’évaluation de la performance ou de faire le bon choix quant aux outils managériaux à adopter visant l’amélioration de la performance d’une organisation. O. Babeau souligne que la définition exacte de la performance « n’est ni claire ni réellement partagée tant elle recouvre un ensemble très hétérogène de conceptions ». Par suite, « la référence à la performance, si elle n’est pas interrogée en profondeur, devient à l’entreprise ce que la pierre philosophique était aux alchimistes : une aspiration mythique, plutôt floue et confusément ressentie comme inaccessible » (2015, p.10). Face à la profusion des sens de la performance, dont aucun auteur ne semble détenir la réponse infuse, la plus grande gageure consiste à savoir séparer le bon grain de l’ivraie. Une bonne distinction exige la possession d’un critère adéquat ou d’une démarche fiable et rigoureuse.
Depuis notamment 2001, la performance a connu un élargissement de son périmètre en intégrant, à part la dimension économique et financière, les piliers environnementaux et sociaux. Les auteurs se sont alors investi à déterminer le mode approprié d’articulation entre ces trois dimensions ainsi que leurs performances élémentaires et les méthodes de mesure et d’évaluation sans pour autant savoir de façon précise et univoque le définissant de la performance ou distinguer sans aucune ambiguïté ses composantes ! Cela ne peut que nous étonner. Faut-il préciser que les concepts de responsabilité sociale de l’entreprise (RSE), de la performance et du développement durable demeurent encore mal définis, mal compris et s’apprêtent même à la confusion d’ensemble. On ne peut ni raisonner avec justesse dans la confusion ni de réaliser des recherches de terrain fiables et assez fécondes. Déjà, la performance, avant de connaître l’élargissement de son périmètre, est floue, confuse et controversée. Que dire alors de la performance élargie ? Nous nous demandons comment pouvons-nous évaluer et mesurer une performance de l’entreprise ou savoir articuler ses piliers ou ses composantes principales sans pour autant savoir sa définition univoque, ou du moins réduire son vaste étendu de sens, et sans distinguer de façon précise ses composantes ?! Les auteurs N. Berland et M. Essid constatent que « les pratiques [de contrôle la performance élargie] restent encore fragiles et mal définies, du fait notamment des difficultés d’opérationnalisation du concept de performance globale » vu que celui-ci « demeure en effet un concept flou, vague et confus » (2010, pp. 2-4). Douhou et N. Berland observent que « les dispositifs d’évaluation actuellement utilisés par les entreprises pour mesurer les progrès réalisés grâce à leurs démarches RSE n’apportent pas de réponses satisfaisantes ». Et le fait de « ne pas être capable d’évaluer les progrès réalisés empêche les entreprises de savoir où porter leurs efforts d’amélioration » (2007).
Faut-il préciser que nous avons n’avons pu observer le vaste étendu de divergence entre les auteurs en gestion sur ses concepts clés, traduisant la fragilité (risque d’erreur) de cette discipline, que lorsque nous avons accédé au SEG en tant qu’enseignant-universitaire (1989), c’est-à-dire bien après que nous avons réalisé la nécessité de réviser notre attitude de reproche vis-à-vis les acteurs de la société tunisienne, notamment l’Administration. Ainsi, l’observation de cette diversité n’était pas l’origine qui explique notre révision d’interprétation du paradoxe observé.
Le déclic déclenchant le processus de révision d’attitude
L’attitude du professeur Naszályi m’a fait rappeler l’attitude que j’avais adoptée lors de mon accès au milieu professionnel. J’ai vite constaté que les postes de gestion et de direction sont privilégiés notamment aux détendeurs des diplômes d’ingéniorat et d’expertise comptable. Je trouve que c’est révoltant car il est à la fois inadmissible et contre productif que l’ingénieur ou l’expert comptable dirige le gestionnaire qui est plutôt confiné à des tâches administratives. Mais, juste après quelques mois de cet accès professionnel, j’ai commencé à réviser cette attitude. Afin de mieux saisir le déclic montrant la nécessité de cette révision, il y a lieu de présenter d’abord l’objet et le cadre de mon premier vécu professionnel
Objet et cadre du premier vécu professionnel
Le premier vécu professionnel a débuté en tant que stagiaire dans le Ministère des Affaires Sociales (MAS) à travers une formation approfondie en organisation du travail (plus particulièrement les techniques de la fonction Méthodes). Constatant une défaillance de l’entreprise tunisienne au niveau productivité (par manque de cadres supérieurs spécialisés), le MAS a organisé une formation professionnelle approfondie (durant toute l’année 1982) en organisation du travail (OT) au profit d’une équipe de diplômés ou cadres supérieurs (minimum Bac + 4) dont je faisais partie. Le MAS a beaucoup misé sur cette formation et a réuni toutes les conditions matérielles et pédagogiques pour la réussir. Il a fait notamment appel à un expert du Bureau International du travail (BIT), Monsieur Roger Lansley, possédant une longue expérience internationale en OT. L’objectif primordial de cette formation était d’instaurer un « noyau » au sein du MAS d’une grande expertise et compétence ayant pour mission essentielle de promouvoir la fonction Méthodes dans l’entreprise tunisienne et de former les formateurs qui auront la tâche de former les cadres de la fonction Méthodes de l’entreprise tunisienne. Ont également assisté à cette formation d’autres cadres supérieurs (ingénieurs et ingénieurs adjoints) pour le compte d’entreprises privées.
Pour atteindre cet objectif de formation, le MAS n’a pas lésiné sur les moyens en temps (le nombre d’heures de formation par jour était de 6, et ce pendant six jour par semaine), espace, moyens didactiques de l’époque (acétate, diapositive, projection de films, etc.) et application des techniques d’OT dans le milieu effectif de l’entreprise. En début de formation, j’éprouvais un fort sentiment de fierté d’être titulaire d’un diplôme de maîtrise en gestion de la production. Je croyais fermement, grâce à la qualité du cursus d’études universitaires, que je possède toutes les techniques fondamentales de gestion opérationnelle et d’Organisation de la production. Et j’avais le désir et la volonté farouche de montrer à mes collègues ingénieurs que je suis nettement mieux placé qu’eux dans le domaine de la gestion de production. Cependant, à travers notamment le savoir-faire (SF) transmis par l’expert, je commençais à réaliser (petit à petit) qu’en réalité je suis presque au même pied d’égalité avec mes collègues ingénieurs. Je ne les dépasse qu’au niveau de l’aspect théorique de la gestion de la production, mais aucunement au niveau de la maîtrise effective, à travers la maîtrise de l’aspect opérationnel. Un gestionnaire, ne possédant pas le SF, c’est-à-dire incapable de traduire les théories et les outils de gestion en une application fiable sur le terrain, est un faux gestionnaire. Et contrairement aux idées reçues, l’accès au SF n’est pas une simple question d’expérience et de bon sens. Cet accès est plutôt un processus difficile et de longue haleine qui nécessite, d’abord et avant tout, une formation appropriée auprès des experts maîtrisant à la fois le savoir (S) et le SF.
En réalité, durant cette formation, j’ai pu observer plusieurs sonnettes d’alarmes montrant, de proche en proche, les insuffisances du SEG, notamment au niveau SF, et par suite mes limites au niveau possession des outils de la gestion de la production. Le premier signe était un choc pour nous. Il est demandé à chacun des stagiaires de préparer et de réaliser un exposé-débat sur un thème se rapportant à l’OT afin de nous familiariser aux techniques d’animation de séminaires professionnels. Parmi les thèmes proposés, je cite plus particulièrement celui de la productivité (objectif fondamental de la fonction Méthodes). Aucun stagiaire n’a manifesté sa volonté à traiter ce thème. Croyant fort que je maîtrise cet indicateur de performance, je me suis dit que c’est l’occasion où jamais pour montrer à mes collègues ingénieurs que le gestionnaire de la production est normalement plus habilité à gérer ou à organiser la production que l’ingénieur. J’ai manifesté alors ma volonté franche d’assurer l’exposé-débat relatif à la productivité.
Premier signe d’alarme montrant la nécessité de réviser l’attitude
Au début de l’exposé, dans les préliminaires, tout est allé dans la bonne direction. L’expert du BIT affirme que je viens de réaliser une bonne introduction au thème notamment au niveau théorique. Mais, il est important, souligne-t-il, de passer à l’aspect opérationnel et pratique. Il me demande alors si je peux indiquer à mes collègues comment, à partir de la formule théorique, devait-on mesurer la productivité. Pour cela, il me propose un exemple ou exercice d’application où il y a des données sur les volumes et les prix de vente des produits ainsi que sur les volumes et les coûts des facteurs de production. Il est vrai que de tels détails n’ont pas été abordés dans un aucun cours de gestion ni illustrés dans un ouvrage de gestion de la production, mais ce que propose l’expert est la fois légitime et nécessaire. N’ayant aucune idée sur les moyens de mesure, je me suis fié au bon sens. Ce chemin m’a fait aboutir en fin de compte à ce que la productivité soit égale à 1 + marge bénéficiaire. Or, explique l’expert, celle-ci est un indicateur financier alors que la productivité, par définition, doit être exprimée en termes physiques. Ajouter à cela, on n’a pas besoin d’être gestionnaire pour connaître la marge bénéficiaire. Même, l’épicier du coin, peut calculer sa marge bénéficiaire. Est-il concevable qu’un indicateur d’une grande importance tel que la productivité soit assimilé comme une marge bénéficiaire! ? L’expert me précise que la grande portée de la productivité au niveau prospérité économique et sociale de tout pays laisse les Ministres, le chef du Gouvernement ainsi que les candidats à la présidence de la république, notamment lors des débats télévisés, évoquent à maintes reprises leur volonté et leur disposition d’une vision et d’un programme permettant l’amélioration effective de la productivité. Où est alors le problème, où réside mon erreur dans la démarche adoptée de mesure de la productivité alors que le point de départ (la définition) est valide ? Comment devait-on alors mesurer cet indicateur de performance tant important aux niveaux macro-économique et micro-économique ? J’étais incapable de fournir la moindre réponse. C’était un choc pour moi : au lieu de montrer aux ingénieurs que je maîtrise mieux qu’eux la gestion de la production, je viens de montrer que je ne les dépasse qu’au niveau de l’aspect théorique de la gestion de la production. Dire alors que le gestionnaire de production est mieux placé que l’ingénieur au niveau gestion de la production serait un peu exagéré. Par contre, il n’y a rien à contester en affirmant que l’ingénieur est de loin plus placé que le gestionnaire de la production au niveau technologique.
A la fin de cette formation professionnelle, où le SF l’emporte sur le S, et la suite d’une série de signaux d’alarme montrant l’extrême difficulté d’accès au SF, j’ai pu réaliser enfin, avec une entière certitude, que le SEG n’est pas en mesure de produire un gestionnaire ayant un potentiel distinctif auquel ni l’ingénieur, ni l’expert comptable ni encore tout autre type d’expert ne peut y accéder sans suivre le cursus d’études en gestion. Nous arrivons maintenant aux enseignements clés de cette formation professionnelle.
Enseignements clés du stage professionnel de logue durée
Contrairement aux idées reçues, le S et le SF sont deux dimensions étroitement liées et complémentaires et celui-ci revêt d’une importance capitale. L’appropriation du SF nous conduit à saisir les difficultés d’application, à appréhender les vrais problèmes et à connaître les véritables enjeux dans ses multiples dimensions. Ceci, nous amène à déceler les facettes cachées du S et nous suscite un désir d’approfondissement et de recherche. En fin de compte, l’appropriation véritable du SF, à part qu’il permet l’application fiable du S, ne peut conduire qu’à mieux appréhender et même développer le S. C’est effectivement pour des raisons académiques (qui visent notamment le S et la RS) qu’on a intérêt à donner au SF la dimension qu’il mérite dans le SEG. Il s’agit là du principal enseignement que nous puissions tirer de ce vécu de formation professionnelle. Sans possession du SF, le S ne peut être que partiel, masqué et illusoire mais tout en ayant l’apparence d’être satisfaisant. Et c’est là que réside le principal danger dans le SES : cette apparence ne donne pas l’occasion à l’enseignant ou l’étudiant de réviser son acquis et de rectifier le tir à des fins d’approfondissement et d’apprentissage. Le poids imposant des préjugés fait que le sujet ne puisse pas se rendre compte de ses erreurs car toute sorte de préjugés constitue des croyances au sens fort et paraisse comme une vérité indubitable. « […] L’autorité du sens commun, du langage, de l’éducation nous inculque des préjugés dont nous n’avons pas conscience et que nous ne songeons pas à mettre en question » (DEQ, COT-ES, entrée: erreur, 1975, p. 2250). Les facteurs des préjugés (Descartes dit de la prévention) peuvent masquer la voie de la raison et constituer une habitude collective. Celle-ci « finit par être une sorte de loi qui s’impose, même malgré eux, à tous les individus d’un même groupe » (DEQ, ET-HEL, entrée : habitude, 1975, p.3041). Toute sorte de préjugés, telle que le paradigme dominant, l’argument d’autorité et le consensus commun, constitue des croyances au sens fort fondées psychologiquement plutôt que logiquement, et par suite plusieurs de ces croyances sont lacunaires ou erronées, mais à notre insu car elles paraissent comme des vérités indubitables.
Il est clair que je dois mon acquis au niveau SF (et par suite au niveau S même) et de ma prise de conscience des insuffisances du SEG à Monsieur Roger Lansley. Souligner le mérite fondamental de l’expert dans le processus de ma formation constitue le moindre des égards pour celui qui, sans son apport, aucune publication sur l’OT et aucune proposition d’amélioration du SEG n’auraient étés envisageables. J’ai donc une grande dette à l’égard de celui qui m’a révélé notamment l’importance du SF dans le domaine du management et la nécessité de l’enseigner : il n’est pas aussi évident et simple comme on pourrait imaginer et croire en premier abord. Le bon sens et l’expérience ne sont pas suffisants pour garantir sa possession. D’ailleurs, depuis cette formation, je voyais sous un autre jour tout texte étudié précédemment et je réalisais combien des concepts et des outils de gestion, paraissant en premier abord simples d’accès et faciles d’application, sont en réalité riches et complexes en contenu et d’une extrême difficulté d’application sur le terrain. D’ailleurs, c’est uniquement à partir de cette formation que j’ai commencé réellement à saisir et à comprendre les concepts, les principes et les techniques de gestion opérationnelle et d’Organisation.
Pour tout lecteur qui doute encore des enseignements clés tirés de notre vécu professionnel, nous l’invitons à s’interroger si le système actuel d’enseignement de gestion (LMD : instauré et généralisé depuis 1995), qui est caractérisé notamment par la normalisation et l’internationalisation des formations et de la recherche, est capable ou non de produire véritablement un diplômé ayant l’aptitude de résoudre la complexité et la contradiction managériale ? Cela permet d’éviter tout doute non fondé.
Maux majeurs du systeme d’enseignement de gestion
La réponse à cette question est simple. La mission de produire un tel profil est devenue une mission beaucoup plus difficile que par le passé. Certains auteurs en gestion, conscient de cette extrême difficulté, ont été poussés de dire que cette mission consiste à produire « le mouton à cinq pattes » (D. Xardel, 1980, cité par J. Lebraty, 1989). Comme certains l’ont exprimé : « un manager apte à décrypter la complexité et à bien la vivre. » (Cité par J. Lebraty, 1989). Nous voyons mal que le système LMD souffrant de plusieurs maux pourrait arriver à remplir cette mission.
Maux majeurs impliquant un sentiment d’inquiétude cyclothymique de la part de l’enseignant quand à sa légitimité
Parmi les maux majeurs de ce système d’enseignement, nous citons plus particulièrement les points suivants:
- Un déséquilibre flagrant en faveur du S au détriment du SF et du SE.
- La plupart des outils de gestion enseignés ainsi que les recherches adoptées sont assez éloignés de la réalité de l’entreprise d’autre part. Les auteurs R. Locke et M. Meuleau mettent en doute que les écoles de gestion puissent enseigner la réalité du monde des affaires dans la mesure où « la grande majorité des professeurs ont un passé et une formation purement académiques. La plupart passent directement des programmes de PhD au métier d’enseignant ». Ils se demandent, « comment, dans ces conditions, concevoir des cours qui ne soient pas uniquement conceptuels ? ». Et quand l’ex-étudiant entre dans la vie active, « il ressent en général un véritable choc. On lui dit qu’il est maintenant dans la réalité et qu’il lui faut se montrer efficace. Il s’agit d’oublier tout cet univers théorique dans lequel il baignait… » (1988).
- La plupart des auteurs continuent à considérer que la comptabilité et la finance demeurent toujours la base essentielle et le vecteur directeur du management. Rares sont les auteurs qui ont « contribué, avec les dérives de la finance dans les organisations, à démonétiser la gestion » (Ph. Naszályi, op. cité). Selon Thomas Peters, coauteur de In Search of excellence, les difficultés de l’industrie américaine des années 70, sont expliquées par le fait que le SEG n’a pas accordé suffisamment d’importance à la fonction de la production et aux questions commerciales : « Les affaires sont avant tout une question de conception, de fabrication et de commercialisation, et les techniques de base de la gestion n’attachent pas assez d’importance à ces trois fonctions » (cité par J. Fallows, 1987, p. 43). Faut-il rappeler que moyennant le cursus d’études relatif à la gestion de la production, notre possession des outils de cette filière n’était qu’illusoire. Que dire alors si nous étions spécialiste dans une autre fonction de l’entreprise telle que la finance, les ressources humaines ou la fonction commerciale.
Il est clair qu’il s’agit d’un bilan très sombre au niveau de la formation universitaire des gestionnaires. Nous pouvons nous interroger alors sur la légitimité du SEG et sur la qualité et la légitimité de l’enseignant universitaire. Dans ce cadre d’idées, J. Lebraty souligne notamment:
Depuis le célèbre article des professeurs R. H Hayes et William J. Abernathy au titre provocateur, tout responsable de formation dans le domaine du management éprouve une sorte d’inquiétude cyclothymique quant à sa légitimité. Il ne peut s’empêcher, en effet, de se demander de temps en temps quelle peut être sa part de responsabilité dans les contre-performances des managers (op. cité, p. 104).
Faut-il préciser que les citations des auteurs que nous venons de rapporter relèvent plutôt d’un mouvement d’études visant la réforme du SEG, marqué par la résolution de la problématique de la complexité et de la contradiction managériales, qui a précédé l’instauration du système LMD. Les études de ce projet (ou de ce mouvement) ont commencé depuis la fin des années 70 allant jusqu’à la moitié des années 90. Cependant, malgré les germes productifs de ce projet, sa mise en application était timide et limitée à quelques pays seulement pour toucher uniquement quelques institutions. Un projet fécond qui a été abandonné au profit d’un système qui n’a fait qu’aggraver davantage les déficits du SEG. Le raccourcissement du parcours universitaire en fournisse la preuve. Le simple bon sens stipule que pour passer d’une mission simple de formation (assez éloignée de la réalité complexe de l’entreprise) à une mission beaucoup plus délicate et ardue que celle de produire « le mouton à cinq pattes », il faudrait un parcours beaucoup plus long du précédent mais aucunement moins réduit. Or, on est passé d’un parcours qui dure au moins dix années à un parcours qui dure, tout au plus, neuf années. Nous considérons que cet argument suffit à lui seul de prouver que la décision d’adopter un système calqué sur le modèle Anglo-Saxon, qui a montré ses limités et qui n’a pas échappé aux critiques des auteurs américains mêmes, n’est pas suffisamment fondée logiquement. Il est alors nécessaire de chercher la cause majeure d’abandon d’un projet potentiellement productif au profit d’une réforme non appropriée à la problématique générale du management (la complexité).
Cause majeure expliquant l’abandon d’un projet de réforme potentiellement productif au profit du système LMD
Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce phénomène non raisonnable : l’argument d’autorité, l’ostracisme et les intérêts. J. Lebraty évoque le facteur de l’argument d’autorité et son impact « la fascination exercée par les Etats-Unis sur [son] pays en raison de leur modèle compétitif de gestion des entreprises a conduit à l’imitation pure et simple toute une génération d’enseignants formés aux méthodes américaines» (op. cité, p. 104). Cette imitation « sans valeur ajoutée, de l’étranger » aboutit « à l’ostracisme corporatiste du corps des enseignants et de ceux qui sont chargés d’en garder jalousement l’entrée » (H. Savall, 1989, p. 97). Tous ces facteurs cités ont une part d’explication. Cependant, nous considérons que la cause majeure de cet abandon réside plutôt dans les préjugés qu’ont la majorité des enseignants sur la relation entre S et SF.
En effet, les auteurs qui sont conscients de l’importance du SF et son impact à susciter le développement du S ne sont pas relativement nombreux. Ils pourraient être découragés d’aller droit au but et dans le chemin approprié vu l’extrême difficulté de la mission consistant à produire « le mouton à cinq pattes ». Le problème se pose avec une plus grande acuité pour la majorité des enseignants universitaires qui croient fermement (avec une entière certitude subjective) que le S, moyennant l’expérience et le bon sens, peut conduire à posséder le SF. Par suite, ils jugent qu’il n’est pas nécessaire de donner une grande importance au SF. Sinon, l’université risque de se confondre avec la formation professionnelle. La dite croyance, prise au sens fort et prenant la valeur d’une évidence, amène la plupart des enseignants à rejeter les recommandations des recherches visant la résolution du problème de la complexité. Les auteurs de telles recherches ont beau à présenter les arguments objectifs et le bien fondé des recommandations visant la possession du SF, mais tout cela ne leur permet pas d’aboutir à percer l’entendement des enseignants ayant la dite évidence. Les sentiments et la certitude subjective l’emportent souvent sur la logique et la certitude objective.
Les auteurs J. Bourdonnais, A. Lancestre et J. Lauriol considèrent que certains professeurs, conscients de leur haut niveau de S, négligent le SF et supposent que le S est susceptible de conduire à un SF satisfaisant moyennant une certaine expérience dans le monde des affaires. Au plan du public que constituent les élèves des écoles de gestion, ils se désintéressent des « qualités potentielles au profit d’une exigence de connaissances techniques, susceptibles de leur donner une apparence de compétence opérationnelles et, par voie de conséquence, l’assurance d’un débouché professionnel rapide » (1986, p. 104). Ainsi, la même fausse croyance se situe également chez l’étudiant. D’ailleurs, c’était la même impression que j’avais lorsque j’étais étudiant et la même impression constatée plus tard chez mes étudiants. Les étudiants ne sont pas conscients même du déficit au niveau SF puisqu’ils leur semblent que le S technique est susceptible de leur donner une compétence opérationnelle et par suite la possession du SF. Non conscients de l’existence même du déficit au niveau du SF, ils ne peuvent pas donc réaliser le danger de tel déficit ou déséquilibre.
Nous considérons, par ailleurs, que cette inconscience constitue la cause majeure de l’emprunt d’un chemin non approprié consistant à greffer l’ancien système de quelques recommandations non essentielles des études résolvant la complexité et lui donner quelques retouches (du maquillage) pour qu’il soit attractif. On comprend alors comment la problématique centrale (la complexité et la contradiction) devienne périphérique et la problématique périphérique (internationalisation et standardisation) devienne centrale. Si l’on pousse loin ce raisonnement, l’on peut conclure qu’il serait alors très difficile, si ce n’est pas impossible, qu’une réforme résolvant la complexité puisse voir jour.
Les auteurs P. Lambert, J. P. Shmitt et J. Bissada soulignent que c’est notamment la simplicité apparente mais trompeuse des outils de gestion qui explique notamment la négligence du SF au profit du S. En effet, la plupart des outils de gestion paraissent simples à saisir de prime à bord, mais combien ils sont difficiles à délimiter et à les déchiffrer surtout lorsqu’on cherche à les opérationnaliser et à les appliquer concrètement. Ces auteurs fournissent l’exemple de la technique simplification du travail qui demande « des années de mise en pratique de la méthode, de tentatives infructueuses, ou d’échecs, pour pouvoir l’appliquer efficacement ». Ils indiquent le moyen qui fournit la preuve que la simplicité n’est qu’apparente : « il suffit d’essayer de l’appliquer telle qu’elle est décrite. On s’aperçoit alors à quel point chaque mot de la description de la méthode compte, et à quel point n’est aussi simple ni évident qu’il y paraît ». Ils précisent qu’en France, « on se contente trop souvent de les connaître, le but n’étant pas de l’appliquer, mais de savoir de quoi il s’agit lorsqu’on en entend parler, de façon à pouvoir en parler » et signalent enfin que l’application effective de cette technique est rare :
Combien d’entreprises, en France ou en Europe, pratiquent réellement la simplification du travail ? Celles qui croient l’appliquer sont nombreuses. Celles qui l’appliquent vraiment sont rares. C’est le propre de toutes les méthodes de management d’apparaître évidentes, parce qu’elles sont logiques. Mais la logique du raisonnement implique la rigueur du fonctionnement, et c’est pourquoi des méthodes si simples à comprendre sont difficiles à appliquer (1974, pp. 39 et 40).
L’on peut comprendre pourquoi les acteurs des réformes n’ont pas pensé à combler, de façon significative, le déficit en matière de SF au niveau de l’enseignant d’abord et ensuite au niveau de l’étudiant. Tout acteur de réforme, qu’il soit enseignant ou relevant de l’Administration, croit fermement que moyennant l’expérience et le bon sens, tout accès au S peut conduire à la possession du SF. De notre part également, nous pouvons juger que sans le long stage professionnel poursuivi en OT (où la composante du SF l’emporte sur celle du S), nous aurions subi la même croyance.
En guise de conclusion de tout ce qui a précédé comme analyse, nous pouvons affirmer qu’il est temps d’admettre que si la société continue à ignorer le diplômé en gestion tout en reconnaissant l’importance capitale des sciences de gestion, en constatant notamment le vide ou les insuffisances au niveau gestion dans les diverses sphères de décision, c’est tout simplement parce que ce diplômé n’a pas pu combler ce vide. Il faut alors s’interroger pourquoi le prétendu spécialiste en gestion n’arrive pas à répondre de façon fiable et efficace aux attentes des organisations au niveau conseil en management ? Pourquoi il n’arrive pas à convaincre la société qu’il est mieux placé que tout autre type d’expert à résoudre la complexité managériale ? Il est facile d’en vouloir à la société et de se plaindre pour tous les gestionnaires que nous lisons, que nombreuses revues de gestion publient, « de ne pas les voir traités comme des experts des organisations et des entreprises qu’ils sont, dans les médias et auprès du grand public » (Ph. Naszályi, op. cité). Mais cela ne va pas pour autant changer la donne. Le pouvoir, la notoriété et la reconnaissance ne s’obtiennent pas par simple demande ou explication de leur nécessité mais par persévérance, ténacité et capacité à faire preuves de compétences distinctives et spécifiques. Les dites persévérance et ténacité requièrent une assurance sans faille pour le diplômé en gestion qu’il possède véritablement une compétence distinctive que ne peut pas posséder tout autre type d’expert. Il est vrai que les sciences de gestion sont relativement jeunes par rapport à celles de l’ingéniorat, de l’économie ou de la comptabilité. Mais cela n’empêche pas que la gestion a dépassé l’âge de la jeunesse (plus de 50 ans). Par suite, devant notamment la prise de conscience de plus en plus accrue de l’importance de la gestion, si le SEG et si les méthodes de recherche, telles qu’ils sont appliquées dans les domaines du management, sont suffisamment fiables et efficaces, la reconnaissance sociétale pour cette science aurait été déjà établie. L’enseignant universitaire devait reconnaître ses insuffisances au niveau SF et assumer ses responsabilités quant à la qualité du produit (diplômé) qu’offre le système LMD. Un tel système est à réviser de façon à ce qu’il soit capable de produire un diplômé expert en gestion, ayant un potentiel permettant la résolution de la contradiction et la complexité managériales, qu’aucun autre type d’expert ne peut le rivaliser, du moins aux niveaux Organisation et gestion opérationnelle. C’est la seule attitude qui permet le déclenchement d’un processus conduisant à ce que le diplômé en gestion, qu’il soit enseignant universitaire ou cadre d’une organisation, occupe la position qu’il mérite dans la société.
Youssef Nebli
- Ecrire un commentaire
- Commenter