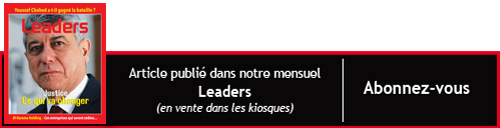Un Tunisien d’exception: Le Cheikh-el-islam Tahar Ben Achour

Tahar Ben Achour (ou Muhammad al Tâhir Ibn Âshûr) naquit à La Marsa en 1879 dans une famille d’enseignants et de magistrats religieux d’origine andalouse fixée à Tunis au XVIIe siècle, ainsi que nous l’apprennent les chroniqueurs contemporains de son ancêtre. Par le fait des alliances matrimoniales, il appartenait à une aristocratie à la fois religieuse et politique puisqu’il était le petit-fils de deux hauts personnages de la Tunisie beylicale: Tahar Ben Achour cadi, mufti et naqîb el ashrâf (mort en 1868), et de Mohamed-El Aziz Bou Attour, zitounien de formation, ministre puis Premier ministre de 1882 à 1907, qui fit de Tahar son fils spirituel. Il grandit donc dans cette ambiance à la fois érudite et politique relativement protégée des humiliations consécutives à la présence étrangère grâce aux deux repères rassurants et proches que constituaient la Grande mosquée-université de la Zitouna et l’Etat beylical.
.jpg)
Les vastes connaissances de son père Mohamed et de son grand-père, l’ouverture de la famille sur le monde social, académique et politique, la familiarisation avec certains aspects de la culture européenne en même temps que l’amour des belles-lettres arabes, tout cela constituait un environnement favorable à l’épanouissement de la personnalité du jeune Tahar. Cet environnement contribua à corriger, comme il le dira lui-même plus tard dans un essai critique sur l’enseignement traditionnel, les défauts d’une pédagogie désastreuse: «Je suis persuadé, écrivait-il en 1910, que si j’avais pu bénéficier dans ma prime jeunesse d’un enseignement et d’une pédagogie conçus autrement, mes capacités auraient été mieux exploitées, mon savoir plus étendu et mon orientation plus judicieuse.
Je m’estime cependant heureux car j’ai pu pour ma part bénéficier des conseils de mon père, de mon grand-père et de quelques maîtres bienveillants.» (Alyasa al Subhu bi qarîb). Ayant terminé ses études supérieures en 1899, Tahar Ben Achour gravit rapidement les échelons et est promu professeur de première classe à la Grande mosquée en 1905, à l’âge de 26 ans. En 1907, il est nommé délégué du Gouvernement auprès du rectorat de la Zitouna. Il enseigne aussi au prestigieux Collège Sadiki de 1905 à 1913 puis de 1923 à 1932 dont il devient aussi membre du conseil d’administration. Cette expérience lui donna l’occasion de voir de près les méthodes pédagogiques modernes introduites par le Protectorat et de côtoyer les enseignants formés à l’école française républicaine et laïque. Membre du comité directeur de la Khaldounia, établissement d’enseignement arabo-musulman moderne, il y fréquente les leaders du mouvement réformiste ou comme on disait alors «évolutionniste» comme Béchir Sfar, Abdeljelil Zaouche ou Mohamed Lasram. Il retrouvait ces figures du modernisme au salon de la Princesse Nazli dont le domicile à La Marsa était voisin de sa résidence. C’est là qu’il rencontra le célèbre ouléma égyptien Mohamed Abdouh et s’enthousiasma pour ses idées.
.jpg)
Membre de la commission pour la réforme de l’enseignement zitounien en 1910, il est aussi nommé magistrat au tribunal immobilier mixte. En 1913, il occupe pendant dix ans la haute fonction de cadi de Tunis qu’avait déjà exercée son grand-père et homonyme sous le règne d’Ahmed Bey I. Mufti en 1923, il devient en 1927 le chef de la magistrature malékite de Tunisie et en 1932, le premier titulaire de cette dignité avec le titre prestigieux de Cheikh-al Islam jusque-là réservé à son homologue du rite hanéfite. La même année, la direction collégiale de l’enseignement zitounien est supprimée et Tahar Ben Achour nommé recteur avec le titre de Cheikh de la Grande mosquée et annexes avec mission de réformer l’enseignement de cette institution vénérable mais sclérosée. En butte à l’hostilité des milieux conservateurs crispés sur leurs privilèges et à l’agitation estudiantine suscitée par le Destour autour de la fameuse affaire des naturalisés musulmans, il démissionna de son poste en 1933 sans avoir pu procéder à des changements significatifs. Rappelé en 1945 dans un enthousiasme populaire général à la tête de la Grande mosquée, le Cheikh Ben Achour–El Oustâdh al Imâm comme se plaisaient à le qualifier ses nombreux admirateurs – mit en œuvre un vaste programme de décentralisation de l’enseignement et des examens et d’amélioration des conditions de vie des étudiants, souvent issus de milieux pauvres et originaires de régions éloignées de la capitale, ainsi que la signature d’accords avec des universités du Proche-Orient pour l’accueil d’étudiants tunisiens.
Appuyé cette fois sur le dynamisme politique des jeunes professeurs tels que Fadhel Ben Achour et Chédli Belcadhi ainsi que de la jeunesse estudiantine regroupée dans le mouvement «La Voix de l’étudiant zitounien», ce programme de rénovation, doté de moyens budgétaires limités, fut malheureusement souvent perturbé dans son application en raison des troubles liés à la revendication nationaliste dans le pays et du refus du Cheikh de se plier aux exigences du Néo-Destour lors de la participation de ce dernier au ministère dit «des négociations» (1950-1952) en la personne de son secrétaire général Salah Ben Youssef, à l’époque très hostile au mouvement zitounien. Sous la pression du Parti, le Bey promulgua un décret qui, tout en maintenant officiellement le cheikh à son poste, l’éloignait cependant de la gestion directe de la Zitouna. En 1956, à l’indépendance, certainement à l’initiative de Habib Bourguiba alors tout-puissant Premier ministre, Tahar Ben Achour retrouva ses prérogatives avec le titre – nouveau – de recteur de l’Université zitounienne (al Jâmi’a al zaytûniya) jusqu’à sa mise à la retraite en avril 1960 à l’issue du conflit qui l’avait opposé, ainsi que le Mufti de Tunisie Cheikh Abdelaziz Djaït, au Président de la République lors de l’affaire du Ramadan en février de la même année.
L’attitude constamment apolitique du Cheikh Ben Achour était fondée principalement sur sa conviction que la réforme des esprits était un préalable à toute émancipation. Mais elle peut s’expliquer aussi par son appartenance à un milieu privilégié et par conséquent relativement à l’abri des avanies consécutives à l’occupation coloniale. D’autant que de tous les secteurs de l’administration tunisienne, seuls l’enseignement zitounien et la magistrature religieuse n’étaient pas soumis directement à la présence humiliante d’un haut fonctionnaire français. Dans ces conditions, la défense par Tahar Ben Achour de l’identité tunisienne et de la culture arabo-islamique coexistait – comme d’ailleurs chez tous les penseurs réformistes depuis le XIXe siècle – avec la volonté de profiter des formidables apports de l’Europe en matière de savoir, de pédagogie et de science. Son essai déjà cité sur l’état déplorable de l’enseignement traditionnel est autant une critique de cet état de choses qu’un hommage rendu à l’efficacité des méthodes pédagogiques des écoles modernes créées par le Protectorat. Toutefois, s’il n’adopta pas une attitude d’hostilité à l’égard de l’administration du Protectorat, il garda toujours une réserve et maintint des rapports empreints de dignité qui lui valurent le respect de tous, Français et Tunisiens. Les attaques violentes qu’il eut à subir de la part du Destour en 1933 et du Néo-Destour en 1950-51 puis – après l’indépendance – au moment de la crise de Ramadan en 1960 n’eurent que des effets politiques limités et ne portèrent jamais atteinte à la considération dont il jouissait, y compris aux yeux des leaders nationalistes dont certains comme Habib Bourguiba avaient été ses élèves enthousiastes au Collège Sadiki. De tous ceux qui en ces moments pénibles manifestèrent leur solidarité au Cheikh Ben Achour, le grand poète Abou-el-Kacem Chebbi fut assurément celui qui exprima le mieux le désespoir des Tunisiens lucides face aux vociférations de la foule. Dans une lettre émouvante adressée de Medjez el Bab le 17/6/1352 hég.(octobre 1933) à celui qui fut son professeur, il dénonça en des termes sévères le triste travers séculaire de ses compatriotes qui «détruisent leurs espérances de leurs mains et jettent des pierres sur ceux qui leur montrent la bonne voie.»
.jpg)
Les choses changèrent radicalement pour la génération de son fils Fadhel, marquée par l’engagement d’après-guerre pour l’émancipation des peuples et surtout traumatisée par la création en 1948 de l’Etat d’Israël. L’action politique marquée par la méfiance à l’égard de l’Occident, le refus de l’injustice coloniale et la solidarité avec les Palestiniens prit dès lors le pas sur l’œuvre réformatrice de longue haleine.
Les aléas de la brillante carrière du Cheikh ont, en revanche, été une chance pour l’intelligence tunisienne. Tahar Ben Achour, qui se distinguait des zitouniens notamment par sa puissance de travail intellectuel, a en effet connu trois grandes phases d’interruption d’activité professorale, judiciaire ou administrative, entre 1933 et 1945, puis entre 1950 et 1956 et enfin lors de sa retraite. Périodes qu’il sut mettre à profit pour entreprendre, achever et publier des ouvrages qui comptent aujourd’hui parmi les références érudites et intellectuelles majeures de la culture arabe et islamique. Il a laissé une œuvre considérable dans les sciences religieuses, en particulier son imposant commentaire du Coran Al Tahrîr wa al Tanwîr, le premier réalisé dans son intégralité par un Maghrébin, et dont le côté à la fois classique et novateur lui assure aujourd’hui une audience qui s’étend à l’ensemble du monde musulman. On retrouve dans ce travail magistral le souci de Ben Achour de s’appuyer sur la raison qui, par la faculté de discernement qu’elle confère à l’homme, lui fait prendre conscience de la perfection du verbe divin. «Une bonne lecture du Coran éclaire la raison (tanwîr al ‘aql)». L’option, on le voit, est ouvertement élitiste.
.jpg)
Le perfectionnement de la croyance chez l’individu est un préalable indispensable à toute réforme de la communauté. Cette importance accordée au raisonnement dans AlTahrîr wa al Tanwîr contribue à distinguer l’ouvrage du Cheikh-el-Islam de ceux de ses contemporains d’Orient. Ainsi à propos du verset 34, IV relatif à la permission donnée aux maris dont les épouses font preuve «d’indocilité» de les tenir isolées et de les frapper, tel commentateur égyptien contemporain en appelle «au bon sens» pour justifier la peine corporelle. Chez Sidi Tahar, l’approche est tout à fait différente. Rappelant la part du contexte historique dans la révélation du verset, il donne son opinion personnelle et manifeste ses réserves à l’égard du châtiment corporel qui, dit-il, «a pu, en des temps reculés,ne pas faire figure de comportement dégradant, mais ce n’est plus le cas de nos jours. Aussi l’autorité publique est-elle habilitée à interdire cet usage et à punir les maris contrevenants.» Il s’agit bel et bien là d’un exemple encore rare aujourd’hui d’ijtihâd, d’un effort d’interprétation personnelle à la lumière de l’évolution des hommes et des sociétés.

Son autre apport capital en matière de sciences religieuses et de philosophie du droit musulman est son célèbre Maqâsid al Charîa (brillamment commenté par son disciple le cheikh Habib Belkhodja) dans lequel il remet en vigueur les vertus de la haute époque des sciences islamiques: l’observation du monde, la rigueur et l’approche critique. Ces deux ouvrages, le Tafsîr et les Maqâsid établirent définitivement sa réputation d’ouléma novateur en rupture avec la nombreuse cohorte des imitateurs frileux des anciens. Dès le début du XXe siècle, il dénonça dans son essai Alyasa …les effets de l’ankylose de l’enseignement sur les esprits: «Les temps ont changé, les connaissances ont évolué et les nations ont prospéré mais nous demeurons prisonniers de notre savoir et de nos livres. A chaque évolution accomplie par les autres, à chaque progrès enregistré, nous ne faisons que nous crisper encore plus sur notre passé, que nous retrancher davantage derrière nos portes closes. A telle enseigne que par la nature de ses connaissances, de son savoir et de sa façon de raisonner, l’homme du XIVe siècle de l’Hégire (XXe siècle J.-C.) ressemble à s’y méprendre à l’homme du IXe ou du Xe siècle! Cela à cause d’une interruption de la production scientifique figée au stade où l’avait laissée les grands auteurs de jadis.»

L’autre grand apport du Cheikh Sidi Tahar fut sa contribution en matière de langue et littérature arabes; notamment sa découverte du plus important manuscrit du Divan du poète libertin d’époque abbasside Bachâr Ibn Bord et la très savante édition critique qu’il en fit. Ce faisant, il renouait avec la grande tradition des oulémas qui plaçaient la beauté de la langue et les belles-lettres au-dessus de toute considération. Le vœu spirituel et intellectuel suprême de Tahar Ben Achour ayant toujours été de réaliser son commentaire du Coran, il faut ajouter à ses goûts littéraires et à son anticonformisme esthétique, son souci de s’imprégner de toute la richesse de la langue poétique arabe afin d’aborder l’exégèse du Livre saint et les subtilités complexes de son langage avec la meilleure érudition possible.

Au plan humain, Tahar Ben Achour, aristocrate, était cependant proche des gens. Ennemi farouche du népotisme qui régnait dans le milieu zitounien au bénéfice des grandes familles d’enseignants et de magistrats, il fit de la lutte contre le favoritisme son combat prioritaire. Le prestige dont jouit aujourd’hui encore sa famille est dû autant à ce combat sans relâche contre les injustices dont souffraient les étudiants pauvres de la province face à l’arrogance de l’establishment zitounien qu’à son apport intellectuel. Du nord au sud, d’est en ouest, il n’est pas une région de la Tunisie qui ne garde aujourd’hui encore le souvenir de cette caractéristique admirable qui distinguait Tahar Ben Achour de beaucoup de gens de son milieu.

Dans sa vie quotidienne, le cheikh évoluait dans le cadre raffiné des résidences typiques de l’élite sociale d’époque beylicale. C’était cependant une vie sans ostentation, réglée de manière remarquable et tournant autour de la vocation éminemment érudite du cheikh. Jusqu’aux derniers instants de son existence, il consacrait une partie de la journée à un travail régulier de lecture et de rédaction, facilité par l’existence de sa riche bibliothèque. L’après-midi, il recevait en sa Bayt- el- drîba (salon de réception situé dans le parc) et, à la belle saison dans son jardin, amis et visiteurs tunisiens et étrangers. Dans les circonstances exceptionnelles comme à l’occasion des deux fêtes de l’Aïd, les personnes venues de tous les horizons lui présenter leurs vœux étaient tellement nombreuses qu’entre la gare du TGM et sa résidence, c’était une véritable procession qui traversait le quartier de Marsa-Ville. En 1951, à son retour de voyage en Turquie et en Europe au plus fort de la crise entre le Néo-Destour et le mouvement zitounien, c’est par trains entiers que les étudiants de la Grande mosquée vinrent l’accueillir à l’aéroport d’El Aouina.

En patriarche vénéré, il dirigeait sa famille et son nombreux personnel sans jamais se départir d’une dignité à la fois autoritaire et bon enfant, y compris dans les heures sombres comme lors de la perte de son épouse en 1956 et de ses deux fils Zine El Abidine en 1966 et le cheikh Fadhel en 1970. Il supporta ces événements douloureux avec un courage et une dignité qui firent l’admiration de ses contemporains et dont la Tunisie garde aujourd’hui encore le souvenir édifiant et ému. Cette vie quotidienne très organisée était enrichie par des excursions à l’intérieur du pays et des voyages comme en France en 1926, à l’occasion de l’inauguration de la mosquée de Paris, au pèlerinage en 1944 ou son périple en Europe et au Proche-Orient à l’occasion du Congrès mondial des orientalistes tenu à Istanbul en 1950.Son sens aigu de l’organisation et son souci de la rigueur lui permettaient de faire face aux devoirs de ses hautes charges religieuses et académiques, à son besoin de lire et d’écrire en même temps qu’à ses obligations familiales et sociales. Respectueux des sentiments de vénération des gens à son égard, jamais il ne négligeait de répondre à leurs invitations ou de les soutenir dans l’adversité. Je me souviens que le jour même de sa mort, à 94 ans, il s’apprêtait à se rendre l’après-midi du 12 août 1973 à la zaouia de Sidi Mahrez pour présider une énième cérémonie en réponse à la sollicitation des familles.

Tunisien d’exception, le Cheikh Ben Achour le fut à plus d’un titre. Avec lui réapparut la figure de l’ouléma de haute époque, ajoutant à une foi profonde et une vaste érudition le recours à l’esprit de réforme et la réflexion critique. Digne héritier des grands auteurs classiques, il cultivait le goût des belles-lettres avec un intérêt certain pour les arts, y compris dans leurs expressions occidentales. Son œuvre (il fut incontestablement le plus fécond des oulémas d’époque moderne et contemporaine de Tunisie) a enrichi considérablement l’apport de son pays dans les sciences religieuses, littéraires et linguistiques. Ses ouvrages, aujourd’hui étudiés dans toutes les universités musulmanes ainsi que dans les départements d’islamologie d’Occident, contribuent au rayonnement de la Tunisie dans le monde.

Enfin, par la pensée et l’action, Tahar Ben Achour a apporté sa pierre à l’édifice de la réforme de la culture et de l’enseignement arabo-islamiques. Edifice malheureusement encore inachevé en raison des multiples obstacles politiques et sociaux, internes et externes à l’entrée dans la modernité mais aussi, il faut bien le dire, à l’option totalement élitiste et résolument apolitique du cheikh-el-islam. Sa clairvoyance et la priorité accordée à une transformation en profondeur des mentalités par une refonte de l’enseignement, de ses programmes et de ses méthodes ont été submergées – ici comme dans la plupart des pays arabes– par la revendication nationaliste et l’activisme idéologique encouragés par un XXe siècle propice aux leaders et à la mobilisation des masses.
Reconnu depuis toujours par ses compatriotes comme un Tunisien d’exception, Tahar Ben Achour est considéré partout, aujourd’hui, comme un des plus illustres oulémas de l’histoire de l’islam moderne et contemporain.
Mohamed-El Aziz Ben Achour