L’esthétisation de la violence
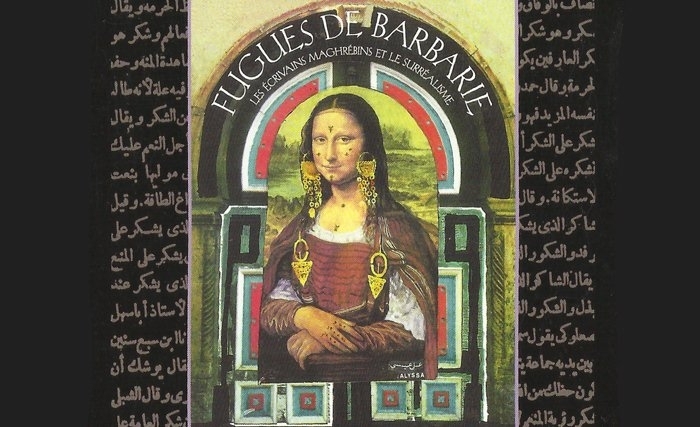
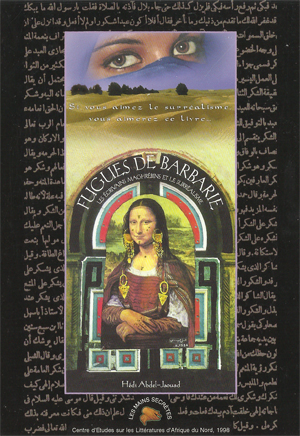 Le phénomène de la violence, tel qu’il se présente dans la réalité, est difficile à appréhender tant sa nature est protéiforme. Aujourd’hui, avec la mondialisation et les nouvelles technologies, il fait même l’objet d’une esthétisation à outrance. Cela peut paraître paradoxal, puisque la violence, comme la guerre, ne peut à priori, être esthétisée.
Le phénomène de la violence, tel qu’il se présente dans la réalité, est difficile à appréhender tant sa nature est protéiforme. Aujourd’hui, avec la mondialisation et les nouvelles technologies, il fait même l’objet d’une esthétisation à outrance. Cela peut paraître paradoxal, puisque la violence, comme la guerre, ne peut à priori, être esthétisée.
Pour le comprendre, il y a lieu de souligner, en premier lieu, que la modernité, comme la tradition, n’est rien d’autre qu’un concept relatif, accaparé par les pouvoirs publics, les politiciens et les artistes, variant au cours des siècles selon les normes fixées surtout par les puissances dominantes.
D’autre part, il va s’en dire, que les peintres européens ont, de tout temps, privilégié les tableaux sanglants et les scènes pathétiques, suivant en cela la fameuse maxime «quia magis movent visa quam audita» (Ce qui est vu frappe plus que ce qui est entendu). Ils espèrent, certes, bouleverser ainsi l’acquéreur éventuel de leurs oeuvres en produisant en lui cette émotion qu’il désire ressentir en secret et qu’il est venu rechercher sans risque.
En effet, l’homme reste homme. Capable d’évolution, capable d’imagination, maître de l’infiniment grand et de l’infiniment petit, il a néanmoins ses faiblesses.
Ne pas en tenir compte, c’est se couper de la réalité, du présent, de la vie elle-même. Ne prend-il pas plaisir, comme le dit Aristote, «à contempler la représentation la plus précise des choses dont la vue nous est pénible dans la réalité, comme les formes des animaux les plus hideux et des cadavres»? (Poétique 4).
Il fut un temps, en Europe, monde bâti essentiellement sur l'imaginaire, peuplé d'anges et de démons, délimité par le Paradis, l'Enfer et le Purgatoire, où la violence et son corollaire, la souffrance, étaient les références suprêmes. C'était là toute l'essence de la "terribilita" sacrée de la peinture des grands maîtres de la Renaissance italienne et de la Contre-réforme en général. Il suffit de se référer aux maîtres de l’Ecole de Naples et à leurs tableaux sanglants, où le corps humain se trouve mis à nu, torturé, disséqué comme un vulgaire objet ; d’immenses tableaux où le corps humain se tord de douleur, où la bouche s’ouvre agonisante, et où le sang éclabousse partout.
Un peintre comme Stanzione ne se contente pas d’une "Pieta" ou d’une "Flagellation" comme son illustre contemporain Le Caravage. Non, il lui faut encore un ‘Jean-Baptiste’ agenouillé devant un bourreau hideux, et un ‘massacre des Innocents’ des plus atroces où de petits corps dépecés, de petites mains, des têtes de chérubins aux yeux révulsés gisent dans des mares de sang sous les pieds des assassins.

Jusepe de Ribera imagine Jésus étendu sur un drap blanc immaculé sur lequel se détachent deux énormes clous noirs et dans son "Jean-Baptiste", place près de la tête du martyr un crucifix, un voile blanc taché de sang recouvrant à moitié une épée encore ensanglantée.
Domenichino préfère peindre une seule tête et l’effet n’est nullement moindre. Un autre martyr, Saint Sébastien, qui inspirera le français Redon, est imaginé par Preti enchaîné, seul et transpercé de plusieurs flèches, alors que da Varallo le montre flanqué de deux anges, la figure radieuse malgré les deux traits enfoncés l’un dans sa poitrine et l’autre dans sa cuisse.
Dans le tableau de Giordano la même douceur se reflète sur les traits de saint Michel terrassant le Diable dont la bouche béante se tord de souffrance. Cavallini imagine une Judith la main délicatement posée sur la tête coupée de Holopherne. Amour et haine, tendresse et douleur se mêlent ainsi dans le clair-obscur légendaire et effrayant de ces maîtres italiens, provoquant cette ‘terribilita’ sacrée qui leur est propre.
Les temps n’ont guère évolué depuis. Faut-il s’en étonner? "Les hommes en général, écrivait Voltaire, aiment les spectacles; ils veulent qu'on parle à leurs yeux : le peuple se plaît à voir des cérémonies pompeuses, des objets extraordinaires, des orages, des armées rangées en bataille, des épées nues, des combats, des meurtres, du sang répandu ; et beaucoup de grands, comme on l'a déjà dit, sont peuple".
En fait, à bien la considérer, la peinture, aujourd’hui, témoigne d'un effort cohérent relevant d'une esthétique, voire d'une éthique, les deux relevant de la culture et de la tradition occidentales. L'importance de l'impact visuel, ce souci du "frappant", fait partie surtout de la culture anglo-saxonne. Son origine remonte à la renaissance anglaise et à Shakespeare en particulier. Contrairement aux Français, les anglais ont toujours cultivé ce goût moyen âgeux pour la violence et le spectacle violent. Et si Voltaire a traité le grand Shakespeare de "Gilles de village", c'est bien à cause de cette violence et de ces tableaux sanglants qui ponctuent toutes ces tragédies, spéculant ainsi sur les goûts morbides de son public.
Certes, dans le sillage des deux guerres mondiales qui ont endeuillé le siècle dernier, l’esthétisation de la violence apparut comme une véritable hérésie, mais peu à peu, le fascisme mais aussi le futurisme aidant, elle entra dans les mœurs. L’émergence des forces prolétaires combatives la renforça et donna l’occasion à des intellectuels et autres hommes de théâtre engagés, comme Brecht, de passer leur message, la lutte des classes, mêlant du coup éthique et esthétique, le Bien et le Beau. Le surréaliste Max Ernst, s’inspirant de Breton et de Soupault ira jusqu’ peindre des créatures mi-végétales, mi-animales. Auparavant, en 1919 Marcel Duchamp osa affubler la Joconde d’une paire de moustache, et d’un titre humoristique.
A la disparition du bloc communiste, l’esthétisation de la violence devint tout naturellement la préoccupation exclusive de l’Occident. C’est lui qui, désormais, dictera les normes mondiales, selon un style de plus en plus spectaculaire, grâce aux nouvelles technologies. Au cinéma, il suffit de penser à des films comme ‘Ah Dieu ! que la guerre est jolie’, de Richard Attenborough, sorti en 1969 et adapté de la comédie musicale de Joan Littlewood, Oh ! What a lovely war, qui connut en 1963 un succès sans précédent. On peut citer encore ‘Apocalypse now’ ou ‘La passion du Christ’, pour s’en convaincre. On se souvient à propos de ce film de Mel Gibson, de la controverse qui a secoué l’Occident : message chrétien d'une haute valeur pour les uns, il est un flot d'hémoglobine et une attaque anti-judaïque délibérée pour les autres.
Dans ces cas, le dernier mot revient toujours au critique d’art. Juge omnipotent, ce dernier a-t-il droit à l'erreur? Peut-il critiquer sans discernement aucun ? Au contraire, ne doit-il pas faire preuve d'une exigence intellectuelle ferme et décidée, afin de ne pas se laisser influencer et devenir l'incarnation d'une censure vulgaire ? A lui donc de jauger ce qui peut l’être en matière de violence et d’admettre que toute œuvre doit avoir sa part de vérité humaine.
Ainsi donc, les tentatives d’esthétisation de la violence qu'elle soit au cinéma ou ailleurs sont légion, tant il est vrai que les sources de violence à travers tous les âges sont innombrables. Mais si ces tentatives existent, elles varient selon le bord où l'on se trouve, d'autant plus que chaque civilisation possède des normes de valeurs particulières et, par conséquent, des jugements différents sur certains problèmes cruciaux.
La représentation de la violence n’a pas, en général, concerné le monde arabo-musulman. Bien qu’elle fasse partie de son environnement, qui se trouve être d'ailleurs celui de toutes les époques de l'histoire, pour des raisons religieuses, il n’admet pas la reproduction des traits humains et, par conséquent, l'utilité, voire la nécessité de la représentation de la violence.
Or, c’est grâce au visage que l’individu perçoit son identité et sa différence et qu’il affirme sa singularité par rapport à la communauté. Et comme ce sentiment n’est nullement incompatible avec celui d’appartenir à la communauté, l’homme, qu’il le veuille ou non, reste soumis à la dynamique sociale, le visage reflétant à lui seul, notre condition humaine. Aujourd’hui, la violence ne se réduit plus à l’hémoglobine mais aux blessures du temps et aux malformations congénitales. Il suffit, pour s’en rendre compte, de voir les tableaux de Francis Bacon, de Jean Rustin ou encore de Stéphane Ravel. (voir ci-contre)
La peinture, ce «divin artifice» a-t-on dit, permet à tout un chacun de plonger, comme dit le poète, au tréfonds de soi-même, et de donner ainsi vie à l’œuvre, avec son imaginaire à soi. A lui d’aller au-delà de l’image, de saisir la vision spirituelle que sous-tend la dimension matérialiste.

En Tunisie, inconsciemment ou non, plusieurs peintres influencés par les divers courants artistiques français comme Hatem EL Mekki, Ammar Farhat, Yahya Turki, Ali Ben Salem ou encore Abdelwahab Amich, ont eu recours à la stylisation à outrance. Ainsi, les œuvres de ce dernier, par exemple, se présentent souvent comme des idéogrammes spécifiques, des constructions géométriques, où le ‘modelé’ et les ‘dégradés’ semblent ne jouer aucun rôle, mais où l’ensemble sollicite aussi bien l’esprit que le regard. Celles de la regrettée Safia Ferhat, notamment «L’Aïd», «Le Pêcheur», ou encore « les enfants », sont un modèle parfait de cadrage et de schématisation. Stylisés à l’extrême, les traits des personnages sont à peine perceptibles, dans «Le Pêcheur», en particulier.
Or de la stylisation à la décomposition des formes et au recours à la violence, dans les pays musulmans, il n’y a qu’un pas que d’aucuns hésitent encore à franchir. Il y a certes les craintes d’un peintre comme Klee qui a longtemps séjourné en Tunisie et qui redoute la «recherche convulsive de la nouveauté au dépens du naturel» mais, hélas, il y a également les tabous ancrés dans notre conscience depuis des temps immémoriaux.
Les phénomènes qui concourent à la montée de cette tendance à l’esthétisation de la violence sont donc multiples, certes, mais force est de reconnaître que l’image déversée aujourd’hui par les satellites, les mass media et les réseaux sociaux y sont pour beaucoup. Partout dans le monde, les découvertes scientifiques, l’accroissement démographique, l’éclatement des structures traditionnelles de la vie économique, sociale et religieuse, ont transformé radicalement l'image de l'Homme. Il n’empêche que les tentatives d’expliquer la violence sont légion et que le ‘malheur au malheur ressemble’ à travers tous les âges. Ceux qui critiquent cette tendance artistique devraient songer un peu plus souvent à cette vérité. Si ces artistes et ces intellectuels admettent l'utilité, voire la nécessité de la représentation de ce genre de violence c’est parce que non seulement elle fait partie de leur environnement, qui se trouve être d'ailleurs celui de toutes les époques de l'histoire mais aussi parce qu’elle leur permet de jouir de cette libération de l’esprit à laquelle ils aspirent. Ainsi leur est donnée la possibilité d'agir, selon leur vocation même, en témoins de leur temps, et de proposer une éthique sans s'engager directement, dans une critique délibérée de leur propre société.
Rafik Darragi